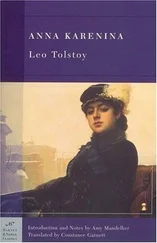Une des premières femmes du monde qu’il rencontra fut sa cousine Betsy. «Enfin, s’écria-t-elle joyeusement! et Anna? Où êtes-vous descendus? J’imagine aisément le vilain effet que doit vous produire Pétersbourg après un voyage comme le vôtre. Et le divorce? est-ce arrangé?»
Cet enthousiasme tomba dès que Betsy apprit que le divorce n’était pas encore obtenu, et Wronsky s’en aperçut.
«Je sais bien qu’on me jettera la pierre, dit-elle, mais je viendrai voir Anna. Vous ne restez pas longtemps?»
Elle vint, en effet, le jour même, mais elle avait changé de ton; elle sembla insister sur son courage et la preuve de fidélité et d’amitié qu’elle donnait à Anna; après avoir causé des nouvelles du jour, elle se leva au bout de dix minutes, et dit en partant:
«Vous ne n’avez toujours pas dit à quand le divorce? Mettons que moi, je jette mon bonnet par-dessus les moulins, mais je vous préviens que d’autres n’en feront pas autant, et que vous trouverez des collets-montés qui vous battront froid… Et c’est si facile maintenant! Ça se fait. Ainsi vous partez vendredi? Je regrette que nous ne puissions nous voir d’ici là.»
Le ton de Betsy aurait pu édifier Wronsky sur l’accueil qui leur était réservé; il voulut cependant faire encore une tentative dans sa famille. Il pensait bien que sa mère, si ravie d’Anna à leur première rencontre, serait inexorable pour celle qui venait de briser la carrière de son fils, mais Wronsky fondait les plus grandes espérances sur Waria, sa belle-sœur: celle-ci ne jetterait certes pas la pierre à Anna, et viendrait simplement et tout naturellement la voir.
Dès le lendemain, l’ayant trouvée seule, il s’ouvrit à elle.
«Tu sais, Alexis, combien je t’aime, répondit Waria après l’avoir écouté, et combien je te suis dévouée, mais si je me tiens à l’écart, c’est que je ne puis être d’aucune utilité à Anna Arcadievna (elle appuya sur les deux noms). Ne crois pas que je me permette de la juger, j’aurais peut-être agi comme elle à sa place; je ne veux entrer dans aucun détail, ajouta-t-elle timidement en voyant s’assombrir le visage de son beau-frère, mais il faut bien appeler les choses par leur nom. Tu voudrais que j’allasse la voir pour la recevoir ensuite chez moi, afin de la réhabiliter dans la société? Mais je ne puis le faire. Mes filles grandissent, je suis forcée, à cause de mon mari, de vivre dans le monde. Suppose que j’aille chez Anna Arcadievna, je ne puis l’inviter chez moi, de crainte qu’elle ne rencontre dans mon salon des personnes autrement disposées que moi. N’est ce pas de toute façon la blesser?… Je ne puis la relever…
– Mais je n’admets pas un instant qu’elle soit tombée, et je ne voudrais pas la comparer à des centaines de femmes que vous recevez! interrompit Wronsky se levant, persuadé que sa belle-sœur ne céderait pas.
– Alexis, je t’en prie, ne te fâche pas, ce n’est pas ma faute, dit Waria avec un sourire craintif.
– Je ne t’en veux pas, mais je souffre doublement, dit-il, s’assombrissant de plus en plus, je regrette notre amitié brisée, ou du moins bien atteinte, car tu dois comprendre que tel sera pour nous l’inévitable résultat.»
Il la quitta sur ces mois, et, comprenant enfin l’inutilité de nouvelles tentatives. Il résolut de se considérer comme dans une ville étrangère et d’éviter toute occasion de froissements nouveaux.
Une des choses qui lui furent le plus pénible fut d’entendre partout son nom associé à celui d’Alexis Alexandrovitch; chaque conversation finissait par rouler sur Karénine, et s’il sortait, c’était encore lui qu’il rencontrait, ou du moins il se le figurait, comme une personne affligée d’un doigt malade croit le heurter à tous les meubles.
D’autre part, l’attitude d’Anna le chagrinait; il la voyait dans une disposition morale étrange, incompréhensible, qu’il ne lui connaissait pas; tour à tour tendre et froide, elle était toujours irritable et énigmatique. Évidemment quelque chose la tourmentait, mais, au lieu d’être sensible aux froissements dont Wronsky souffrait douloureusement, et qu’avec sa finesse de perception ordinaire elle aurait dû ressentir comme lui, elle paraissait uniquement préoccupée de dissimuler ses soucis, et parfaitement indifférente au reste.
La pensée dominante d’Anna, en rentrant à Pétersbourg, était d’y voir son fils: possédée de cette idée, du jour où elle quitta l’Italie, sa joie augmenta à mesure qu’elle approchait de Pétersbourg. C’était chose simple et naturelle, croyait-elle, de revoir l’enfant en vivant dans la même ville que lui; mais dès son arrivée elle sentit qu’une entrevue ne serait pas facile à obtenir.
Comment s’y prendre? Aller chez son mari au risque de n’être pas admise et de s’attirer peut-être un affront? Écrire à Alexis Alexandrovitch? C’était impossible, et cependant elle ne saurait se contenter de voir son fils en promenade, elle avait trop de baisers, de caresses à lui donner, trop de choses à lui dire! La vieille bonne de Serge aurait pu lui venir en aide, mais elle n’habitait plus la maison Karénine. Deux jours se passèrent ainsi en incertitudes et en tergiversations; le troisième jour, ayant appris les relations d’Alexis Alexandrovitch avec la comtesse Lydie, elle se décida à écrira à celle-ci.
Ce fut pour elle une déception cruelle que de voir revenir son messager sans réponse. Jamais elle ne se sentit blessée, humiliée à ce point, et cependant elle comprenait que la comtesse pouvait avoir raison. Sa douleur fut d’autant plus vive qu’elle n’avait à qui la confier.
Wronsky ne la comprendrait même pas; il traiterait la chose comme de peu d’importance, et rien que l’idée du ton froid dont il en parlerait le lui faisait paraître odieux. Mais la crainte de le haïr était la pire de toutes. Aussi résolut-elle de lui cacher soigneusement ses démarches par rapport à l’enfant.
Toute la journée elle s’ingénia à imaginer d’autres moyens de joindre son fils, et se décida enfin au plus pénible de tous: écrire directement à son mari. Au moment où elle commençait sa lettre, on lui apporta la réponse de la comtesse Lydie. Elle s’était résignée au silence, mais l’animosité, l’ironie qu’elle lut entre les lignes de ce billet, la révoltèrent.
«Quelle cruauté! quelle hypocrisie! pensa-t-elle; ils veulent me blesser et tourmenter l’enfant! Je ne les laisserai pas faire! elle est pire que moi: du moins, moi, je ne mens pas!»
Aussitôt elle prit le parti d’aller le lendemain, anniversaire de la naissance de Serge, chez son mari; d’y voir l’enfant en achetant les domestiques coûte que coûte, et de mettre un terme aux mensonges absurdes dont on le troublait.
Anna commença par courir acheter des joujoux et fit son plan: elle viendrait le matin de bonne heure, avant qu’Alexis Alexandrovitch fût levé; elle aurait de l’argent tout prêt pour le suisse et le domestique, afin qu’on la laissât monter sans lever son voile, sous prétexte de poser sur le lit de Serge des cadeaux envoyés par son parrain. Quant à ce qu’elle dirait à son fils, elle avait beau y penser, elle ne pouvait rien préparer.
Le lendemain matin, vers huit heures, Anna descendit de voiture et sonna à la porte de son ancienne demeure.
«Va donc voir qui est là. On dirait une dame», dit Kapitonitch à son aide, un jeune garçon qu’Anna ne connaissait pas, en apercevant par la fenêtre une dame voilée sur le perron; le suisse était en déshabillé du matin. Anna, à peine entrée, glissa un billet de trois roubles dans la main du garçon et murmura: «Serge,… Serge Alexéitch», puis elle fit quelques pas en avant.
Читать дальше