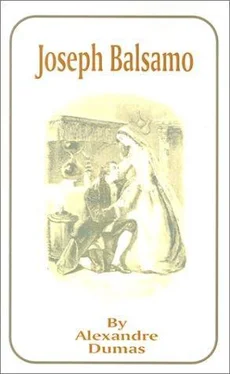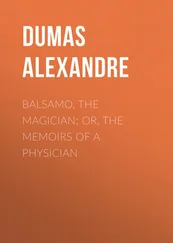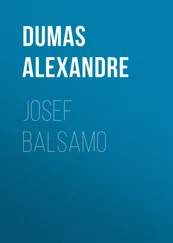– Il sait le latin?
– Fort mal.
– Cependant, j’ai lu dans une gazette qu’il avait traduit un auteur ancien nommé Tacite.
– Parce que dans son orgueil – hélas! tout homme est orgueilleux par moments – parce que dans son orgueil il a voulu tout entreprendre; mais il le dit lui-même dans l’avertissement de son premier livre, du seul qu’il ait traduit, il entend assez mal le latin, et Tacite, qui est un rude jouteur, l’a bientôt eu lassé. Non, non, bon jeune homme, en dépit de votre admiration, il n’y a point d’homme universel, et presque toujours, croyez-moi, on perd en profondeur ce que l’on gagne en superficie. Il n’y a si petite rivière qui ne déborde sous un orage et qui n’ait l’air d’un lac. Mais essayez de lui faire porter bateau, et vous aurez bientôt touché le fond.
– Et, à votre avis, Rousseau est un de ces hommes superficiels?
– Oui; peut-être présente-t-il une superficie un peu plus étendue que celle des autres hommes, dit l’étranger, voilà tout.
– Bien des hommes seraient heureux, à mon avis, d’arriver à une superficie semblable.
– Parlez-vous pour moi? demanda l’étranger avec une bonhomie qui désarma à l’instant même Gilbert.
– Ah! Dieu m’en garde! s’écria ce dernier; il m’est trop doux de causer avec vous pour que je cherche à vous désobliger.
– Et en quoi ma conversation vous est-elle agréable? car je ne crois pas que vous veuillez me flatter pour un morceau de pain et quelques cerises?
– Vous avez raison. Je ne flatterais pas pour l’empire du monde; mais écoutez, vous êtes le premier qui m’ait parlé sans morgue, avec bonté, comme on parle à un jeune homme et non comme on parle à un enfant. Quoique nous ayons été en désaccord sur Rousseau, il y a derrière la mansuétude de votre esprit quelque chose d’élevé qui attire le mien. Il me semble, quand je cause avec vous, que je suis dans un riche salon dont les volets sont fermés, et dont, malgré l’obscurité, je devine la richesse. Il ne tiendrait qu’à vous de laisser glisser dans votre conversation un rayon de lumière, et alors je serais ébloui.
– Mais vous-même, vous parlez avec une certaine recherche qui pourrait faire croire à une meilleure éducation que celle que vous avouez?
– C’est la première fois, monsieur, et je m’étonne moi-même des termes dans lesquels je parle; il y en a dont je connaissais à peine la signification, et dont je me sers pour les avoir entendu dire une fois. Je les avais rencontrés dans les livres que j’avais lus, mais je ne les avais pas compris.
– Vous avez beaucoup lu?
– Trop; mais je relirai.
Le vieillard regarda Gilbert avec étonnement.
– Oui, j’ai lu tout ce qui m’est tombé sous la main, ou plutôt, bons et mauvais livres, j’ai tout dévoré. Oh! si j’avais eu quelqu’un pour me guider dans mes lectures, pour me dire ce que je devais oublier et ce dont je devais me souvenir!… Mais pardon, monsieur, j’oublie que, si votre conversation m’est précieuse, il ne doit pas en être ainsi de la mienne: vous herborisiez, et je vous gêne, peut-être?
Gilbert fit un mouvement pour se retirer, mais avec le vif désir d’être retenu. Le vieillard, dont les petits yeux gris étaient fixés sur lui, semblait lire jusqu’au fond de son cœur.
– Non pas, lui dit-il, ma boîte est presque pleine, et je n’ai plus besoin que de quelques mousses; on m’a dit qu’il poussait de beaux capillaires dans ce canton.
– Attendez, attendez, dit Gilbert, je crois avoir vu ce que vous cherchez, tout à l’heure, sur une roche.
– Loin d’ici?
– Non, là, à cinquante pas à peine.
– Mais comment savez-vous que les plantes que vous avez vues sont des capillaires?
– Je suis né dans les bois, monsieur; puis, la fille de celui chez qui j’ai été élevé s’occupait aussi de botanique; elle avait un herbier, et au-dessous de chaque plante le nom de cette plante était écrit de sa main. J’ai souvent regardé ces plantes et cette écriture, et il me semble avoir vu des mousses que je ne connaissais, moi, que sous le nom de mousses de roche, désignées sous celui de capillaires.
– Et vous vous sentez du goût pour la botanique?
– Ah! monsieur, quand j’entendais dire par Nicole – Nicole était la femme de chambre de mademoiselle Andrée – quand j’entendais dire que sa maîtresse cherchait inutilement quelques plantes dans les environs de Taverney, je demandais à Nicole de tâcher de savoir la forme de cette plante. Alors souvent, sans savoir que c’était moi qui avais fait cette demande, mademoiselle Andrée la dessinait en quatre coups de crayon. Nicole aussitôt prenait le dessin et me le donnait. Alors je courais par les champs, par les prés et par les bois jusqu’à ce que j’eusse trouvé la plante en question. Puis, quand je l’avais trouvée, je l’enlevais avec une bêche, et la nuit je la transplantais au milieu de la pelouse; de sorte qu’un beau matin, en se promenant, mademoiselle Andrée jetait un cri de joie, en disant: «Ah! mon Dieu! comme c’est étrange, cette plante que j’ai cherchée partout, la voilà.»
Le vieillard regarda Gilbert avec plus d’attention qu’il ne l’avait fait encore, et si Gilbert, songeant à ce qu’il venait de dire, n’eût baissé les yeux en rougissant, il eût pu voir que cette attention était mêlée d’un intérêt plein de tendresse.
– Eh bien! lui dit-il, continuez d’étudier la botanique, jeune homme; la botanique vous conduira par le plus court chemin à la médecine. Dieu n’a rien fait d’inutile, croyez-moi, et chaque plante aura un jour sa signification au livre de la science. Apprenez d’abord à connaître les simples, ensuite vous apprendrez quelles sont leurs propriétés.
– Il y a des écoles à Paris, n’est-ce pas?
– Et même des écoles gratuites; l’école de chirurgie, par exemple, est un des bienfaits du règne présent.
– Je suivrai ses cours.
– Rien de plus facile; car vos parents, je le présume, voyant vos dispositions, vous fourniront bien une pension alimentaire.
– Je n’ai pas de parents; mais, soyez tranquille, avec mon travail je me nourrirai.
– Certainement, et puisque vous avez lu les ouvrages de Rousseau, vous avez dû voir que tout homme, fût-il le fils d’un prince, doit apprendre un métier manuel.
– Je n’ai pas lu l’ Émile ; car je crois que c’est dans l’ Émile que se trouve cette recommandation, n’est-ce pas?
– Oui.
– Mais j’ai entendu M. de Taverney qui se raillait de cette maxime et qui regrettait de n’avoir pas fait son fils menuisier.
– Et qu’en a-t-il fait? demanda l’étranger.
– Un officier, dit Gilbert.
Le vieillard sourit.
– Oui, ils sont tous ainsi, ces nobles: au lieu d’apprendre à leurs enfants le métier qui fait vivre, ils leur apprennent le métier qui fait mourir. Aussi, vienne une révolution, et à la suite de la révolution l’exil, ils seront obligés de mendier à l’étranger ou de vendre leur épée, ce qui est bien pis encore; mais vous qui n’êtes pas fils de noble, vous savez un état, je présume?
– Monsieur, je vous l’ai dit, je ne sais rien; d’ailleurs, je vous l’avouerai, j’ai une horreur invincible pour toute besogne imprimant au corps des mouvements rudes et brutaux.
– Ah! dit le vieillard, vous êtes paresseux, alors?
– Oh! non, je ne suis pas paresseux; car, au lieu de me faire travailler à quelque œuvre de force, donnez-moi des livres, donnez-moi un cabinet à demi noir, et vous verrez si mes jours et mes nuits ne se consument pas dans le genre de travail que j’aurai choisi.
L’étranger regarda les mains douces et blanches du jeune homme.
Читать дальше