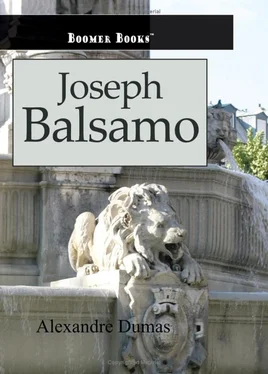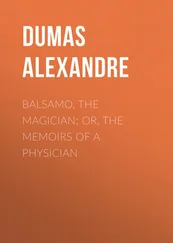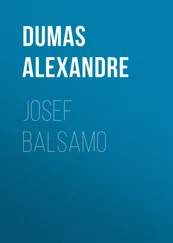– Ah! tu es tenace! dit Balsamo la bouche crispée.
– Parce que j’ai raison. Je vous demande de l’argent pour réparer, vous dis-je, et non pour vivre ou pour me consoler; pas un sou de ces vingt mille livres n’effleurera ma poche: ils ont leur destination.
– Ton enfant, je vois cela…
– Mon enfant, oui, monsieur, répliqua Gilbert avec un certain orgueil.
– Mais toi?
– Moi, je suis fort, libre et intelligent; je vivrai toujours; je veux vivre!
– Oh! tu vivras! Jamais Dieu n’a donné une volonté de cette force à des âmes qui doivent quitter prématurément la terre. Dieu habille chaudement les plantes qui ont besoin de braver de longs hivers; il donne la cuirasse d’acier aux cœurs qui ont à subir les longues épreuves. Mais tu avais, ce me semble, annoncé deux motifs pour ne pas garder mille livres: la délicatesse d’abord…
– Ensuite la prudence. Le jour où je quitterai la France, force me sera de me cacher… Ce n’est donc pas en allant trouver un capitaine dans un port, en lui remettant de l’argent – car je présume que c’est ainsi qu’on fait -, ce n’est pas, dis-je, en m’allant vendre moi-même que je réussirai à me cacher.
– Alors, tu supposes que je puis t’aider à disparaître?
– Je sais que vous le pouvez.
– Qui te l’a dit?
– Oh! vous avez trop de moyens surnaturels à votre disposition pour n’avoir pas aussi l’arsenal tout entier des moyens naturels. Un sorcier n’est jamais si sûr de lui qu’il n’ait quelque bonne porte de salut.
– Gilbert, dit tout à coup Balsamo en étendant la main sur le jeune homme, tu es un esprit aventureux, hardi; tu es pétri de bien et de mal, comme une femme; tu es stoïque et probe sans affèterie; je ferai de toi un homme très grand; demeure avec moi. Je te crois capable de reconnaissance; demeure ici, te dis-je, cet hôtel est un asile sûr; moi, d’ailleurs, je quitte l’Europe dans quelques mois, je t’emmènerai.
Gilbert écouta.
– Dans quelques mois, dit-il, je ne répondrais pas non; mais, aujourd’hui, je dois vous dire: «Merci, monsieur le comte, votre proposition est éblouissante pour un malheureux; toutefois, je la refuse.»
– La vengeance d’un moment ne vaut pas un avenir de cinquante années, peut-être?
– Monsieur, ma fantaisie ou mon caprice vaut toujours pour moi plus que tout l’univers, au moment où j’ai cette fantaisie ou ce caprice. D’ailleurs, outre la vengeance, j’ai un devoir à remplir.
– Voici tes vingt mille livres, répliqua Balsamo sans hésitation.
Gilbert prit deux billets de caisse, et, regardant son bienfaiteur:
– Vous obligez comme un roi! dit-il.
– Oh! mieux, j’espère, dit Balsamo; car je ne demande pas même qu’on me garde un souvenir.
– Bien; mais je suis reconnaissant, comme vous disiez tout à l’heure, et, lorsque ma tâche sera remplie, je vous paierai ces vingt mille livres.
– Comment?
– En me mettant à votre service autant d’années qu’il en faut à un serviteur pour payer vingt mille livres à son maître.
– Tu es encore cette fois illogique, Gilbert. Tu me disais, il n’y a qu’un moment: «Je vous demande vingt mille livres, que vous me devez .»
– C’est vrai; mais vous m’avez gagné le cœur.
– J’en suis aise, dit Balsamo sans aucune expression. Ainsi, tu seras à moi, si je veux?
– Oui.
– Que sais-tu faire?
– Rien; mais tout est dans moi.
– C’est vrai.
– Mais je veux avoir dans ma poche un moyen de quitter la France en deux heures, si besoin était.
– Ah! voilà mon service déserté.
– Je saurai bien vous revenir.
– Et je saurai bien te retrouver. Voyons, terminons là, causer si longuement me fatigue. Avance la table.
– Voici.
– Passe-moi les papiers qui sont dans ce petit carton sur le chiffonnier.
– Voici.
Balsamo prit les papiers, et lut à mi-voix les lignes sur un des papiers couvert de trois signatures, ou plutôt de trois chiffres étranges.
«Le 15 décembre, au Havre, pour Boston, P. J. l’Adonis .»
– Que penses-tu de l’Amérique, Gilbert?
– Que ce n’est pas la France, et qu’il me sera fort doux d’aller par mer, à un moment donné, dans un pays quelconque qui ne sera pas la France.
– Bien!… Vers le 15 décembre: n’est-ce pas ce moment donné dont tu parles?
Gilbert compta sur ses doigts en réfléchissant.
– Précisément, dit-il.
Balsamo prit une plume et se contenta d’écrire sur une feuille blanche ces deux lignes:
«Recevez sur l’ Adonis un passager.
Joseph Balsamo.»
– Mais ce papier est dangereux, dit Gilbert, et moi qui cherche un gîte, je pourrai bien trouver la Bastille.
– À force d’avoir de l’esprit, on ressemble à un sot, dit le comte. L’ Adonis , mon cher monsieur Gilbert, est un navire marchand dont je suis le principal armateur.
– Pardonnez-moi, monsieur le comte, dit Gilbert en s’inclinant; je suis, en effet, un misérable à qui la tête tourne quelquefois, mais jamais deux fois de suite; pardonnez-moi donc, et croyez à toute ma reconnaissance.
– Allez, mon ami.
– Adieu, monsieur le comte.
– Au revoir, dit Balsamo en lui tournant le dos.
Chapitre CLVI Dernière audience
En novembre, c’est-à-dire plusieurs mois après les événements que nous avons racontés, Philippe de Taverney sortit de grand matin pour la saison, c’est-à-dire au petit jour, de la maison qu’il habitait avec sa sœur. Déjà s’étaient éveillées, sous les lanternes encore allumées, toutes les petites industries parisiennes: les petits gâteaux fumants que le pauvre marchand de la campagne dévore comme un régal à l’air vif du matin, les hottes chargées de légumes, les charrettes pleines de poissons et d’huîtres qui courent à la halle, et, dans ce mouvement de la foule laborieuse, une sorte de réserve imposée aux travailleurs par le respect du sommeil des riches.
Philippe se hâta de traverser le quartier populeux et embarrassé qu’il habitait pour gagner les Champs-Élysées, absolument déserts.
Les feuilles tournoyaient rouillées à la cime des arbres; la plus grande partie jonchait déjà les allées battues du Cours la Reine, et les jeux de boule, abandonnés à cette heure, étaient cachés sous un épais tapis de ces feuilles frissonnantes.
Le jeune homme était vêtu, comme les bourgeois les plus aisés de Paris, d’un habit à larges basques, d’une culotte et de bas de soie; il portait l’épée; sa coiffure, très soignée, annonçait qu’il avait dû se livrer bien longtemps avant le jour aux mains du perruquier, ressource suprême de toute la beauté de cette époque.
Aussi, quand Philippe s’aperçut que le vent du matin commençait à déranger sa coiffure et à disperser la poudre, promena-t-il un regard plein de déplaisir sur l’avenue des Champs-Élysées, pour voir si quelqu’une des voitures de louage affectées au service de cette route ne se serait pas déjà mise en chemin.
Il n’attendit pas longtemps: un carrosse usé, fané, brisé, tiré par une maigre jument isabelle, commençait à cahoter la route; son cocher, à l’œil vigilant et morne, cherchait au loin un voyageur dans les arbres, comme Énée un de ses vaisseaux dans les vagues de la mer Tyrrhénienne.
En apercevant Philippe, l’automédon fit sentir plus énergiquement le fouet à sa jument; si bien que le carrosse rejoignit le voyageur.
– Arrangez-vous de façon, dit Philippe, qu’à neuf heures précises je sois à Versailles, et vous aurez un demi-écu.
À neuf heures, en effet, Philippe avait de la dauphine une de ces audiences matinales comme elle commençait à en donner. Vigilante et s’affranchissant de toute loi d’étiquette, la princesse avait l’habitude de visiter le matin les travaux qu’elle faisait exécuter dans Trianon; et, trouvant sur son passage les solliciteurs à qui elle avait accordé un entretien, elle terminait rapidement avec eux, avec une présence d’esprit et une affabilité qui n’excluaient point la dignité, parfois même la hauteur, quand elle s’apercevait qu’on se méprenait à ses délicatesses.
Читать дальше