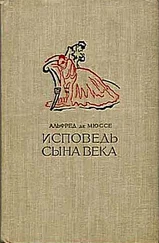Les antagonistes du Christ ont donc dit au pauvre: Tu prends patience jusqu’au jour de justice, il n’y a point de justice; tu attends la vie éternelle pour y réclamer ta vengeance, il n’y a point de vie éternelle; tu amasses dans un flacon tes larmes et celles de ta famille, les cris de tes enfants et les sanglots de ta femme, pour les porter au pied de Dieu à l’heure de ta mort; il n’y a point de Dieu.
Alors il est certain que le pauvre a séché ses larmes, qu’il a dit à sa femme de se taire, à ses enfants de venir avec lui, et qu’il s’est redressé sur la glèbe avec la force d’un taureau. Il a dit au riche: Toi qui m’opprimes, tu n’es qu’un homme; et au prêtre: Tu en as menti, toi qui m’as consolé. C’était justement là ce que voulaient les antagonistes du Christ. Peut-être croyaientils faire ainsi le bonheur des hommes, en envoyant le pauvre à la conquête de la liberté.
Mais si le pauvre, ayant bien compris une fois que les prêtres le trompent, que les riches le dérobent, que tous les hommes ont les mêmes droits, que tous les biens sont de ce monde, et que sa misère est impie; si le pauvre, croyant à lui et à ses deux bras pour toute croyance, s’est dit un beau jour: Guerre au riche! à moi aussi la jouissance ici-bas, puisque le ciel est vide! à moi et à tous, puisque tous sont égaux! ô raisonneurs sublimes qui l’avez mené là, que lui direz-vous s’il est vaincu?
Sans doute vous êtes des philanthropes, sans doute vous avez raison pour l’avenir, et le jour viendra où vous serez bénis; mais pas encore, en vérité, nous ne pouvons pas vous bénir. Lorsque autrefois l’oppresseur disait: A moi la terre! A moi le ciel, répondait l’opprimé. A présent, que répondra-t-il?
Toute la maladie du siècle présent vient de deux causes; le peuple qui a passé par 93 et par 1814 porte au cœur deux blessures. Tout ce qui était n’est plus; tout ce qui sera n’est pas encore. Ne cherchez pas ailleurs le secret de nos maux.
Voilà un homme dont la maison tombe en ruine; il l’a démolie pour en bâtir une autre. Les décombres gisent sur le champ, et il attend des pierres nouvelles pour son édifice nouveau. Au moment où le voilà prêt à tailler ses moellons et à faire son ciment, la pioche en mains, les bras retroussés, on vient lui dire que les pierres manquent et lui conseiller de reblanchir les vieilles pour en tirer parti. Que voulezvous qu’il fasse, lui qui ne veut point de ruines pour faire un nid à sa couvée? La carrière est pourtant profonde, les instruments trop faibles pour en tirer les pierres. Attendez, lui dit-on, on les tirera peu à peu; espérez, travaillez, avancez, reculez. Que ne lui dit-on pas? Et pendant ce temps-là cet homme, n’ayant plus sa vieille maison et pas encore sa maison nouvelle, ne sait comment se défendre de la pluie, ni comment préparer son repas du soir, ni où travailler, ni où reposer, ni où vivre, ni où mourir; et ses enfants sont nouveau-nés.
Ou je me trompe étrangement, ou nous ressemblons à cet homme. Ô peuples des siècles futures! lorsque, par une chaude journée d’été, vous serez courbés sur vos charrues dans les vertes campagnes de la patrie; lorsque vous verrez, sous un soleil pur et sans tache, la terre, votre mère féconde, sourire dans sa robe matinale au travailleur, son enfant bien-aimé; lorsque, essuyant sur vos fronts tranquilles le saint baptême de la sueur, vous promènerez vos regards sur votre horizon immense, où il n’y aura pas un épi plus haut que l’autre dans la moisson humaine, mais seulement des bleuets et des marguerites au milieu des blés jaunissants; ô hommes libres! quand alors vous remercierez Dieu d’être nés pour cette récolte, pensez à nous qui n’y serons plus; dites-vous que nous avons acheté bien cher le repos dont vous jouirez; plaignez-nous plus que tous vos pères; car nous avons beacoup des maux qui les rendaient dignes de plainte, et nous avons perdu ce qui les consolait.
J’ai à raconter à quelle occasion je fus pris d’abord de la maladie du siècle.
J’étais à table, à un grand souper, après une mascarade. Autour de moi mes amis richement costumés, de tous côtés des jeunes gens et des femmes, tous étincelants de beauté et de joie; à droite et à gauche des mets exquis, des flacons, des lustres, des fleurs; au-dessus de ma tête un orchestre bruyant, et en face de moi ma maîtresse, créature superbe que j’idolâtrais.
J’avais alors dix-neuf ans; je n’avais éprouvé aucun malheur ni aucune maladie; j’étais d’un caractère à la fois hautain et ouvert, avec toutes les espérances et un cœur débordant. Les vapeurs du vin fermentaient dans mes veines; c’était un de ces moments d’ivresse où tout ce qu’on voit, tout ce qu’on entend vous parle de la bien aimée. La nature entière paraît alors comme une pierre précieuse à mille facettes, sur laquelle est gravé le nom mystérieux. On embrasserait volontiers tous ceux qu’on voit sourire, et on se sent le frère de tout ce qui existe. Ma maîtresse m’avait donné rendez-vous pour la nuit, et je portais lentement mon verre à mes lèvres en la regardant.
Comme je me retournais pour prendre une assiette, ma fourchette tomba. Je me baissai pour la ramasser, et, ne la trouvant pas d’abord, je soulevai la nappe pour voir où elle avait roulé. J’aperçus alors sous la table le pied de ma maîtresse qui était posé sur celui d’un jeune homme assis à côté d’elle; leurs jambes étaient croisées et entrelacées, et ils les resserraient doucement de temps en temps.
Je me relevai parfaitement calme, demandai une autre fourchette et continuai à souper. Ma maîtresse et son voisin étaient, de leur côté, très tranquilles aussi, se parlant à peine et ne se regardant pas. Le jeune homme avait les coudes sur la table et plaisantait avec une autre femme qui lui montrait son collier et ses bracelets. Ma maîtresse était immobile, les yeux fixes et noyés de langueur. Je les observai tous deux tant que dura le repas, et je ne vis ni dans leurs gestes, ni sur leurs visages rien qui pût les trahir. A la fin, lorsqu’on fut au dessert, je fis glisser ma serviette à terre, et, m’étant baissé de nouveau, je les retrouvai dans la même position, étroitement liés l’un à l’autre.
J’avais promis à ma maîtresse de la ramener ce soir-là chez elle. Elle était veuve, et par conséquent fort libre, au moyen d’un vieux parent qui l’accompagnait et lui servait de chaperon. Comme je traversais le péristyle, elle m’appela. «Allons, Octave, me dit-elle, partons, me voilà.» Je me mis à rire et sortis sans répondre. Au bout de quelques pas, je m’assis sur une borne. Je ne sais à quoi je pensais; j’étais comme abruti et devenu idiot par l’infidélité de cette femme dont je n’avais jamais été jaloux, et sur laquelle je n’avais jamais conçu un soupçon. Ce que je venais de voir ne me laissant aucun doute, je ne me rappelle rien de ce qui s’opéra en moi durant le temps que je restai sur cette borne, sinon que, regardant machinalement le ciel et voyant une étoile filer, je saluai cette apparence fugitive, où les poètes voient un monde détruit, et lui ôtai gravement mon chapeau.
Je rentrai chez moi tranquillement, n’éprouvant rien, ne sentant rien, et comme privé de réflexion. Je commençai à me déshabiller, et me mis au lit; mais à peine eus-je posé la tête sur le chevet, que les esprits de la vengeance me saisirent avec une telle force, comme si tous les muscles de mon corps fussent devenus de bois. Je descendis de mon lit en criant, les bras étendus, ne pouvant marcher que sur les talons, tant les nerfs de mes orteils étaient crispés. Je passai ainsi près d’une heure, complètement fou et raide comme un squelette. Ce fut le premier accès de colère que j’éprouvai.
Читать дальше