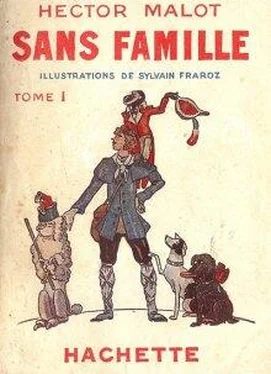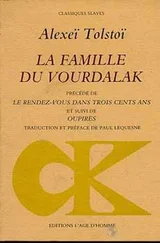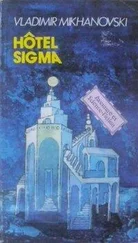Je croyais qu’on allait mettre mon maître en liberté. Mais il n’en fut rien.
Un autre magistrat parla pendant quelques minutes, puis le président, d’une voix grave, dit que le nommé Vitalis, convaincu d’injures et de voies de fait envers un agent de la force publique, était condamné à deux mois de prison et à cent francs d’amende.
Deux mois de prison !
À travers mes larmes, je vis la porte par laquelle Vitalis était entré, se rouvrir ; celui-ci suivit un gendarme, puis la porte se referma.
Deux mois de séparation.
Où aller ?
Quand je rentrai à l’auberge, le cœur gros, les yeux rouges, je trouvai sous la porte de la cour l’aubergiste qui me regarda longuement.
J’allais passer pour rejoindre les chiens, quand il m’arrêta.
— Eh bien ? me dit-il, ton maître ?
— Il est condamné.
— À combien ?
— À deux mois de prison.
— Et à combien d’amende ?
— Cent francs.
— Deux mois, cent francs, répéta-t-il à trois ou quatre reprises.
Je voulus continuer mon chemin ; de nouveau il m’arrêta.
— Et qu’est-ce que tu veux faire pendant ces deux mois ?
— Je ne sais pas, monsieur.
— Ah ! tu ne sais pas. Tu as de l’argent pour vivre et pour nourrir tes bêtes, je pense ?
— Non, monsieur.
— Alors tu comptes sur moi pour vous loger ?
— Oh ! non, monsieur, je ne compte sur personne.
Rien n’était plus vrai ; je ne comptais sur personne.
— Eh bien ! mon garçon, continua l’aubergiste, tu as raison, ton maître me doit déjà trop d’argent, je ne peux pas te faire crédit pendant deux mois sans savoir si au bout du compte je serai payé ; il faut t’en aller d’ici.
— M’en aller ! mais où voulez-vous que j’aille, monsieur ?
— Ça, ce n’est pas mon affaire : je ne suis pas ton père, je ne suis pas non plus ton maître. Pourquoi veux-tu que je te garde ?
Je restai un moment abasourdi. Que dire ? Cet homme avait raison. Pourquoi m’aurait-il gardé chez lui ? Je ne lui étais rien qu’un embarras et une charge.
— Allons, mon garçon, prends tes chiens et ton singe, puis file ; tu me laisseras, bien entendu, le sac de ton maître. Quand il sortira de prison il viendra le chercher, et alors nous réglerons notre compte.
Ce mot me suggéra une idée, et je crus avoir trouvé le moyen de rester dans cette auberge.
— Puisque vous êtes certain de faire régler votre compte à ce moment, gardez-moi jusque-là, et vous ajouterez ma dépense à celle de mon maître.
— Vraiment, mon garçon ? Ton maître pourra bien me payer quelques journées ; mais deux mois, c’est une autre affaire.
— Je mangerai aussi peu que vous voudrez.
— Et tes bêtes ? Non, vois-tu, il faut t’en aller ! Tu trouveras bien à travailler et à gagner ta vie dans les villages.
— Mais, monsieur, où voulez-vous que mon maître me trouve en sortant de prison ? C’est ici qu’il viendra me chercher.
— Tu n’auras qu’à revenir ce jour-là ; d’ici là, va faire une promenade de deux mois dans les environs, dans les villes d’eaux. À Bagnères, à Cauterets, à Luz, il y a de l’argent à gagner.
— Et si mon maître m’écrit ?
— Je te garderai sa lettre.
— Mais si je ne lui réponds pas ?
— Ah ! tu m’ennuies à la fin. Je t’ai dit de t’en aller ; il faut sortir d’ici, et plus vite que ça ! Je te donne cinq minutes pour partir ; si je te retrouve quand je vais revenir dans la cour, tu auras affaire à moi.
Je sentis bien que toute insistance était inutile. Comme le disait l’aubergiste, « il fallait sortir d’ici. »
J’entrai à l’écurie, et, après avoir détaché les chiens et Joli Cœur, après avoir bouclé mon sac et passé sur mon épaule la bretelle de ma harpe, je sortis de l’auberge.
L’aubergiste était sur sa porte pour me surveiller.
— S’il vient une lettre, me cria-t-il, je te la conserverai !
J’avais hâte de sortir de la ville, car mes chiens n’étaient pas muselés. Que répondre si je rencontrais un agent de police ? Que je n’avais pas d’argent pour leur acheter des muselières ? C’était la vérité, car, tout compte fait, je n’avais que onze sous dans ma poche, et ce n’était pas suffisant pour une pareille acquisition. Ne m’arrêterait-il pas à mon tour ? Mon maître en prison, moi aussi, que deviendraient les chiens et Joli-Cœur ? J’étais devenu directeur de troupe, chef de famille, moi, l’enfant sans famille, et je sentais ma responsabilité.
Tout en marchant rapidement les chiens levaient la tête vers moi, et me regardaient d’un air qui n’avait pas besoin de paroles pour être compris : ils avaient faim.
Joli-Cœur, que je portais juché sur mon sac, me tirait de temps en temps l’oreille pour m’obliger à tourner la tête vers lui : alors il se brossait le ventre par un geste qui n’était pas moins expressif que le regard des chiens.
Moi aussi j’aurais bien comme eux parlé de ma faim, car je n’avais pas déjeuné plus qu’eux tous ; mais à quoi bon ?
Mes onze sous ne pouvaient pas nous donner à déjeuner et à dîner, nous devions tous nous contenter d’un seul repas, qui, fait au milieu de la journée, nous tiendrait lieu des deux.
L’auberge où nous avions logé et d’où nous venions d’être chassés, se trouvant dans le faubourg Saint-Michel sur la route de Montpellier, c’était naturellement cette route que j’avais suivie.
Dans ma hâte de fuir une ville où je pouvais rencontrer des agents de police, je n’avais pas le temps de me demander où les routes conduisaient ; ce que je désirais c’était qu’elles m’éloignassent de Toulouse, le reste m’importait peu. Je n’avais pas intérêt à aller dans un pays plutôt que dans un autre ; partout on me demanderait de l’argent pour manger et pour nous loger. Encore la question du logement était-elle de beaucoup la moins importante ; nous étions dans la saison chaude et nous pouvions coucher à la belle étoile à l’abri d’un buisson ou d’un mur.
Mais manger ?
Je crois bien que nous marchâmes près de deux heures sans que j’osasse m’arrêter, et cependant les chiens me faisaient des yeux de plus en plus suppliants, tandis que Joli-Cœur me tirait l’oreille et se brossait le ventre de plus en plus fort.
Enfin je me crus assez loin de Toulouse pour n’avoir rien à craindre, ou tout au moins pour dire que je musèlerais mes chiens le lendemain si on me demandait de le faire, et j’entrai dans la première boutique de boulanger que je trouvai.
Je demandai qu’on me servît une livre et demie de pain.
— Vous prendrez bien un pain de deux livres, me dit la boulangère ; avec votre ménagerie ce n’est pas trop ; il faut bien les nourrir, ces pauvres bêtes !
Sans doute ce n’était pas trop pour ma ménagerie qu’un pain de deux livres, car sans compter Joli-Cœur, qui ne mangeait pas de gros morceaux, cela ne nous donnait qu’une demi-livre pour chacun de nous, mais c’était trop pour ma bourse.
Le pain était alors à cinq sous la livre, et si j’en prenais deux livres elles me coûteraient dix sous, de sorte que sur mes onze sous il ne m’en resterait qu’un seul.
Or je ne trouvais pas prudent de me laisser entraîner à une aussi grande prodigalité, avant d’avoir mon lendemain assuré. En n’achetant qu’une livre et demie de pain qui me coûtait sept sous et trois centimes, il me restait pour le lendemain trois sous et deux centimes, c’est-à-dire assez pour ne pas mourir de faim, et attendre une occasion de gagner quelque argent.
J’eus vite fait ce calcul et je dis à la boulangère d’un air que je tâchai de rendre assuré, que j’avais bien assez d’une livre et demie de pain et que je la priais de ne pas m’en couper davantage.
Читать дальше