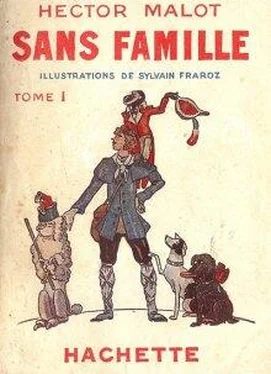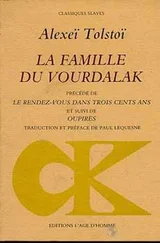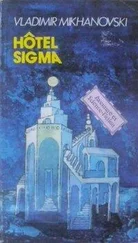— Éveille-moi, disait Mattia, qui aimait à dormir.
Et quand je l’avais éveillé, jamais il n’était long à sauter sur ses jambes.
Pour faire des économies nous avions réduit nos dépenses, et comme il faisait chaud, Mattia avait déclaré qu’il ne voulait plus manger de viande « parce qu’en été la viande est malsaine » ; nous nous contentions d’un morceau de pain avec un œuf dur que nous nous partagions, ou bien d’un peu de beurre ; et quoique nous fussions dans le pays du vin nous ne buvions que de l’eau.
Que nous importait !
Cependant Mattia avait quelquefois des idées de gourmandise.
— Je voudrais bien que madame Milligan eût encore la cuisinière qui te faisait de si bonnes tartes aux confitures, disait-il, cela doit être joliment bon, des tartes à l’abricot.
— Tu n’en as jamais mangé ?
— J’ai mangé des chaussons aux pommes, mais je n’ai jamais mangé des tartes à l’abricot, seulement j’en ai vu. Qu’est-ce que c’est que ces petites choses blanches qui sont collées sur la confiture jaune ?
— Des amandes.
— Oh !
Et Mattia ouvrait la bouche comme pour avaler une tarte entière.
Comme l’Yonne fait beaucoup de détours entre Joigny et Auxerre, nous regagnâmes, nous qui suivions la grande route, un peu de temps sur le Cygne ; mais, à partir d’Auxerre, nous en reperdîmes, car le Cygne ayant pris le canal du Nivernais avait couru vite sur ses eaux tranquilles.
À chaque écluse nous avions de ses nouvelles, car sur ce canal où la navigation n’est pas très-active, tout le monde avait remarqué ce bateau qui ressemblait si peu à ceux qu’on voyait ordinairement.
Non-seulement on nous parlait du Cygne, mais on nous parlait aussi de madame Milligan « une dame anglaise très-bonne » et d’Arthur « un jeune garçon qui se tenait presque toujours couché dans un lit placé sur le pont, à l’abri d’une verandah garnie de verdure et de fleurs, mais qui se levait aussi quelquefois. »
Arthur était donc mieux.
Nous approchions de Dreuzy ; encore deux jours, encore un, encore quelques heures seulement.
Enfin nous apercevons les bois dans lesquels nous avons joué avec Lise à l’automne précédent, et nous apercevons aussi l’écluse avec la maisonnette de dame Catherine.
Sans nous rien dire, mais d’un commun accord, nous avons forcé le pas, Mattia et moi, nous ne marchons plus, nous courons ; Capi, qui se retrouve, a pris les devants au galop.
Il va dire à Lise que nous arrivons : elle va venir au-devant de nous.
Cependant ce n’est pas Lise que nous voyons sortir de la maison, c’est Capi qui se sauve comme si on l’avait chassé.
Nous nous arrêtons tous les deux instantanément, et nous nous demandons ce que cela peut signifier ; que s’est-il passé ? Mais cette question nous ne la formulons ni l’un ni l’autre, et nous reprenons notre marche.
Capi est revenu jusqu’à nous et il s’avance, penaud, sur nos talons.
Un homme est en train de manœuvrer une vanne de l’écluse, ce n’est pas l’oncle de Lise.
Nous allons jusqu’à la maison, une femme que nous ne connaissons pas va et vient dans la cuisine.
— Madame Suriot ? demandons-nous.
Elle nous regarde un moment avant de nous répondre, comme si nous lui posions une question absurde.
— Elle n’est plus ici, nous dit-elle à la fin.
— Et où est-elle ?
— En Égypte.
Nous nous regardons Mattia et moi interdits. En Égypte ! Nous ne savons pas au juste ce que c’est que l’Égypte, et où se trouve ce pays, mais vaguement nous pensons que c’est loin, très-loin, quelque part au delà des mers.
— Et Lise ? Vous connaissez Lise ?
— Pardi : Lise est partie en bateau avec une dame anglaise.
Lise sur le Cygne ! Rêvons-nous ?
La femme se charge de nous répondre que nous sommes dans la réalité.
— C’est vous Rémi ? me demande-t-elle.
— Oui.
— Eh bien, quand Suriot a été noyé, nous dit-elle.
— Noyé !
— Noyé dans l’écluse. Ah ! vous ne saviez pas que Suriot était tombé à l’eau et qu’étant passé sous une péniche, il était resté accroché à un clou : c’est le métier qui veut ça trop souvent. Pour lors, quand il a été noyé, Catherine s’est trouvée bien embarrassée quoiqu’elle fût une maîtresse femme. Mais que voulez-vous, quand l’argent manque, on ne peut pas le fabriquer du jour au lendemain ; et l’argent manquait. Il est vrai qu’on offrait à Catherine d’aller en Égypte pour élever les enfants d’une dame dont elle avait été la nourrice, mais ce qui la gênait c’était sa nièce, la petite Lise. Comme elle était à se demander ce qu’il fallait faire, voilà qu’un soir s’arrête à l’écluse une dame anglaise qui promenait son garçon malade. On cause. Et la dame anglaise qui cherchait un enfant pour jouer avec son fils qui s’ennuyait tout seul sur son bateau, demande qu’on lui donne Lise, en promettant de se charger d’elle, de la faire guérir, enfin de lui assurer un sort. C’était une brave dame, bien bonne, douce au pauvre monde. Catherine accepte, et tandis que Lise s’embarque sur le bateau de la dame anglaise, Catherine part pour s’en aller en Égypte C’est mon mari qui remplace Suriot. Alors avant de partir, Lise qui ne peut pas parler quoique les médecins disent qu’elle parlera sans doute un jour, alors Lise veut que sa tante m’explique que je dois vous raconter tout cela si vous venez pour la voir. Et voilà.
J’étais tellement abasourdi, que je ne trouvai pas un mot, mais Mattia ne perdit pas la tête comme moi :
— Et où la dame anglaise allait-elle ? demanda-t-il.
— Dans le midi de la France ou bien en Suisse ; Lise devait me faire écrire pour que je vous donne son adresse, mais je n’ai pas reçu de lettre.
Chapitre 22
Les beaux langes ont dit vrai
Comme je restais interdit, Mattia fit ce que je ne pensais pas à faire.
— Nous vous remercions bien, madame, dit-il.
Et me poussant doucement, il me mit hors la cuisine.
— En route, me dit-il, en ayant ! Ce n’est plus seulement Arthur et madame Milligan que nous avons à rejoindre, c’est encore Lise. Comme cela se trouve bien ! Nous aurions perdu du temps à Dreuzy tandis que maintenant nous pouvons continuer notre chemin ; c’est ce qui s’appelle une chance. Nous en avons eu assez de mauvaises, maintenant nous en avons de bonnes ; le vent a changé. Qui sait tout ce qui va nous arriver d’heureux !
Et nous continuons notre course après le Cygne, sans perdre de temps, ne nous arrêtant juste que ce qu’il faut pour dormir et pour gagner quelques sous.
À Decize, où le canal du Nivernais débouche dans la Loire, nous demandons des nouvelles du Cygne : il a pris le canal latéral ; et c’est ce canal que nous suivons jusqu’à Digoin ; là nous prenons le canal du Centre jusqu’à Chalon.
Ma carte me dit que si par Charolles nous nous dirigions directement sur Mâcon, nous éviterions un long détour et bien des journées de marche ; mais c’est là une résolution hardie dont nous n’osons ni l’un ni l’autre nous charger après avoir discuté le pour et le contre, car le Cygne peut s’être arrêté en route et alors nous le dépassons ; il faudrait donc revenir sur nos pas, et pour avoir voulu gagner du temps, en perdre.
Nous descendons la Saône depuis Chalon jusqu’à Lyon.
C’est là qu’une difficulté vraiment sérieuse se présente : le Cygne a-t-il descendu le Rhône ou bien l’a-t-il remonté ? en d’autres termes madame Milligan a-t-elle été en Suisse ou dans le midi de la France ?
Au milieu du mouvement des bateaux qui vont et viennent sur le Rhône et sur la Saône, le Cygne peut avoir passé inaperçu : nous questionnons les mariniers, les bateliers et tous les gens qui vivent sur les quais, et à la fin nous obtenons la certitude que madame Milligan a gagné la Suisse ; nous suivons donc le cours du Rhône.
Читать дальше