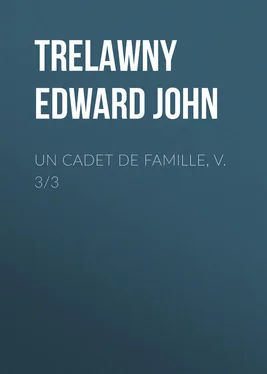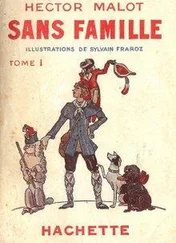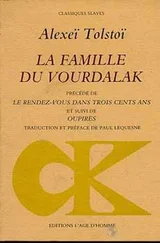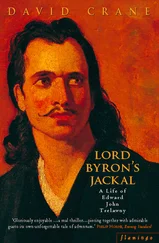Edward Trelawny - Un Cadet de Famille, v. 3/3
Здесь есть возможность читать онлайн «Edward Trelawny - Un Cadet de Famille, v. 3/3» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: literature_19, foreign_antique, foreign_prose, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Un Cadet de Famille, v. 3/3
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Un Cadet de Famille, v. 3/3: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Un Cadet de Famille, v. 3/3»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Un Cadet de Famille, v. 3/3 — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Un Cadet de Famille, v. 3/3», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
– Saisissez le scélérat! m'écriai-je d'un ton furieux.
À cet ordre, le Français rougit de colère et appela ses compatriotes.
Je n'attendis pas l'arrivée des mutins; je saisis d'une main ferme le rebelle, et j'enfonçai dans son cœur mon poignard malais.
– Allez à vos devoirs, dis-je d'une voix calme et froide aux Français accourus sur le pont, allez, et sans mot dire. Votre chef est mort, et je punirai ainsi tous ceux qui auront l'audace de me désobéir.
Les Français obéirent en grondant; mais, depuis ce coup de maître, ma domination fut entière, absolue, et je n'eus qu'à me féliciter de mon énergique détermination; car, malgré ma colère, je n'avais point été poussé au meurtre par la violence, je n'avais que saisi un instant propice à l'exécution d'un projet depuis longtemps médité.
XCVIII
Nous parcourûmes le long de la côte de l'est afin de découvrir une baie où, d'après ma carte maritime, se trouvait un ancrage; là, je devais prendre de nouvelles provisions et de l'eau, et continuer tranquillement ma course. Nous marchions aussi près que possible du rivage, afin de profiter des vents de la terre; mais ils étaient si faibles, que pendant plusieurs jours nous fûmes forcés de rester stationnaires. Les eaux de la mer semblaient pétrifiées, tant elles étaient unies et calmes; de plus, la chaleur était si étouffante, que les Raipoots, qui adorent le soleil, se débattaient sur le pont pour conquérir un pied carré de l'ombre de la banne. Le seul rafraîchissement qui eût la puissance de calmer un peu mes douleurs de corps et de tête était un bain pris d'heure en heure; malgré ce soin, mes lèvres et ma peau étaient aussi gercées que l'écorce d'un prunier. Il n'y a point de vaisseau qui soit si mal adapté pour un climat chaud qu'un schooner; il lui faut beaucoup d'hommes pour la manœuvre, et, pour le contenir, il a beaucoup moins de place que tout autre bâtiment.
Comme les calmes de la vie, les calmes de la mer sont passagers et rares; il faut toujours qu'une brise, qu'une rafale ou une tempête suive son repos. Bientôt, aussi tendres que la voix d'un amoureux, les vents vinrent caresser les vagues endormies, et nous passâmes doucement le long du rivage pour gagner notre ancrage près de Balamhua, en dedans de l'île d'Abaran. Là, nous trouvâmes une rive sablonneuse, une petite rivière et un bois si largement fourni, qu'on eût pu croire que les arbres verdoyants étaient amoureux de l'écume des eaux. Un petit village javanais se trouvait à l'embouchure de la rivière, et, en échange d'une petite quantité d'eau-de-vie et de poudre, le chef de ce village nous donna la permission de prendre sur l'île toutes les choses dont nous aurions besoin. Nous débarquâmes nos tonneaux d'eau vides, et mes hommes s'occupèrent, sous la direction du charpentier, à abattre les plus beaux arbres.
Les calmes, l'excessive chaleur et le manque d'air avaient contribué à propager la fièvre et la dyssenterie dans mon équipage, et pour remède j'avais ordonné l'éther, l'opium et de bon vin pour les convalescents. Désespéré de mon ignorance, je regrettais vivement de n'avoir apporté aucune attention aux discours médicaux de Van Scolpvelt, je regrettais encore d'avoir si bien négligé mes études. En dépit de cette ignorance, je continuais mon rôle de docteur, et cependant je n'avais, pour en dissimuler les fautes, ni perruque doctorale, ni canne à pomme d'or, et je droguais les malades avec aussi peu de contrition que les membres du collége royal des médecins.
En faisant mes préparatifs de départ, j'appris qu'une dispute avait eu lieu entre quelques-uns de mes hommes et les Javanais. Deux natifs avaient été blessés par un coup de fusil, et ces emportements meurtriers étaient fréquents, parce que les matelots ne voulaient pas comprendre que sur terre ils étaient sujets à des lois d'ordre et de discipline.
– Sur le vaisseau, disaient-ils, nous sommes liés par des devoirs, nous appartenons à la mer; mais, en revanche, il faut que sur terre nous fassions notre volonté. Quand nous avons de l'argent, nous sommes assez justes pour payer nos dépenses ou nos dégâts; mais quand nous n'en avons pas, on doit nous donner les choses qui nous sont nécessaires. Il n'est pas légal, ajoutaient-ils en forme de péroraison, que les natifs gardent pour eux toutes les productions du rivage, puisque, aussi bien que la mer, la terre appartient aux hommes.
Ce raisonnement était l'invariable réponse que j'obtenais de mes hommes lorsque je les sermonnais sur la brutalité avec laquelle ils assaillaient, volaient et massacraient les natifs.
L'impossibilité dans laquelle j'étais de me faire tout à fait obéir amenait de si grandes querelles, que je me vis contraint de récompenser les plus cruellement battus, sans pouvoir punir les tourmenteurs.
Un jour cependant il me fut rapporté que dans une nouvelle bataille le tort était du côté des villageois; je ne pus connaître toute la vérité, mais je craignis une revanche sanglante; pour l'éviter, je pris sur un bateau quelques objets de valeur pour le chef et je me dirigeai vers le village. Mon cadeau fut assez mal accueilli; cependant, après une heure d'explications, je réussis à pallier les torts de mes hommes, et nous nous quittâmes amis. Je tenais beaucoup à cette réconciliation, car l'inimitié des natifs eût pu me causer de grandes pertes de temps, d'hommes et de provisions.
Quand mes préparatifs de départ furent achevés, le chef javanais vint à bord du schooner, et m'invita à l'accompagner dans une partie de l'île où se trouvait une grande quantité de daims et de sangliers. J'avais déjà manifesté le désir de faire une partie de chasse, mais le chef en avait toujours différé la réalisation en disant qu'il était bon d'attendre les jours pluvieux, parce que la pluie chasse les animaux de la montagne vers la plaine. Comme un violent orage venait d'inonder la terre, l'invitation du chef me parut le résultat d'une promesse faite. Je lui donnai donc avec le plus grand plaisir l'heure de notre départ pour cette vaillante promenade. D'un air affectueux et sincère, le chef me supplia de ne pas faire naître parmi son peuple des craintes jalouses en emmenant avec moi une grande quantité d'hommes armés.
Je m'engageai à suivre ses conseils sur ce point, et nous nous séparâmes en nous donnant rendez-vous pour le lendemain.
XCIX
J'étais réellement sans crainte, et aucune méfiance ne pénétra mon esprit. Néanmoins je pris les précautions les plus minutieuses pour assurer le salut de mes hommes et le mien.
Je débarquai le lendemain, accompagné de quatorze marins, tous fidèles, braves, courageux et bien armés. En outre, j'ordonnai aux bateaux qui nous avaient conduits de s'éloigner du rivage, de jeter le grappin, et d'avoir la prudence de ne point adresser la parole aux natifs.
Le chef m'attendait accompagné seulement de cinq hommes, armés de poignards et de lances de sanglier.
Nous pénétrâmes dans l'intérieur du pays en suivant les sinuosités de la petite rivière, que la pluie d'orage avait rendue jaunâtre et boueuse. Nous fûmes obligés plusieurs fois de traverser la rivière à gué, et, avant d'effectuer ce passage, je dis à mes hommes de mettre dans leurs casquettes les balles et la poudre, et de ne point mouiller leurs armes. L'expérience m'avait rendu vigilant et soupçonneux, si bien que je remarquai plusieurs choses qu'une personne moins attentionnée eût laissées passer inaperçues. Le chef javanais causait souvent avec ses hommes, souvent encore il voulait nous faire traverser la rivière dans des endroits où elle était boueuse et remplie de trous profonds. Tout à coup, et sans m'expliquer les causes de ce changement, il se mit à l'arrière de la troupe et voulut diriger notre marche d'un côté opposé à celui que nous devions suivre. Cette conduite éveilla mes soupçons, et sans rien dire je me mis à surveiller tous les mouvements du chef. Afin de laisser croire au Javanais que j'avais en lui la plus entière confiance, je le suivis sans observation. Mais j'avais le soin de noter dans ma mémoire les localités que nous traversions, ainsi que les gués de la rivière. Le danger dans lequel j'avais placé Zéla en l'emmenant avec moi à la chasse aux tigres m'avait donné une cruelle leçon de prudence, et l'idée de la savoir seule, quoique en sûreté sur le schooner, me rendait sage, sensé, et surtout fort méfiant. Grâce aux importunités de ma chère petite fée, j'avais pris avec nous Adoa la Malaise. Cette enfant était vive, adroite et rusée comme un lutin. On pouvait avoir en son instinct sauvage la plus entière confiance. Adoa ne pensait, n'aimait personne au monde que sa chère Zéla; pour Zéla elle eût donné sa vie. La seule chose qui l'attachât à moi était l'amour que me portait ma femme. Adoa avait à peu près le même âge que sa maîtresse; mais il n'y avait pas dans le monde deux êtres moins ressemblants: la fille malaise était rabougrie dans sa croissance, large et osseuse; son front bas était à moitié caché par des cheveux noirs, rudes et qui tombaient en mèches roides sur sa figure plate et d'une couleur bistrée. Les petits yeux bruns d'Adoa semblaient, par la distance qui les séparait, être tout à fait indépendants l'un de l'autre et pouvaient regarder à la fois à bâbord et à tribord, au nord et au sud. Ces yeux vifs, brillants, avaient la vigilance de ceux d'un serpent; mais la ressemblance avec ce hideux reptile s'arrêtait là, car la pauvre petite Adoa était la plus fidèle, la plus aimante et la plus dévouée des servantes. J'aimais tant cette sauvage créature que je lui avais donné la place haute et importante de tchibookgée , et elle était sans rivale dans l'art de faire un chilau , un hookah, ou pour préparer un callian, toutes choses qui sont difficiles à bien faire.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Un Cadet de Famille, v. 3/3»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Un Cadet de Famille, v. 3/3» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Un Cadet de Famille, v. 3/3» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.