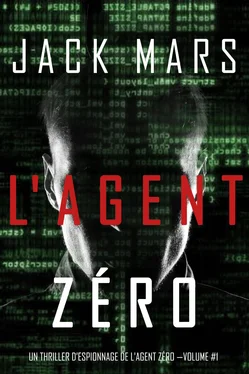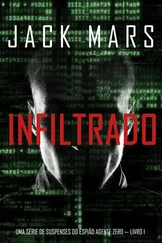Reid ouvrit le téléphone, en retira la carte SIM et la cassa en deux. Il laissa tomber les morceaux dans une grille d’égout. Reprenant sa marche dans la rue, il déposa la batterie dans une poubelle, et les deux parties du téléphone dans d’autres.
Il savait qu’il avançait en direction de la Rue de Stalingrad, même s’il n’avait aucune idée de ce qu’il ferait une fois qu’il y serait. Son cerveau lui hurlait de changer de direction, d’ailler n’importe où ailleurs. Pourtant, le sang-froid dans son subconscient l’exhortait à continuer.
Ses ravisseurs lui avaient demandé ce qu’il savait de leurs “plans.” Les lieux à propos desquels ils l’avaient questionné (Zagreb, Madrid et Téhéran), il devait y avoir un lien entre eux et ils étaient clairement liés aussi aux hommes qui l’avaient enlevé. Quelles que soient ses visions (il refusait toujours de les reconnaître comme étant autre chose), elles étaient au courant de quelque chose qui s’était soit déjà passé, soit qui allait se produire. Mais cette connaissance, il ne la possédait pas. Plus il y réfléchissait et plus il sentait dans son esprit qu’il y avait urgence.
Non, c’était même plus fort que ça. Il lui semblait que c’était une obligation.
Ses ravisseurs lui avaient paru résolus à le tuer à petit feu pour obtenir des réponses. Et il avait la sensation que, s’il ne découvrait pas ce dont il s’agissait et ce qu’il était censé savoir, beaucoup de gens allaient mourir.
“Monsieur.” Les réflexions de Reid furent stoppées par une femme emmitouflée dans un manteau et une écharpe, lui touchant gentiment le bras. “Vous saignez,” dit-elle en anglais, montrant son propre sourcil.
“Oh. Merci.” Il toucha son sourcil droit du bout des doigts. Une petite coupure avait imbibé le pansement et une goutte de sang était en train de couler sur son visage. “Il faut que je trouve une pharmacie,” murmura-t-il.
Puis, il eut le souffle coupé en réalisant quelque chose : il y avait une pharmacie pas loin et il fallait juste descendre deux rues et en remonter une autre. Il n’était jamais rentré dedans, du moins pas à sa connaissance, à laquelle on ne pouvait pas se fier d’ailleurs. Pourtant, il le savait, tout simplement, aussi bien qu’il connaissait la route pour se rendre au Pap’s Deli.
Un frisson parcourut son dos de bas en haut. Les autres visions avaient été viscérales et s’étaient toutes manifestées par des stimuli externes : des visions, des bruits et même des odeurs. Cette fois, aucune vision n’était venue accompagner ça. Il s’agissait véritablement d’un souvenir, de la même manière qu’il avait su où tourner à chaque panneau de rue, de la même manière qu’il savait comment charger le Beretta.
Il prit une décision avant que le feu piéton ne passe au vert. Il irait au rendez-vous dans l’idée d’obtenir toutes les informations possibles. Ensuite, il déciderait quoi en faire : peut-être les donner aux autorités et laver son nom en échange pour le meurtre des quatre hommes dans le sous-sol. Les laisser procéder aux arrestations pendant qu’il rentrerait chez lui retrouver ses filles.
Une fois à la pharmacie, il acheta un petit tube de super glue, une boîte de pansements papillon, des cotons-tiges et un fond de teint correspondant le plus possible à sa carnation de peau. Il emporta ses achats dans les toilettes et en verrouilla la porte.
Il décolla les pansements qu’il s’était mis n’importe comment sur le visage, dans l’appartement, et lava les croûtes de sang de ses blessures. Sur les coupures les plus petites, il appliqua les pansements papillon. Pour les blessures plus profondes qui auraient normalement nécessité des points de suture, il rapprocha les bords de la peau et y colla une bande de super glue, sifflant entre ses dents en même temps. Puis, il retint son souffle environ trente secondes. La glue le brûlait vivement, mais la douleur diminuait au séchage. Pour finir, il étala le fond de teint sur les contours de son visage, en particulier aux endroits que ses anciens ravisseurs sadiques avaient arrangés à leur sauce. Il n’était pas possible de camoufler totalement son œil enflé et sa mâchoire tuméfiée. Mais ainsi, au moins, il y aurait moins de gens pour le regarder bizarrement dans la rue.
La totalité des opérations prit environ une demi-heure et, deux fois dans cet intervalle de temps, des clients frappèrent à la porte des toilettes (la deuxième fois, une femme hurla en français que son enfant était sur le point de se pisser dessus). Par deux fois, Reid se contenta de crier, “Occupé !”
Enfin, une fois sa tâche achevée, il s’examina de nouveau dans le miroir. Il était loin d’être parfait mais, au moins, il n’avait plus l’air d’avoir été battu dans une cellule de torture souterraine. Il se demandait s’il aurait dû choisir un fond de teint plus sombre, quelque chose qui lui aurait donné l’air plus étranger. Est-ce que l’homme au bout du fil savait qui il allait rencontrer ? Allaient-ils le reconnaître ou reconnaître la personne qu’ils le croyaient être ? Les trois hommes qui étaient venus chez lui avaient semblé hésitants et avaient vérifié sur une photographie.
“Qu’est-ce que je fous ?” se demanda-t-il. Tu te prépares à rencontrer un dangereux criminel qui est certainement un terroriste notoire, dit une voix dans sa tête, pas cette nouvelle voix intrusive, mais sa propre voix, celle de Reid Lawson. C’était son propre bon sens qui se moquait de lui.
Puis cette personnalité sûre et affirmée, celle qui se trouvait juste en-dessous de la surface, reprit la parole. Tout ira bien, lui dit-elle. Rien que tu n’aies déjà fait avant. Sa main saisit instinctivement le manche du Beretta enfoncé à l’arrière de son jean, caché par son nouveau blouson. Tu connais tout ça.
Avant de quitter la pharmacie, il acheta quelques articles supplémentaires : une montre pas chère, une bouteille d’eau et deux barres de chocolat. Une fois de retour sur le trottoir, il dévora les deux barres chocolatées. Il ne savait pas combien de sang il avait perdu, et il voulait être sûr de faire remonter son taux de sucre. Il vida la totalité de la bouteille d’eau d’un trait, puis demanda l’heure à un passant. Il mit sa montre à l’heure et la glissa autour de son poignet.
Il était dix-huit heures trente. Il avait du temps devant lui pour se rendre en avance au rendez-vous et pour s’y préparer.
*
Il faisait presque nuit quand il arriva à l’adresse qu’on lui avait donnée au téléphone. Le coucher de soleil sur Paris projetait de longues ombres sur le boulevard. Le 187 Rue de Stalingrad était un bar du 10ème arrondissement portant le nom de Féline, un tripot de boîte de nuit aux vitres recouvertes de peinture et à la façade fissurée. Il était situé dans une rue autrement remplie de studios d’art, de restaurants indiens et de cafés bohèmes.
Reid s’arrêta, la main sur la porte. S’il entrait, il ne pourrait pas faire machine arrière. Il pouvait encore passer son chemin. Non, décida-t-il, il ne le pouvait pas. Où irait-il ? Chez lui pour qu’ils viennent de nouveau le chercher ? Et pour vivre avec ces étranges visions dans sa tête ?
Il entra à l’intérieur.
Les murs du bar étaient peints en noir et rouge, recouverts de posters des années 50 à l’effigie de silhouettes, de pin-up souriantes et de publicités pour des cigarettes. Il était trop tôt, ou peut-être trop tard, pour que l’endroit soit fréquenté. Les rares clients autour de lui parlaient à voix basse, repliés sur leur boisson en guise de protection. Un air de blues mélancolique émanait doucement d’un poste stéréo derrière le comptoir.
Reid balaya de nouveau la pièce du regard, de gauche à droite. Personne ne regardait dans sa direction et il n’y avait apparemment personne qui ressemblait aux types qui l’avaient pris en otage. Il s’installa à une petite table dans le fond de la pièce et s’assit face à la porte d’entrée. Il commanda un café, qui arriva encore fumant presque immédiatement devant lui.
Читать дальше