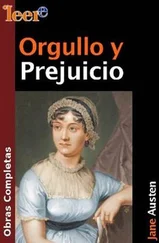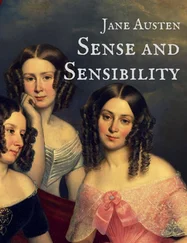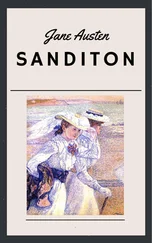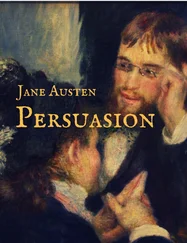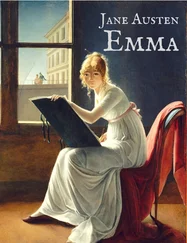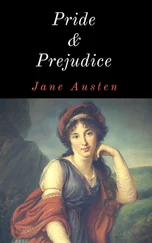Miss de Bourgh n’offrait aucune ressemblance avec sa mère et Elizabeth fut presque aussi étonnée que Maria de sa petite taille et de sa maigreur. Elle parlait peu, si ce n’est à voix basse en s’adressant à Mrs. Jenkinson. Celle-ci, personne d’apparence insignifiante, était uniquement occupée à écouter miss de Bourgh et à lui rendre de menus services.
Au bout de quelques minutes lady Catherine invita ses visiteurs à se rendre tous à la fenêtre pour admirer la vue. Mr. Collins s’empressa de leur détailler les beautés du paysage tandis que lady Catherine les informait avec bienveillance que c’était beaucoup plus joli en été.
Le repas fut magnifique. On y vit tous les domestiques, toutes les pièces d’argenterie que Mr. Collins avait annoncés. Comme il l’avait également prédit, sur le désir exprimé par lady Catherine, il prit place en face d’elle, marquant par l’expression de son visage qu’en ce monde, aucun honneur plus grand ne pouvait lui échoir. Il découpait, mangeait, et faisait des compliments avec la même allégresse joyeuse. Chaque nouveau plat était d’abord célébré par lui, puis par sir William qui, maintenant remis de sa première émotion, faisait écho à tout ce que disait son gendre. À la grande surprise d’Elizabeth, une admiration aussi excessive paraissait enchanter lady Catherine qui souriait gracieusement. La conversation n’était pas très animée. Elizabeth aurait parlé volontiers si elle en avait eu l’occasion, mais elle était placée entre Charlotte et miss de Bourgh : la première était absorbée par l’attention qu’elle prêtait à lady Catherine et la seconde n’ouvrait pas la bouche. Mrs. Jenkinson ne parlait que pour remarquer que miss de Bourgh ne mangeait pas, et pour exprimer la crainte qu’elle ne fût indisposée. Maria n’aurait jamais osé dire un mot, et les deux messieurs ne faisaient que manger et s’extasier.
De retour au salon, les dames n’eurent qu’à écouter lady Catherine qui parla sans interruption jusqu’au moment où le café fut servi, donnant son avis sur toutes choses d’un ton qui montrait qu’elle ignorait la contradiction. Elle interrogea familièrement Charlotte sur son intérieur et lui donna mille conseils pour la conduite de son ménage et de sa basse-cour. Elizabeth vit qu’aucun sujet n’était au-dessus de cette grande dame, pourvu qu’elle y trouvât une occasion de diriger et de régenter ses semblables. Entre temps, elle posa toutes sortes de questions aux deux jeunes filles et plus particulièrement à Elizabeth sur le compte de laquelle elle se trouvait moins renseignée et qui, observa-t-elle à Mrs. Collins, « paraissait une petite jeune fille gentille et bien élevée ».
Elle lui demanda combien de sœurs elle avait, si aucune n’était sur le point de se marier, si elles étaient jolies, où elles avaient été élevées, quel genre d’équipage avait son père et quel était le nom de jeune fille de sa mère. Elizabeth trouvait toutes ces questions assez indiscrètes mais y répondit avec beaucoup de calme. Enfin lady Catherine observa :
– Le domaine de votre père doit revenir à Mr. Collins, n’est-ce pas ? – J’en suis heureuse pour vous, dit-elle en se tournant vers Charlotte, – autrement je n’approuve pas une disposition qui dépossède les femmes héritières en ligne directe. On n’a rien fait de pareil dans la famille de Bourgh. Jouez-vous du piano et chantez-vous, miss Bennet ?
– Un peu.
– Alors, un jour ou l’autre nous serons heureuses de vous entendre. Notre piano est excellent, probablement supérieur à... Enfin, vous l’essaierez. Vos sœurs, sont-elles aussi musiciennes ?
– L’une d’elles, oui, madame.
– Pourquoi pas toutes ? Vous auriez dû prendre toutes des leçons. Les demoiselles Webb sont toutes musiciennes et leur père n’a pas la situation du vôtre. Faites-vous du dessin ?
– Pas du tout.
– Quoi, aucune d’entre vous ?
– Aucune.
– Comme c’est étrange ! Sans doute l’occasion vous aura manqué. Votre mère aurait dû vous mener à Londres, chaque printemps, pour vous faire prendre des leçons.
– Je crois que ma mère l’eût fait volontiers, mais mon père a Londres en horreur.
– Avez-vous encore votre institutrice ?
– Nous n’en avons jamais eu.
– Bonté du ciel ! cinq filles élevées à la maison sans institutrice ! Je n’ai jamais entendu chose pareille ! Quel esclavage pour votre mère !
Elizabeth ne put s’empêcher de sourire et affirma qu’il n’en avait rien été.
– Alors, qui vous faisait travailler ? Qui vous surveillait ? Sans institutrice ? Vous deviez être bien négligées.
– Mon Pieu, madame, toutes celles d’entre nous qui avaient le désir de s’instruire en ont eu les moyens. On nous encourageait beaucoup à lire et nous avons eu tous les maîtres nécessaires. Assurément, celles qui le préféraient étaient libres de ne rien faire.
– Bien entendu, et c’est ce que la présence d’une institutrice aurait empêché. Si j’avais connu votre mère, j’aurais vivement insisté pour qu’elle en prît une. On ne saurait croire le nombre de familles auxquelles j’en ai procuré. Je suis toujours heureuse, quand je le puis, de placer une jeune personne dans de bonnes conditions. Grâce à moi quatre nièces de Mrs. Jenkinson ont été pourvues de situations fort agréables. Vous ai-je dit, mistress Collins, que lady Metcalfe est venue me voir hier pour me remercier ? Il paraît que miss Pape est une véritable perle. Parmi vos jeunes sœurs, y en a-t-il qui sortent déjà, miss Bennet ?
– Oui, madame, toutes.
– Toutes ? Quoi ? Alors toutes les cinq à la fois ! Et vous n’êtes que la seconde, et les plus jeunes sortent avant que les aînées soient mariées ? Quel âge ont-elles donc ?
– La dernière n’a pas encore seize ans. C’est peut-être un peu tôt pour aller dans le monde, mais, madame, ne serait-il pas un peu dur pour des jeunes filles d’être privées de leur part légitime de plaisirs parce que les aînées n’ont pas l’occasion ou le désir de se marier de bonne heure ?
– En vérité, dit lady Catherine, vous donnez votre avis avec bien de l’assurance pour une si jeune personne. Quel âge avez-vous donc ?
– Votre Grâce doit comprendre, répliqua Elizabeth en souriant, qu’avec trois jeunes sœurs qui vont dans le monde, je ne me soucie plus d’avouer mon âge.
Cette réponse parut interloquer lady Catherine. Elizabeth était sans doute la première créature assez téméraire pour s’amuser de sa majestueuse impertinence.
– Vous ne devez pas avoir plus de vingt ans. Vous n’avez donc aucune raison de cacher votre âge.
– Je n’ai pas encore vingt et un ans.
Quand les messieurs revinrent et qu’on eut pris le thé, les tables de jeu furent apportées. Lady Catherine, sir William, Mr. et Mrs. Collins s’installèrent pour une partie de « quadrille ». Miss de Bourgh préférait le « casino » ; les deux jeunes filles et Mrs. Jenkinson eurent donc l’honneur de jouer avec elle une partie remarquablement ennuyeuse. On n’ouvrait la bouche, à leur table, que pour parler du jeu, sauf lorsque Mrs. Jenkinson exprimait la crainte que miss de Bourgh eût trop chaud, trop froid, ou qu’elle fût mal éclairée.
L’autre table était beaucoup plus animée. C’était lady Catherine qui parlait surtout pour noter les fautes de ses partenaires ou raconter des souvenirs personnels. Mr. Collins approuvait tout ce que disait Sa Grâce, la remerciant chaque fois qu’il gagnait une fiche et s’excusant lorsqu’il avait l’impression d’en gagner trop. Sir William parlait peu : il tâchait de meubler sa mémoire d’anecdotes et de noms aristocratiques.
Lorsque lady Catherine et sa fille en eurent assez du jeu, on laissa les cartes, et la voiture fut proposée à Mrs. Collins qui l’accepta avec gratitude. La société se réunit alors autour du feu pour écouter lady Catherine décider quel temps il ferait le lendemain, puis, la voiture étant annoncée, Mr. Collins réitéra ses remerciements, sir William multiplia les saluts, et l’on se sépara.
Читать дальше