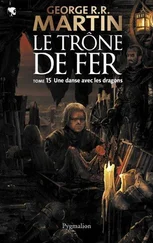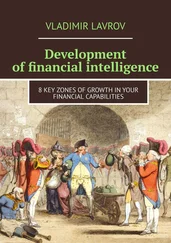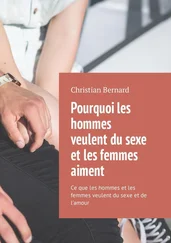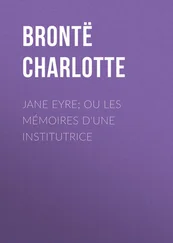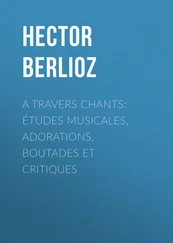ibidem-Press, Stuttgart
Les éditeurs de cet ouvrage Jean-Bernard Ouédraogo, Benoit Hazard et Abel Kouvouama expriment leur profonde gratitude aux institutions et aux personnels techniques des laboratoires et centres suivants :
L’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (IIAC UMR-CNRS 8177) de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) de Paris, en particulier à Madame Sophie Wahnich, sa directrice, ainsi que l’ensemble des collègues de ce laboratoire pour le soutien technique et financier apporté aux Journées d’étude, ainsi que pour la publication du présent ouvrage.
Le Laboratoire Identités, Territoires, Expressions, Mobilités (ITEM) de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, particulièrement les collègues Joëlle Sauces et Françoise Duplaa pour l’appui humain, technique et matériel et des documents préparatoires aux Journées d’étude des 11 et 12 juin 2019 consacrées à l’œuvre de Jean Copans.
Les Cahiers d’études africaines et particulièrement Benoit Hazard et Éloi Ficquet, les corédacteurs en chef de la revue, pour leur soutien.
La Fondation Maison des sciences de l’homme et son président, Michel Wieviorka, pour avoir accepté d’ouvrir les Journées d’étude et de mettre à disposition la salle des séminaires pour la tenue de celles-ci.
Les éditeurs expriment leurs vifs remerciements aux collègues ci-dessous nommés pour leur participation active aux Journées d’étude des 11 et 12 juin 2019 consacrées à l’œuvre de Jean Copans :
Michel Wieviorka, Maurice Aymard, Cheikh Anta Babou, Christophe Baticle, Jean-François Bayart, Julien Bondaz, Pierre Bouvier, Robert Cabanes, Jean Copans, Joahanna Copans, Frederick Cooper, David B. Coplan, Tarik Dahou, Ingolf Diener, Momar Coumba Diop, Laurence Espinosa, Éloi Ficquet, Lysa Hochroth, Jean Jamin, Daisuke Mizoguchi, Nicolas Monteillet, Luc Ngwe, Boubacar Niane, Jean-Bernard Ouédraogo, Pascal de Poorter, Monique de Saint-Martin, Tassadit Yacine, Patrice Yengo. Nous n’oublions pas le public qui par sa présence active a enrichi nos discussions.
Enfin, ils témoignent leur reconnaissance et leur gratitude à Armelle Lefebvre, pour son travail éditorial.
Table des matières
PRÉFACE Un témoignage personnel
INTRODUCTION Les vicissitudes du monde contemporain en mouvement
I L’anthropologie et les sciences de l’homme en question
La très longue marche de Jean Copans Itinéraires d’un universitaire hétérodoxe et d’un homme libre
Renewing urban anthropology: a view from Johannesburg (In Tribute to Jean Copans)
Témoignage
Le séminaire Afrique australe, ou une aventure universitaire
Chronique des « zones critiques de l’anthropologie » dans l’œuvre de Jean Copans
Éraillements. Quand le terrain s’écrie
Traduction et domination. Retour sur le projet anthropologique impérial
II L’anthropologie : ses objets, ses terrains
Jean Copans et l’histoire du travail en Afrique
De la situation de développement à l’anthropologie du contemporain Ce qu’un disciple doit à son marabout
Religion joola et développement économique en Casamance Analyse socio-anthropologique d’un malentendu religieux et/ou linguistique
Fondements et dynamique de l’économie informelle au Sénégal
Du commerce en plein air à la boutique Globalisation de la distribution, mouridisme et entrepreneuriat
« Du mouride des champs au mouride des villes » : Murid Struggle for a Place in Urban Sénégal
Rapports de classe et expérience du déclassement : le cas d’anciens salariés de l’industrie en reconversion
III L’anthropologie : expériences de soi et de l’autre
Mobilisations politiques, captures identitaires La question « ethnique » au Congo-Brazzaville
L’ethnologie en convalescence Le séjour à Dalaba de Georges Balandier et Paul Mercier comme moment biographique
Résister par les communs forestiers : le « braconnage » en Afrique Centrale
L’anthropologue à l’épreuve des terrains : entre engagement et réflexivité
La Mobilité des tirailleurs sénégalais : de l’inclusion domestique à l’acclusion et l’inclusion étatique, une socioanthropologie
POSTFACE Une lecture en creux de Georges Balandier : le témoignage d’un demi-siècle de Jean Copans
PRÉFACE
Un témoignage personnel
Par
Maurice Aymard
Directeur d’études, EHESS – Paris (France)
Nos routes auraient pu ne pas se croiser. Mais nous le savons, Jean Copans comme moi, ce petit miracle qu’a été notre rencontre, suivie par quatre décennies d’échanges intellectuels et personnels, n’aurait pas été possible sans le cadre exceptionnel qu’a représenté pour nous, comme pour de très nombreux chercheurs de nos disciplines, le bâtiment du 54 boulevard Raspail où nous nous sommes réunis autour de lui le 11 juin 2019 – cette ancienne prison militaire transformée par la volonté de Fernand Braudel, aidé par Clemens Heller, en une « maison commune de la connaissance », comme l’avait définie, avec le recul, François Furet : la MSH. Celle-ci avait été conçue pour réunir deux institutions de création récente : la Fondation Maison des sciences de l’homme, née au début des années 1960, mais qui restait encore, au début des années 1970 ; très largement à inventer, et l’ancienne VIe Section de l’EPHE, dont la naissance remontait à 1948, mais qui venait, en 1975, d’obtenir son autonomie sous le nom d’École des hautes études en sciences sociales.
Enseignant tous les deux dans la seconde de ces institutions, lui avant moi, élu en juin 1976, nous aurions pu y vivre la vie amicale de simples collègues travaillant dans des centres de recherche séparés par les secteurs géographiques qu’ils étudiaient, et par les disciplines affichées comme principales : l’anthropologie et la sociologie pour le Centre d’études africaines, l’histoire de l’Europe pour le Centre de recherches historiques, qui n’entretenait que des rapports assez éloignés avec les historiens des autres régions du monde, regroupés dans les centres des différentes « Aires culturelles ». Cette division des savoirs et des pouvoirs est aujourd’hui souvent critiquée pour de bonnes et de moins bonnes raisons, mais elle avait permis, en fléchant des postes, et en suscitant la création de nouveaux centres identifiés avec un espace bien défini, l’ouverture de la VIe Section sur le reste du monde (« le monde sauf l’Europe », dans la langue des Annales de l’époque) et sur le présent – un présent étroitement associé au passé, et donc à l’histoire. Elle remontait en fait au milieu des années 1950, quand, le 20 mars 1955, Lucien Febvre et F. Braudel avaient fait élire à la quasi-unanimité, le même jour, pour les six nouvelles directions d’études que la Direction de l’enseignement supérieur, en la personne de Gaston Berger, venait de créer à leur demande, pour « une série d’enseignements nouveaux consacrés au passé et au présent de l’Orient et de l’Extrême-Orient », les six candidats qu’ils avaient identifiés et que la commission avait proposés à l’Assemblée, elle aussi à l’unanimité : Jacques Berque pour l’Islam, Louis Dumont pour l’Inde, Vadime Elisseeff pour le Japon, et, pour la Chine, Étienne Balazs, Jacques Gernet et Jean Chesneaux. Une belle affiche pour un début, même s’il était encore trop tôt pour que l’Afrique y figure.
Mais il ne suffit pas d’appartenir à la même institution pour établir avec ses collègues de véritables rapports d’échanges, fondés sur des préoccupations communes. Sans doute Jean y était-il mieux préparé que moi, car plus jeune de six années, il avait accumulé infiniment plus d’expériences sur des terrains extérieurs que moi, et la toile de ses réseaux scientifiques personnels était de loin plus étendue et plus fortement structurée que la mienne.
Читать дальше