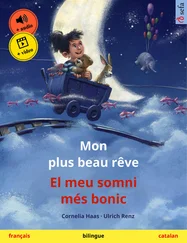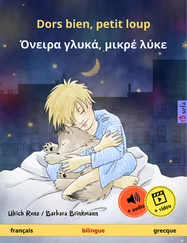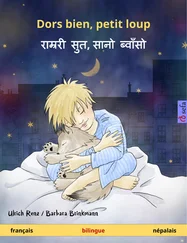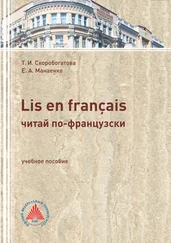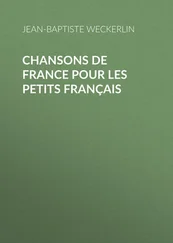En Afrique francophone, le français coexiste avec des langues locales, régionales et nationales – elles-mêmes souvent inégales –, et s’emploie surtout dans les domaines officiels. De plus, le français (ou bien une forme basilectale ou mésolectale du français) peut également être utilisé là où les autres langues ne sont pas « en mesure de satisfaire l’ensemble des besoins communicatifs de la communauté » (Manessy et al . 2002 : 44), ce qui est moins fréquent quand le français coexiste avec une autre langue dominante (comme le wolof au Sénégal). Dans ces pays, le français enseigné à l’école ne suit pas nécessairement la norme hexagonale, mais représente souvent une forme mésolectale ( cf. Manessy et al . 2002).
Une étude de perception de vaste étendue a été menée par Moreau et al. (2007) auprès de francophones de plusieurs pays (France, Belgique, Québec, Suisse, Tunisie et Sénégal). Les résultats ont montré, entre autres, que les francophones hiérarchisent, de manière différente selon le pays, ces variétés mentionnées. Ils suggèrent également l’ « absence de modèle unique » (Moreau et al . 2007 : 25, 32) et une « tendance à mieux évaluer les siens » (Moreau et al . 2007 : 25, 32, 37). De plus, les stimuli québécois sont généralement évalués de manière considérablement plus négative que les stimuli français, suisses et belges par tous/toutes les participant.e.s sauf les Québécois.e.s. Enfin, il existe une différence importante entre les juges du Sénégal et de la Tunisie : alors que les Sénégalais.e.s préfèrent les voix du Sénégal, les participant.e.s de la Tunisie favorisent les voix de la francophonie européenne.
2.2 Qu’en pensent les apprenant.e.s ?
Comment donc savoir quelle norme enseigner en FLE et quelle place accorder à la variation ? Il est intéressant de noter que les apprenant.e.s manifestent souvent une position claire à cet égard, du moins en ce qui concerne la production. Voici l’exemple de Wachs (2011 : 191) :
Si on pose ces questions1 aux apprenants de français, ils répondent dans leur grande majorité qu’ils veulent parler ‘le bon français’ et ‘bien le prononcer’, c’est-à-dire parler le ‘français de référence’ : un français non marqué, non stigmatisant.
Detey et Le Gac (2008 : 476) ont également dévoilé le souhait d’élèves d’apprendre et d’enseignant.e.s d’enseigner une variante qu’ils/elles appellent le français standard.
Il est encore plus intéressant de voir que, malgré leur proximité géographique et une probabilité élevée d’entrer en contact avec des francophones du Québec, les anglophones du Canada ( cf. Hume/Lepicq/Bourhis 1993) et même les immigrant.e.s vivant au Québec ( cf. Bergeron/Trofimovich 2019) donnent des jugements plus favorables au français standard qu’au français québécois. Cela s’explique probablement par le fait que, dans l’enseignement du français en Amérique du Nord, une norme européenne continue à prévaloir : malgré une tendance à inclure plus de contenu (culturel) lié au Québec observée entre 1960 et 2010 ( cf. Chapelle 2014), les manuels transmettent toujours majoritairement la norme parisienne ( cf . aussi Wagner 2015). Dans cette même voie, beaucoup de professeurs de FLE considèrent le français du Québec comme « moins authentique » et « inapproprié » pour l’enseignement du français ( cf . Wernicke 2016).
Mettre l’accent sur une variété que l’on appellera standard risque de conduire les apprenant.e.s à avoir « une vision confuse et réductrice de la langue » et à être surmené.e.s quand on leur présente des variétés ( cf. Merlo 2011 : 27). Neufeld a déjà démontré en 1980 que les apprenant.e.s avancé.e.s – quoique pouvant émettre un jugement discriminatoire envers les stimuli d’apprenant.e.s – avaient manifesté des problèmes pour affirmer si une personne était un.e Francophone du Canada ou un.e Francophone d’un autre pays . Utilisant la technique du matched guise, Bergeron et Trofimovich (2019) ont fait un constat similaire : même des apprenant.e.s du français habitant au Québec depuis plusieurs années étaient incapables de différencier les stimuli québécois des stimuli français, confondant surtout les registres formels du français québécois avec le français de France. De plus, ces auteures ont constaté des réactions négatives envers le français parlé au Québec2.
A notre connaissance, il n’existe pas d’étude traitant de la perception des autres variétés francophones par des apprenant.e.s de français, d’où la nécessité de travaux sur ce sujet.
2.3 Comment intégrer la variation dans l’enseignement du FLE ?
Comme nous l’avons évoqué précédemment, on peut imaginer que les attitudes négatives résultent, du moins partiellement, de la pratique courante de l’enseignement du FLE1. L’intégration de la variation pourrait faire croître la conscience des apprenant.e.s de l’importance du français comme langue internationale, augmentant ainsi leur motivation ( cf. Fox 2002 : 201). En outre, les résultats de Baker et Smith (2010) suggèrent que l’exposition à d’autres variétés améliore la perception non seulement de ces variétés, mais aussi de la variété dite « standard ».
À première vue, faire entrer la variation en classe de FLE paraît donc crucial. Pour cela, l’on pourrait s’inspirer, surtout pour les niveaux supérieurs, du projet PFC ( cf. Durand/Laks/Lyche 2002 ; accessible sur www.projet-pfc.net), qui offre des extraits sonores comparables de différentes variétés du français, ou bien des sources audiovisuelles infinies qu’offrent des plateformes comme Youtube ( cf. Maizonniaux 2019 et Manić-Matić 2016 pour des exemples didactiques). En même temps, afin de ne pas en demander trop aux apprenant.e.s, il faudra limiter l’exposition à la variation au domaine perceptif et n’imposer aux apprenant.e.s qu’une seule variante productive (Auger/Valdman 1999) : Valdman (2000) propose, pour le contexte du FLE, le concept de norme pédagogique , qui devrait être choisie selon trois facteurs :
des facteurs linguistiques (la « norme pédagogique doit refléter le comportement observable des locuteurs de la langue cible » ; p. 657),
des facteurs épilinguistiques (elle devrait correspondre à ce que les francophones trouvent approprié pour les apprenant.e.s) et
des facteurs acquisitionnels (cette norme pédagogique devrait être facile à apprendre).
Quant à la perception, les discussions portent souvent sur la question de savoir quel serait le niveau idéal pour commencer à présenter aux élèves des documents authentiques de la francophonie ( cf. Auger/Valdman 1999 ; Salien 1998). Contrairement à Salien, qui déconseille fortement d’intégrer les variétés au niveau débutant et propose de ne pas y exposer les apprenant.e.s avant les études supérieures :
At any rate, it would not be appropriate to teach dialects at the early stages of a language program. Upon mastering the basic structures of French grammar, students are ready to be exposed to the Québécois language and culture. The best level for this introduction appears to be the fourth semester of college, preferably in a reading and conversation class. (Salien 1998 : 100)
Auger et Valdman (1999) recommandent l’intégration des variétés régionales dès le début :
Читать дальше
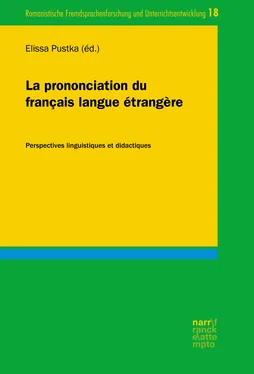
![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)