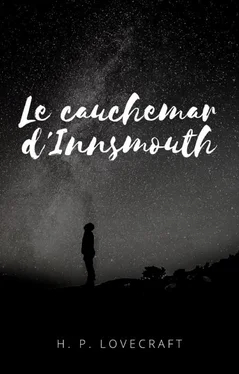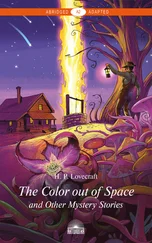Howard Lovecraft - Le Cauchemar d'Innsmouth
Здесь есть возможность читать онлайн «Howard Lovecraft - Le Cauchemar d'Innsmouth» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Le Cauchemar d'Innsmouth
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Le Cauchemar d'Innsmouth: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Le Cauchemar d'Innsmouth»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Le Cauchemar d'Innsmouth — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Le Cauchemar d'Innsmouth», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
« L’épidémie de 46 a dû emporter les meilleures familles de la ville. En tout cas, il reste maintenant que des gens douteux, et les Marsh comme les autres richards ne valent pas mieux. Comme je vous l’ai dit, il n’y a sûrement pas plus de quatre cents habitants dans toute la ville malgré la quantité de rues qu’ils ont, il paraît. Ils m’ont l’air d’être ce qu’on appelle « les sales Blancs » dans les États du Sud : rusés, sans foi ni loi et agissant en dessous. Ils pèchent beaucoup de poissons et de homards qu’ils exportent par camion. Incroyable comme le poisson grouille chez eux et nulle part ailleurs.
« Personne ne peut jamais surveiller ces gens-là, et les fonctionnaires de l’école publique ou du recensement en voient de dures. Vous vous doutez que les étrangers trop curieux sont mal reçus là-bas. Personnellement, j’ai entendu dire que plus d’un homme d’affaires ou d’un représentant du gouvernement y avaient disparu, et il est question aussi de quelqu’un qui serait devenu fou et se trouverait à présent à l’asile de Denver. Il a dû en avoir une peur bleue.
« C’est pour ça que j’irais pas de nuit, si j’étais vous. Je n’y suis jamais allé et je n’en ai pas envie, mais je pense que vous ne risquez rien en y faisant un tour dans la journée – même si les gens de par ici vous le déconseillent. Si vous venez seulement en touriste pour voir des choses d’autrefois, Innsmouth devrait être un endroit idéal pour vous. »
Je passai donc une partie de la soirée à la bibliothèque municipale de Newburyport à la recherche des documents sur Innsmouth. Quand j’avais essayé d’interroger les habitants dans les boutiques, au restaurant, dans les garages et chez les pompiers, je les avais trouvés encore plus difficiles à mettre en train que ne l’avait prédit l’employé de la gare et je compris que je n’aurais pas le temps de vaincre leurs premières réticences instinctives. Ils avaient une sorte d’obscure méfiance, comme si quiconque s’intéressait trop à Innsmouth leur était un peu suspect. À l’YMCA 2, où je logeais, on me déconseilla absolument de me rendre dans un lieu aussi sinistre et décadent ; les gens à la bibliothèque exprimèrent la même opinion. Manifestement, aux yeux des personnes cultivées, Innsmouth n’était qu’un cas extrême de dégénérescence urbaine.
Parmi les ouvrages de la bibliothèque, les chroniques du comté d’Essex m’apprirent peu de chose, si ce n’est que la ville fut fondée en 1643, célèbre avant la révolution pour la construction navale, centre d’une grande prospérité maritime au début du XIXe siècle, et plus tard d’une industrie mineure utilisant le Manuxet comme force motrice. L’épidémie et les émeutes de 1846 étaient à peine évoquées, comme si elles avaient été une honte pour le comté.
On parlait peu du déclin, mais les textes plus récents étaient significatifs. Après la guerre civile, toute la vie industrielle se résumait à la compagnie d’affinage Marsh, et la vente des lingots d’or restait le seul vestige d’activité commerciale en dehors de la sempiternelle pêche en mer. Celle-ci rapportait de moins en moins à mesure que le prix de la marchandise baissait, et que des sociétés à grande échelle faisaient des offres concurrentes, mais le poisson ne manquait jamais au large du port d’Innsmouth. Les étrangers s’y installaient rarement, et des faits passés sous silence prouvaient que plusieurs Polonais et Portugais, s’y étant risqués, avaient été écartés par les mesures les plus radicales.
Le plus intéressant était une référence indirecte aux bijoux étranges qu’on associait vaguement à Innsmouth. Ils avaient dû laisser une forte impression dans tout le pays car on en signalait des spécimens au musée de l’université de Miskatonic, à Arkham, dans la salle d’exposition de la Société historique de Newburyport. Les descriptions fragmentaires de ces objets, pourtant plates et banales, me suggérèrent la continuité d’une étrangeté sous-jacente. Ce qu’ils avaient pour moi d’insolite et de provocant m’obséda au point que, malgré l’heure assez tardive, je résolus d’aller voir, si c’était encore possible, l’échantillon local – un bijou de grande taille aux proportions singulières, qui représentait de toute évidence une tiare.
Le bibliothécaire me remit un mot d’introduction pour la conservatrice de la Société, une certaine miss Anna Tilton, qui habitait tout près, et, après une brève explication, cette vénérable dame eut la bonté de me faire entrer dans le bâtiment, déjà fermé bien qu’il ne fût pas une heure indue. La collection était vraiment remarquable, mais en l’occurrence je n’avais d’yeux que pour le bizarre objet qui étincelait dans une vitrine d’angle sous la lumière électrique.
Il n’était pas nécessaire d’être particulièrement sensible à la beauté pour rester comme moi littéralement suffoqué devant la splendeur singulière, surnaturelle, de l’œuvre riche, déroutante, fantastique qui reposait là, sur un coussin de velours violet. Aujourd’hui encore, je suis presque incapable de décrire ce que j’ai vu, bien qu’il s’agît nettement d’une sorte de tiare, ainsi que je l’avais lu. Elle était haute sur le devant, très large et d’un contour curieusement irrégulier, tel qu’on l’aurait conçu pour une tête monstrueusement elliptique. L’or semblait y dominer, mais un mystérieux éclat plus lumineux suggérait quelque étrange alliage avec un autre métal magnifique, difficile à identifier. Elle était en parfait état, et l’on aurait passé des heures à étudier les dessins saisissants et d’une originalité déroutante – les uns simplement géométriques, d’autres nettement marins –, ciselés ou modelés en relief sur sa surface avec un art d’une habileté et d’une grâce incroyables.
Plus je la regardais, plus elle me fascinait ; et je percevais dans cet attrait un élément troublant, impossible à définir et à expliquer. J’attribuai d’abord mon malaise au caractère d’outre-monde de cet art étrange. Toutes les autres œuvres que j’avais vues jusqu’alors appartenaient à un courant connu, racial ou national, à moins qu’elles ne soient un défi résolument moderniste à toutes les traditions. Cette tiare n’était ni l’un ni l’autre. Elle relevait évidemment d’une technique accomplie, d’une maturité et d’une perfection infinies, mais radicalement différente de toutes celles – orientales ou occidentales, anciennes ou modernes – que je connaissais de vue ou de réputation. On eût dit que c’était l’œuvre d’une autre planète.
Pourtant je compris bientôt que mon trouble avait une autre origine, peut-être aussi puissante que la première, dans les allusions picturales et mathématiques de ces singuliers dessins. Les formes évoquaient toutes de lointains secrets, d’inconcevables abîmes dans l’espace et le temps, et la nature invariablement aquatique des reliefs devenait presque sinistre. Ils représentaient entre autres des monstres fabuleux d’un grotesque et d’une malignité répugnants – mi-poissons, mi batraciens – que je ne pouvais dissocier d’une obsédante et pénible impression de pseudo-souvenir, comme s’ils faisaient surgir je ne sais quelle image des cellules et des tissus enfouis dont les fonctions de mémorisation sont entièrement primitives et effroyablement ancestrales. Il me semblait parfois que chaque trait de ces maudits poissons-grenouilles répandait l’extrême quintessence d’un mal inconnu qui n’avait rien d’humain.
La courte et banale histoire de la tiare telle que me la raconta miss Tilton faisait un singulier contraste avec son aspect. Elle avait été mise en gage pour une somme ridicule dans une boutique de State Street en 1873, par un ivrogne d’Innsmouth, tué peu après dans une bagarre. La Société l’avait achetée au prêteur sur gages, et lui avait aussitôt donné un cadre digne de sa qualité. On indiquait qu’elle venait probablement d’Indochine ou des Indes orientales, mais cette attribution était franchement provisoire.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Le Cauchemar d'Innsmouth»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Le Cauchemar d'Innsmouth» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Le Cauchemar d'Innsmouth» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.