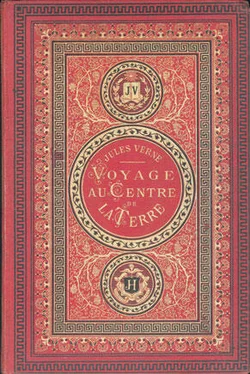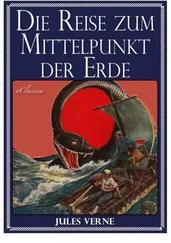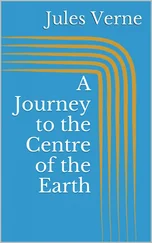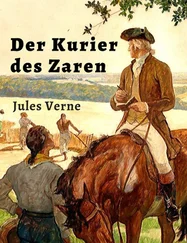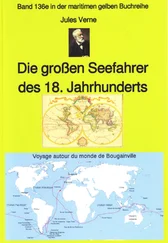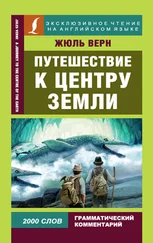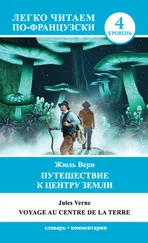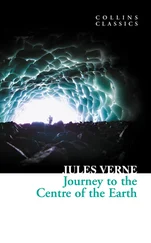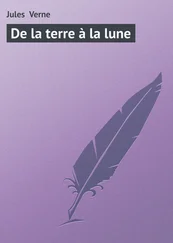Mais un ennui, disons même un tourment, se glissait au milieu de cette gloire. Un fait demeurait inexplicable, celui de la boussole. Or, pour un savant pareil phénomène inexpliqué devient un supplice de l’intelligence. Eh bien! le ciel réservait à mon oncle d’être complètement heureux.
Un jour, en rangeant une collection de minéraux dans son cabinet, j’aperçus cette fameuse boussole et je me mis à l’observer.
Depuis six mois elle était là, dans son coin, sans se douter des tracas qu’elle causait.
Tout à coup, quelle fut ma stupéfaction! Je poussai un cri. Le professeur accourut.
«Qu’est-ce donc? demanda-t-il.
– Cette boussole!…
– Eh bien?
– Mais son aiguille indique le sud et non le nord!
– Que dis-tu?
– Voyez! ses pôles sont changés.
– Changés!»
Mon oncle regarda, compara, et fit trembler la maison par un bond superbe.
Quelle lumière éclairait à la fois son esprit et le mien!
«Ainsi donc, s’écria-t-il, dès qu’il retrouva la parole, après notre arrivée au cap Saknussemm, l’aiguille de cette damnée boussole marquait le sud au lieu du nord?
– Évidemment.
– Notre erreur s’explique alors. Mais quel phénomène a pu produire ce renversement des pôles?
– Rien de plus simple.
– Explique-toi, mon garçon.
– Pendant l’orage, sur la mer Lidenbrock, cette boule de feu qui aimantait le fer du radeau avait tout simplement désorienté notre boussole!
– Ah! s’écria le professeur, en éclatant de rire, c’était donc un tour de l’électricité?»
À partir de ce jour, mon oncle fut le plus heureux des savants, et moi le plus heureux des hommes, car ma jolie Virlandaise, abdiquant sa position de pupille, prit rang dans la maison de Königstrasse en la double qualité de nièce et d’épouse. Inutile d’ajouter que son oncle fut l’illustre professeur Otto Lidenbrock, membre correspondant de toutes les sociétés scientifiques, géographiques et minéralogiques des cinq parties du monde.
(1864)
[1]2 francs 75 centimes environ. Note de l’auteur.
[2] La Recherche fut envoyée en 1835 par l’amiral Duperré pour retrouver les traces d’une expédition perdue, celle de M. de Blosseville et de la Lilloise dont on n’a jamais eu de nouvelles.
[3]Nom donné aux golfes étroits dans les pays scandinaves.
[4]16 francs 98 centimes.
[5]L’appareil de M. Ruhmkorff consiste en une pile de Bunzen, mise en activité au moyen du bichromate de potasse qui ne donne aucune odeur. Une bobine d’induction met l’électricité produite par la pile en communication avec une lanterne d’une disposition particulière; dans cette lanterne se trouve un serpentin de verre où le vide a été fait, et dans lequel reste seulement un résidu de gaz carbonique ou d’azote. Quand l’appareil fonctionne, ce gaz devient lumineux en produisant une lumière blanchâtre et continue. La pile et la bobine sont placées dans un sac de cuir que le voyageur porte en bandoulière. La lanterne, placée extérieurement, éclaire très suffisamment dans les profondes obscurités; elle permet de s’aventurer, sans craindre aucune explosion, au milieu des gaz les plus inflammables, et ne s’éteint pas même au sein des plus profonds cours d’eau. M. Ruhmkorff est un savant et habile physicien. Sa grande découverte, c’est sa bobine d’induction qui permet de produire de l’électricité à haute tension. Il a obtenu, en 1864, le prix quinquennal de 50,000 fr. que la France réservait à la plus ingénieuse application de l’électricité.
[6]Maison du paysan islandais.
[7]Huit lieues.
[8]Monnaie de Hambourg, 90 fr. environ.
[9]Ainsi nommée parce que les terrains de cette période sont fort étendus en Angleterre, dans les contrées habitées autrefois par la peuplade celtique des Silures.
[10]Phosphate de chaux.
[11]Mers de la période secondaire qui ont formé les terrains dont se composent les montagnes du Jura.
[12]Source jaillissante très célèbre située au pied de l’Hécla.
[13]Nuages de formes arrondies.
[14]L’angle facial est formé par deux plans, l’un plus ou moins vertical qui est tangent au front et aux incisives, l’autre horizontal, qui passe par l’ouverture des conduits auditifs et l’épine nasale inférieure. On appelle prognathisme, en langue anthropologique, cette projection de la mâchoire qui modifie l’angle facial.