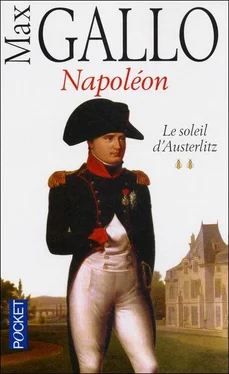Il aime ces paysages, ces villes, ces ponts qu'il a franchis à la tête des armées. Il aime ce printemps italien. Il chevauche de longues heures et il lui arrive, en une journée, d'épuiser cinq chevaux.
Parfois, un souvenir douloureux revient.
Il est monté sur le parapet des fortifications de Vérone. Il regarde la ville dont les toits de tuiles composent un lac rouge.
« Mon pauvre frère Louis, dit-il, c'est ici, dans cette même ville et dans nos premières campagnes, qu'il éprouva l'accident le plus funeste. Une femme qu'il connaissait à peine viola son domicile. Depuis ce temps il est livré à des agitations nerveuses, variables selon l'atmosphère et dont il n'a jamais pu se guérir. »
Voilà les ombres qui reviennent.
Louis, malade, hostile, refusant de laisser adopter son fils aîné.
Lucien ?
Napoléon se confie à Caulaincourt, la voix dure, les gestes nerveux. « Lucien préfère une femme déshonorée, dit-il, qui lui a donné un enfant avant qu'il fût marié avec elle, à l'honneur de son nom et de sa famille. »
Ces pensées le blessent en cette chaude fin de juin 1805 qu'il passe à Gênes. Il regarde le lit qui fut, ont assuré les Génois en lui faisant visiter sa chambre, celui où coucha Charles Quint.
Il est cet homme-là qu'on compare aux plus grands, et aussi celui dont les frères refusent de l'aider. Il est cet Empereur sans fils.
Il reprend d'une voix amère.
Il ne peut que gémir, dit-il, du grand égarement de Lucien.
« Un homme que la nature a fait naître avec des talents et qu'un égoïsme sans exemple a arraché à de belles destinées et a entraîné loin de la route du devoir et de l'honneur. » Il va vers la fenêtre de sa chambre qui, dans le palais, domine le port de Gênes.
Trois frégates et deux bricks manœuvrent, toutes voiles dehors. Il les regarde longuement.
Il a dû, il y a quelques heures, modifier son plan de descente en Angleterre. Villeneuve n'a pas été capable de rencontrer aux Antilles l'escadre de Missiessy. Toutes les manœuvres prévues ont pris du retard. L'invasion de l'Angleterre aura donc lieu entre le 8 et le 18 août, et non pas en ce mois de juin.
Il s'accoude à la fenêtre, suit des yeux ces bateaux. Jérôme les commande. Jérôme, qui a accepté d'abandonner son épouse américaine et de se plier à la raison.
Peut-être est-il le seul de mes frères qui m'obéisse ?
Peut-être n'est-ce pas dans ma famille que je trouverai un appui ? Et si je n'ai pas de fils, sur qui puis-je compter ?
Peut-être sur Eugène de Beauharnais, qu'il vient de désigner vice-roi d'Italie.
Il dit à Roederer : « S'il se tire un coup de canon, c'est Eugène qui va voir ce que c'est. Si j'ai un fossé à passer, c'est lui qui me donne la main. »
Il a confiance dans ce jeune homme de vingt-trois ans, digne et courageux. Il voudrait l'aider, dans la tâche si difficile de gouverner les hommes.
« Nos sujets d'Italie sont naturellement plus dissimulés que le sont les citoyens de la France, écrit-il à Eugène. N'accordez votre confiance entière à personne... Parlez le moins possible, vous n'êtes pas assez instruit et votre éducation n'a pas été assez soignée pour que vous puissiez vous livrer à des discussions d'abandon. Sachez écouter... Quoique vice-roi, vous n'avez que vingt-trois ans... Montrez pour la nation que vous gouvernez une estime qu'il convient de manifester d'autant plus que vous découvrirez des motifs de l'estimer moins. Il viendra un temps où vous reconnaîtrez qu'il y a bien peu de différence entre un peuple et un autre. »
Le peuple ? Il l'observe, il l'écoute tout au long du voyage de retour en France, dans les premiers jours du mois de juillet 1805.
Dans les environs de Lyon, il fait arrêter la berline sur un chemin de traverse. La foule, dans les champs, va vers la route, sans doute pour l'acclamer, le voir.
Il descend de voiture et commence à marcher en se dirigeant vers la petite montagne de Tarare. Il éconduit ceux qui veulent le suivre. Il désire être seul, se mêler à la foule, voir le peuple.
Personne ne le reconnaît. Il monte lentement, interroge une vieille femme. Que fait-elle là ? L'Empereur va passer, dit-elle.
Il bavarde avec elle, guettant ses moindres mimiques.
Elle est le peuple qui vit loin des palais.
- Vous aviez le tyran Capet, dit-il, vous avez le tyran Napoléon. Que diable avez-vous gagné à tout cela ?
Il se penche sur la vieille femme. Il lit son désarroi sur son visage ridé.
- Mais pardonnez-moi, Monsieur, dit-elle. Après tout, il y a une grande différence.
Elle hoche la tête, sourit, malicieuse.
- Nous avons choisi celui-ci, et nous avions l'autre par hasard.
Elle hausse la voix.
- L'un était le roi des nobles, l'autre est celui du peuple, c'est le nôtre !
Napoléon redescend d'un pas vif la côte. Il sifflote et prise.
- J'aime le gros bon sens qui court les rues, dit-il à Méneval. Puis il monte dans la berline.
34.
Est-ce la chaleur lourde de cette fin de juillet 1805 ? Ou bien est-ce l'attente des nouvelles des escadres ? Mais, plusieurs fois par jour, Napoléon se laisse emporter par la colère. Il convoque Murat, qui arrive empanaché dans son uniforme de grand amiral et prince, de Grand Aigle de la Légion d'honneur, de chef de la 12 e cohorte, qui parle, avant qu'on l'interroge, de la collection de tableaux qu'il a réunie dans son palais de l'Élysée !
C'est bien le moment et le lieu de parler de tableaux ! Où en sont les troupes ? Manœuvrent-elles ? Les fournitures sont-elles assurées ? Murat bafouille.
Napoléon s'emporte dans le parc du château de Fontainebleau, marche le long des pièces d'eau.
Le temps est orageux, mais l'averse ne tombe pas et la chaleur s'entasse sous un ciel bas que fracturent les longs éclairs.
C'est comme si l'électricité de la foudre glissait sur ma peau .
Napoléon frissonne. Il rentre.
Quelles nouvelles ? Où sont ces amiraux ? Que fait Ganteaume ? Que fait Villeneuve ? Sait-on où se trouve Nelson ?
Il écrit à Ganteaume : « De grands événements se passent ou vont se passer ; ne rendez pas inutiles les forces que vous commandez... Ayez de la prudence mais aussi de l'audace. »
Il écrit à Villeneuve : « Pour le grand objet de favoriser une descente chez cette puissance, l'Angleterre, qui, depuis six siècles, opprime la France, nous pourrions tous mourir sans regretter la vie. Tels sont les sentiments qui doivent animer tous mes soldats. »
Il examine, penché sur sa table de travail, les états des différentes flottes : soixante-quatorze navires pour les Français et les Espagnols, à peine cinquante-quatre pour les Anglais !
Mais qu'attendent donc les amiraux pour agir !
Il se sent ligoté, englué. La chaleur poisseuse colle à la peau. Les courriers partent, avec mission de crever les chevaux mais d'atteindre Brest, Vigo ou Cadix sans jamais faire halte.
Comment se décider s'il ne sait pas où sont, que font les escadres ?
Pendant ce temps, Talleyrand le confirme, l'Angleterre pousse l'Autriche à s'engager dans le conflit, et la Russie a déjà partie liée avec Londres. Si Vienne ose, alors...
Il reçoit Cambacérès et le ministre des Finances, Barbé-Marbois.
Napoléon se tient debout devant la croisée ouverte. Pas un souffle de vent. Si, sur l'océan, le temps est identique, alors jamais les flottes n'atteindront Boulogne.
Il se tourne vers Cambacérès. L'archichancelier est inquiet. Barbé-Marbois est encore plus préoccupé. Les financiers renâclent, explique-t-il. Ils nous serrent à la gorge. Ils craignent l'entreprise hasardeuse de l'invasion de l'Angleterre.
Napoléon se met à marcher, les mains derrière le dos.
Читать дальше