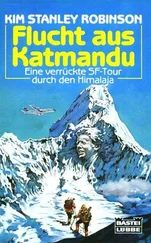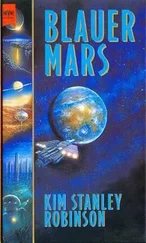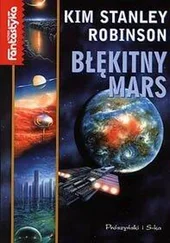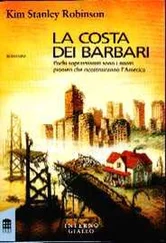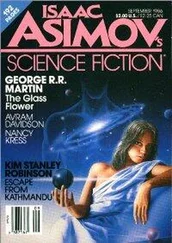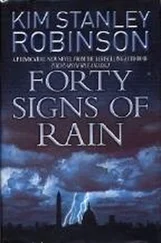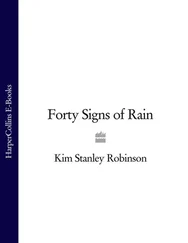Kim Stanley Robinson
Les 40 signes de la pluie
Tous mes remerciements à Guy Guthridge, Grant Heidrich, Charles Hess, Dick Ill, Chris McKay, Oliver Morton, Lisa Nowell, Ann Russell, Mark Schwartz, Sharon Strauss et Jim Shea pour leur aide.
La Terre baigne dans un déluge de lumière : un torrent impétueux de photons – une moyenne de 342 joules à la seconde par mètre carré. Il faut 4 185 joules pour élever d’un degré la température d’un kilogramme d’eau. Si l’atmosphère de la Terre captait toute cette énergie, la température du globe s’élèverait de dix degrés en une journée.
Par bonheur, une forte proportion de cette énergie est renvoyée dans l’espace, en fonction de l’albédo – ou réflexivité – et de la composition chimique de l’atmosphère, qui sont eux-mêmes variables.
Une bonne partie de l’albédo de la Terre est fournie par les calottes polaires. Si la glace et la neige des pôles devaient se restreindre de façon significative, une partie plus importante de l’énergie solaire resterait piégée sur Terre. Le soleil pénétrerait dans des océans jusque-là recouverts de glace et réchaufferait l’eau. Ce qui – amorçant une boucle de rétroaction positive – aurait pour effet d’élever encore la température et de faire fondre encore davantage de glace.
La glace compactée de l’océan Arctique renvoie dans l’espace un pourcentage non négligeable de l’afflux total d’énergie solaire. Quand les sous-marins nucléaires ont commencé à mesurer l’épaisseur de la calotte glaciaire de l’océan Arctique, dans les années 1950, elle était d’un peu plus de neuf mètres en moyenne au cœur de l’hiver. À la fin du siècle, elle n’était plus que de la moitié : quatre mètres cinquante. Et puis, un mois d’août, la glace se disloqua, et de grands icebergs tabulaires dérivèrent au gré des courants, s’entrechoquant et se morcelant, laissant de grandes étendues d’eau exposées au soleil continuel de l’été polaire. L’année suivante, la dislocation se produisit en juillet, et, à certains moments, plus de la moitié de la surface de l’océan Arctique était de l’eau offerte au soleil de minuit. La troisième année, le phénomène se reproduisit dès le mois de mai.
C’était l’année dernière.
Tous les jours de semaine commencent de la même façon. Par la sonnerie du réveil qui fait voler en éclats des rêves aussitôt dissipés. La chambre plongée dans la lumière obscure qui précède l’aube. La douche bien chaude où on se traîne et sous laquelle on essaie de se réveiller. L’eau brûlante sur la nuque, ah, le meilleur moment de la journée, hélas trop vite passé, saleté de pendule dont les aiguilles tournent inexorablement. Lambeaux d’un rêve, on était jusqu’au cou dans un problème qui se dérobe à présent, exactement comme on tentait de s’y dérober dans le rêve. Enfui dans les couloirs de la mémoire. Les rêves ne veulent pas qu’on se souvienne d’eux.
Évaluation de la nuit de sommeil : pas si bonne que ça, décida Anna Quibler. Elle était déjà épuisée. Joe avait pleuré deux fois, et bien que Charlie se soit levé, dans le cadre du programme de conditionnement comportemental destiné à faire comprendre à Joe que maman ne viendrait plus jamais le voir la nuit, Anna s’était évidemment réveillée aussi, et avait vaguement entendu les paroles de réconfort de Charlie :
« Alors, mon petit bonhomme, qu’est-ce qu’il y a ? Allez, Joe, rendors-toi, va. On est au beau milieu de la nuit, là. Il ne se passera rien avant demain matin, alors tu ferais mieux de dormir. Ça ne sert à rien de geindre comme ça, pourquoi tu chiales, hein ? Dors, bordel de merde ! »
Un discours pour le moins musclé, mais ça faisait partie du programme. Après ça, elle s’était tournée et retournée pendant de longues minutes, essayant bravement de ne pas penser au boulot. Dans le temps, elle se récitait Le Corbeau d’Edgar Poe, qu’elle avait appris au lycée et qui avait sur elle un effet agréablement soporifique, mais une nuit, au lieu de nevermore, « jamais plus », elle s’était dit : « Et le corbeau dit Livermore », parce qu’elle avait la tête farcie de problèmes avec des gens de sa boîte, dont Lawrence Livermore. Après ça, Le Corbeau avait perdu toutes ses propriétés somnifères : le seul fait d’y penser la ramenait, par association d’idées, à son travail. Les pensées d’Anna avaient une fâcheuse tendance à tourner autour des enjeux professionnels.
Fin de la douche, hélas ! Elle se sécha, s’habilla en trois minutes et descendit préparer la boîte à déjeuner de Nick, son aîné. Elle n’eut pas à se casser beaucoup la tête. Il tenait à manger exactement la même chose tous les jours : un sandwich au beurre de cacahuète, une tranche de viande reconstituée, cinq carottes, une pomme, du lait chocolaté, un yaourt, un bâtonnet de fromage et un cookie. Deux minutes de préparation, y compris le temps de fourrer le tout dans un sachet isotherme pour que ça reste bien au frais. En prenant la brique réfrigérante dans le freezer, elle vit les rangées de flacons de plastique pleins de son propre lait, congelé, que Charlie réchaufferait et donnerait à Joe pendant la journée, quand elle serait au bureau. Ce qui lui rappela – comme si elle pouvait l’oublier, avec ses mamelles gonflées à éclater – qu’elle devait donner la tétée au loupiot avant de partir. Elle remonta au premier, prit Joe dans son berceau, s’assit sur le divan, à côté.
— Et voilà, mon petit trésor, un quart d’heure de sommeil en rab pour la nounou.
Joe, pour qui c’était la routine, s’accrocha à son téton comme une sangsue sans ouvrir l’œil, en continuant à dormir à poings fermés. Un vrai petit ange. Il avait déjà bien grandi, mais elle pouvait encore le tenir dans ses bras et le regarder se lover contre elle comme quand il était un nouveau-né. Elle ne pouvait plus dire qu’ils ne faisaient qu’un ; ils étaient bien deux, à présent, et c’était une petite boule de muscles, pleine d’énergie, qui la pompait littéralement. Sauf en cet instant : la sensation de chaleur liée à l’aspiration anesthésiait son corps, mais une partie de son esprit était déjà au travail, alors elle détacha son fils et lui donna l’autre sein pendant encore quatre minutes. Les premiers mois, elle était obligée de lui pincer le nez pour lui faire lâcher prise, mais maintenant, il suffisait de lui tapoter le nez. Pour le premier sein, du moins. Pour le second, il était plus récalcitrant. Elle regarda la grande aiguille de la pendule murale achever son tour de cadran et repartir pour un autre. Quand il aurait fini de téter, il se rendormirait et ronfloterait allègrement jusqu’à près de neuf heures, à en croire Charlie.
Elle le remit dans son berceau, se reboutonna et déposa un baiser sur la tête de chacun de ses hommes. Charlie marmonna :
— Prends bien soin de toi, et tu m’appelles, hein.
Ensuite, elle se retrouva en bas de l’escalier, et puis de l’autre côté de la porte, sa grande besace de travail en bandoulière.
L’air frais sur son visage et ses cheveux humides la réveilla pour de bon. C’était la fin du printemps, et le matin, en mai, n’était plus qu’à peine vif. Fraîcheur néanmoins délicieuse, par comparaison avec la chaleur humide à venir. De gros nuages gris passaient au ras des bâtiments, le long de Wisconsin Avenue, mais le seul grondement audible était celui des camions qui descendaient vers le sud. Une aube encore timide éclaboussait les vitres bleu métallisé des gratte-ciel au-dessus de la station de métro de Bethesda, et tout en marchant d’un pas rapide Anna se dit, comme bien souvent, que c’était l’un des meilleurs moments de la journée. Cette réflexion comportait des implications dérangeantes, mais elle les chassa et savoura la fraîcheur de l’air et la vision du tapis de nuages qui se déroulait au-dessus de la ville.
Читать дальше