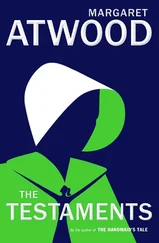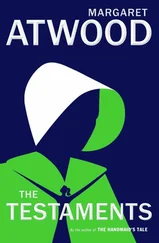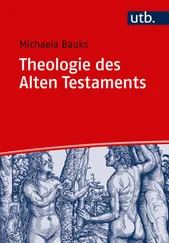Il a tout fait pour s'y sentir chez lui: il s'est arrêté dans toutes les pièces de cette maison, a touché tous les coins, a caressé tous les meubles; il est passé de la musique de l'ancien folklore à Pergolèse qui lui a procuré Pulcinella (1919), aux autres maîtres du baroque sans lesquels son Apollon Musagète (1928) serait impensable, à Tchaïkovski dont il transcrit les mélodies dans Le Baiser de la fée (1928), à Bach qui parraine son Concerto pour piano et instruments à vent (1924), son Concerto pour violon (1931) et dont il réécrit Choral Variationen über Vom Himmel hoch (1956), au jazz qu'il célèbre dans Ragtime pour onze instruments (1918), dans Pianorag music (1919), dans Preludium pour Jazz Ensemble (1937) et dans Ebony Concerto (1945), à Pérotin et autres vieux polyphonistes qui inspirent sa Symphonie des Psaumes (1930) et surtout son admirable Messe (1948), à Monteverdi qu'il étudie en 1957, à Gesualdo dont, en 1959, il transcrit les madrigaux, à Hugo Wolf dont il arrange deux chansons (1968) et à la dodécapho-nie envers laquelle il avait d'abord eu de la réticence mais en laquelle, enfin, après la mort de Schönberg (1951), il a reconnu aussi l'une des pièces de son chez-soi.
Ses détracteurs, défenseurs de la musique conçue comme expression des sentiments, qui s'indignaient de l'insupportable discrétion de son "activité affective" et l'accusaient de "pauvreté du cœur", n'avaient pas eux-mêmes assez de cœur pour comprendre quelle blessure sentimentale se trouve derrière son vagabondage à travers l'histoire de la musique.
Mais il n'y a là aucune surprise: personne n'est plus insensible que les gens sentimentaux. Souvenez-vous: "Sécheresse du cœur dissimulée derrière le style débordant de sentiments".
QUATRIÈME PARTIE
UNE PHRASE
Dans "L'ombre castratrice de saint Garta", j'ai cité une phrase de Kafka, une de celles où toute l'originalité de sa poésie romanesque me paraissait condensée: la phrase du troisième chapitre du Château où Kafka décrit le coït de K. et de Frieda. Pour montrer avec exactitude la beauté spécifique de l'art de Kafka, au lieu d'utiliser les traductions existantes j'ai préféré improviser moi-même une traduction le plus fidèle possible. Les différences entre une phrase de Kafka et ses reflets dans le miroir des traductions m'ont conduit ensuite aux quelques réflexions que voici:
TRADUCTIONS
Faisons défiler les traductions. La première est celle de Vialatte, de 1938:
"Des heures passèrent là, des heures d'haleines mêlées, de battements de cœur communs, des heures durant lesquelles K. ne cessa d'éprouver l'impression qu'il se perdait, qu'il s'était enfoncé si loin que nul être avant lui n'avait fait plus de chemin; à l'étranger, dans un pays où l'air même n'avait plus rien des éléments de l'air natal, où l'on devait étouffer d'exil et où l'on ne pouvait plus rien faire, au milieu d'insanes séductions, que continuer à marcher, que continuer à se perdre".
On savait que Vialatte se comportait un peu trop librement à l'égard de Kafka; c'est pourquoi les Éditions Gallimard ont voulu faire corriger ses traductions pour l'édition des romans de Kafka dans la Pléiade en 1976. Mais les héritiers de Vialatte s'y sont opposés; ainsi est-on arrivé à une solution inédite: les romans de Kafka sont publiés dans la version fautive de Vialatte, tandis que Claude David, éditeur, publie ses propres corrections de la traduction à la fin du livre sous forme de notes incroyablement nombreuses, si bien que le lecteur est obligé, afin de restituer dans son esprit une "bonne" traduction, de tourner perpétuellement les pages pour regarder les notes. La combinaison de la traduction de Vialatte avec les corrections à la fin du livre constitue en fait une deuxième traduction française que je me permets de désigner, pour plus de simplicité, du seul nom de David: "Des heures passèrent là, des heures d'haleines mêlées, de battements de cœur confondus, des heures durant lesquelles K. ne cessa d'éprouver l'impression qu'il s'égarait, qu'il s'enfonçait plus loin qu'aucun être avant lui; il était dans un pays étranger, où l'air même n'avait plus rien de commun avec l'air du pays natal; l'étrangeté de ce pays faisait suffoquer et pourtant, parmi de folles séductions, on ne pouvait que marcher toujours plus loin, s'égarer toujours plus avant".
Bernard Lortholary a le grand mérite d'avoir été radicalement insatisfait des traductions existantes et d'avoir retraduit les romans de Kafka. Sa traduction du Château date de 1984:
"Là passèrent des heures, des heures de respirations mêlées, de cœurs battant ensemble, des heures durant lesquelles K. avait le sentiment constant de s'égarer, ou bien de s'être avancé plus loin que jamais aucun homme dans des contrées étrangères, où l'air lui-même n'avait pas un seul élément qu'on retrouvât dans l'air du pays natal, où l'on ne pouvait qu'étouffer à force d'étrangeté, sans pouvoir pourtant faire autre chose, au milieu de ces séductions insensées, que de continuer et de s'égarer davantage".
Voilà maintenant la phrase en allemand: "Dort vergingen Stunden, Stunden gemeinsamen Atems, gemeinsamen Herzschlags, Stunden, in denen K. immerfort das Gefuhl hatte, er verirre sich oder er sei so weit in der Fremde, wie vor ihm noch kein Mensch, einer Fremde, in der selbst die Luft keinen Bestandteil der Heimatluft habe, in der man vor Fremdheit ersticken musse und in deren unsinnigen Verlockungen man doch nichts tun kônne als weiter gehen, weiter sich verirren". Ce qui, dans une traduction fidèle, donne ceci:
"Là, s'en allaient des heures, des heures d'haleines communes, de battements de cœur communs, des heures durant lesquelles K. avait sans cesse le sentiment qu'il s'égarait, ou bien qu'il était plus loin dans le monde étranger qu'aucun être avant lui, dans un monde étranger où l'air même n'avait aucun élément de l'air natal, où l'on devait étouffer d'étrangeté et où l'on ne pouvait rien faire, au milieu de séductions insensées, que continuer à aller, que continuer à s'égarer".
MÉTAPHORE
Toute la phrase n'est qu'une longue métaphore. Rien n'exige, de la part d'un traducteur, plus d'exactitude que la traduction d'une métaphore. C'est là que l'on touche le cœur de l'originalité poétique d'un auteur. Le mot par lequel Vialatte a fauté est d'abord le verbe "s'enfoncer": "Il s'était enfoncé si loin". Chez Kafka, K. ne s'enfonce pas, il "est". Le mot "s'enfoncer" déforme la métaphore: il la lie trop visuellement à l'action réelle (celui qui fait l'amour s'enfonce) et la prive ainsi de son degré d'abstraction (le caractère existentiel de la métaphore de Kafka ne prétend pas à l'évocation matérielle, visuelle, du mouvement amoureux). David qui corrige Vialatte garde le même verbe: "s'enfoncer". Et même Lortholary (le plus fidèle) évite le mot "être" et le remplace par "s'avancer dans".
Chez Kafka, K. faisant l'amour se trouve "in der Fremde", "à l'étranger"; Kafka répète deux fois le mot, et la troisième fois il utilise son dérivé "die Fremdheit" (l'étrangeté): dans l'air de l'étranger on étouffe d'étrangeté. Tous les traducteurs se sentent gênés par cette triple répétition: c'est pourquoi Vialatte utilise une fois seulement le mot "étranger" et, au lieu d'"étrangeté", choisit un autre mot: "Où l'on devait étouffer d'exil". Mais chez Kafka on ne parle nulle part d'exil. Exil et étrangeté sont des notions différentes. K. faisant l'amour n'est pas chassé de quelque chez-soi, il n'est pas banni (il n'est donc pas à plaindre); il est là où il est par sa propre volonté, il est là parce qu'il a osé y être. Le mot "exil" donne à la métaphore une aura de martyre, de souffrance, il la sentimentalise, la mélodramatise.
Читать дальше