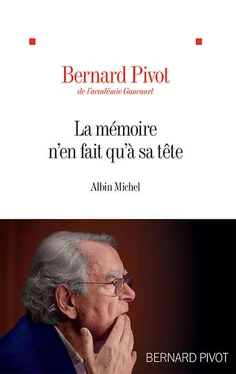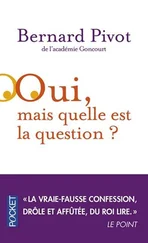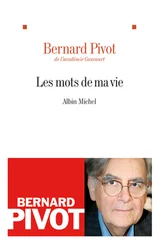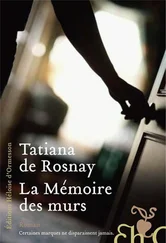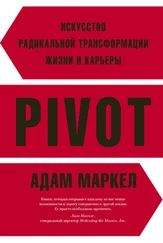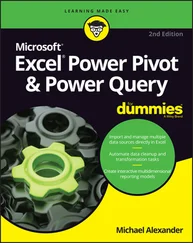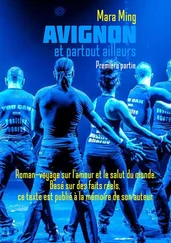C’était en juillet 1961, un an avant sa mort. Je l’avais invitée chez Drouant. L’auteur du Festin de Babette ne pouvait qu’être flattée de s’asseoir à l’une des bonnes tables de Paris. Elle n’ignorait pas que c’était dans ce restaurant que le prix Goncourt était décerné chaque année, comme elle savait que son nom était cité à Stockholm pour le prix Nobel de littérature. Drouant avait donc tout pour lui plaire. Mais quand je vis entrer dans le restaurant cet insecte fragile, soutenu par sa secrétaire, je compris mon erreur. La baronne Blixen n’avait pas la santé gourmande de Babette.
À cette époque, nous ignorions que son mari et cousin, le baron Bror von Blixen-Finecke, avait glissé la syphilis parmi ses cadeaux de noces. La maladie ravageait son corps depuis un demi-siècle. On avait dû lui enlever une partie de son estomac rongé d’ulcères. Elle ne se nourrissait plus que d’asperges, de jus de fruits, d’ampoules de gelée royale et de biscuits secs. Dans cette déshérence de la nourriture, comment avait-elle pu écrire Le Festin de Babette , ce chef-d’œuvre de la littérature gastronomique ?
La secrétaire et moi avons pris le menu, Karen Blixen se limitant à un artichaut et à un verre de vin blanc. Je notais ses paroles tout en mangeant. De ses yeux sombres, malicieux, elle observait le chassé-croisé dans ma main droite de la fourchette et du stylo. « Vous mangez trop vite, me dit-elle. Prenez le temps d’apprécier. Ne croyez pas que je souffre de ne pas pouvoir partager votre repas. Un jeune homme qui a faim est un beau spectacle. »
Combien de cigarettes a-t-elle fumées pendant deux heures ? Dans mon article, j’écrivais : « Elle tient sa cigarette du bout des doigts, la fume du bout des lèvres, et lance ses mots comme un oiseau ses cris, du bout du bec. » Elle a goûté quelques cerises. Et, sans rancune pour le café qui, autrefois, en Afrique, l’avait ruinée ( La Ferme africaine ), elle en a dégusté une tasse.
J’ai revécu ce déjeuner avec Karen Blixen grâce au livre de Dominique de Saint Pern, Baronne Blixen . Cinquante ans après, je mesure l’étendue de mon ignorance d’alors. Le journaliste n’est cependant pas tenu de tout connaître de la vie de l’écrivain qu’il interviewe. L’essentiel est dans l’œuvre. De sa lecture j’avais compris qu’elle tenait plus à l’amitié des hommes qu’à leur amour, compliqué, fugitif, à contretemps. Elle me l’a confirmé : « Je crois, entre nous, que j’avais un talent pour l’amitié. Je ne peux pas me passer de mes amis. Surtout de mes amis hommes. Moi, j’aime beaucoup les hommes (il ne faut pas le dire). Je trouve que l’homme est une créature admirable. Pour moi, le rôle de l’homme, c’est de faire ; le rôle de la femme, c’est d’être. » Sauf qu’au Kenya, c’était elle qui dirigeait la plantation, et non son volage et intermittent baron.
Dominique de Saint Pern raconte que, pour traiter les ravages de la syphilis, Karen Blixen avalait à chaque repas quelques gouttes d’arsenic délayées dans un verre d’eau. Un jour, le boy ayant oublié l’eau, elle avait bu de l’arsenic cul sec. Convaincue de mourir, elle se rappela soudain que, dans La Reine Margot , Alexandre Dumas faisait d’un mélange de lait et de blanc d’œuf un contrepoison de l’arsenic. La recette s’étant révélée efficace, elle tenait pour certain que la littérature et Alexandre Dumas lui avaient sauvé la vie.
Vladimir Nabokov : « Heureux le romancier qui parvient à conserver une lettre d’amour réelle, reçue dans sa jeunesse, à l’intérieur d’un ouvrage d’imagination, enfouie là-dedans comme une balle intacte dans la chair molle, et bien à l’abri, parmi des vies d’emprunt », Autres rivages .
J’ai moins reçu de lettres d’amour que je n’en ai envoyé. À mon souvenir, c’étaient plus des billets, des petits mots que des lettres. Je les rangeais dans une anthologie de la poésie. Quel romancier m’aurait paru digne de mêler ses petites histoires à la mienne ? Seuls les poètes avaient assez de sensibilité pour accueillir et apprécier les brefs mais tendres épanchements dont j’étais quelquefois l’objet. Ce n’était pas les magnifiques lettres de Tamara à Vladimir. Nabokov y répondait par des poèmes qu’il eut l’imprudence de faire éditer, et il ne se consolait pas de ce qu’il en restât un exemplaire à la Bibliothèque de Moscou.
J’ai aussi commis quelques poèmes de jeunesse et d’amour. Ils offensaient gravement Alfred de Musset. Ils disparurent avant qu’il eût le temps de protester. Les déménagements furent fatals au volume de l’anthologie poétique et à ses minuscules trésors.
L’ouragan des Soviets ayant chassé Nabokov de Saint-Pétersbourg et l’ayant séparé de Tamara, il n’a pas su non plus conserver ses lettres d’amour « à l’intérieur d’un ouvrage d’imagination », ou ailleurs.
À une jeune Lyonnaise de mon quartier dont j’étais timidement amoureux, j’avais fait passer un exemplaire de La Chartreuse de Parme . J’y avais intercalé une feuille de papier sur laquelle j’avais écrit à peu près ceci : « Heureux les beaux yeux qui liront ce livre ! Tous les Fabrice ont dans le regard une lumière inextinguible. » J’avais découvert quelques jours plus tôt l’adjectif « inextinguible » et j’avais cru malin, pour faire le savant, de le placer dans cette tortueuse déclaration d’amour. Comme si un seul mot pouvait séduire une femme ! Même des lettres enflammées, écrites d’une main talentueuse, ne parviennent pas à ouvrir un cœur cadenassé. Même le plus beau des livres sera sans effet. Voyez Stendhal, justement, que Métilde Dembowski repoussa avec encore plus de cruauté après sa lecture de De l’amour qu’avant.
Croire qu’une lettre joliment tournée touchera le cœur de la cible, c’est au fond croire à la littérature. C’est la doter de pouvoirs rationnels ou magiques. C’est être convaincu qu’elle est capable de changer le lecteur.
Ainsi des 1 218 lettres écrites par François Mitterrand à Anne Pingeot ( Lettres à Anne ) de 1962 à 1995. Elle a dix-neuf ans, lui quarante-six. Il est marié, il a deux fils, il ne divorcera jamais. Il a été onze fois ministre sous la IV e République. Il a été député, puis sénateur. Il ambitionne de devenir le rival de De Gaulle sous la V eRépublique. De tous les hommes politiques il est l’un des plus ambitieux, des plus occupés, des plus sollicités, des moins disponibles. Il a vingt-sept ans de plus que la jeune fille dont il s’est épris et il n’a et n’aura jamais beaucoup de temps à lui consacrer. Comment la séduire ? Comment, surtout, la retenir ? Comment d’elle se faire admirer et aimer, jamais dans la lumière, toujours dans l’ombre ? Comment, de loin, la rendre heureuse et fière de leur couple caché, très intermittent ? Par les lettres — nombreuses, longues, ferventes, soignées, brûlantes — qu’il lui écrira sans jamais se lasser et qu’elle lira en se disant et répétant que grande est sa chance de susciter la passion épistolaire d’un amant aussi célèbre et talentueux.
Autrement dit, dès le début de leur liaison, François Mitterrand a compris que sa seule arme pour être aimé durablement d’Anne Pingeot, c’était la littérature.
Comme pour illustrer cet engagement, il a accompagné sa première lettre de l’exemplaire du Socrate qu’il possédait. Puis, il lui a fait tenir un exemplaire des Justes de Camus. Enfin, c’est dans une librairie de Saint-Germain-des-Prés qu’il lui a donné leur premier rendez-vous parisien.
Ma correspondance amoureuse n’a pas été aussi efficace que celle de Mitterrand, oh non ! Je me souviens d’une lettre écrite à une cousine lointaine — lointaine par les liens de famille et par la géographie. Cette lettre était si belle, si éloquente, et comme gonflée de ma respiration retenue, puis relâchée avec volupté, que je n’ai pas douté un seul instant de son heureux résultat. La méchante cousine ne m’a dit ni oui ni non. Cela fait soixante et un ans que j’attends sa réponse. Ce doit être non, probablement.
Читать дальше