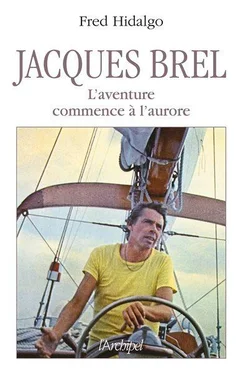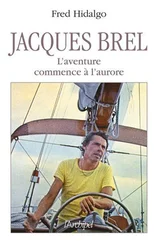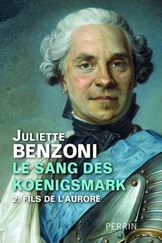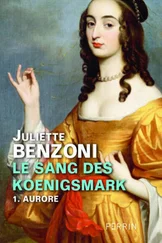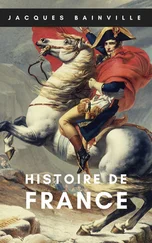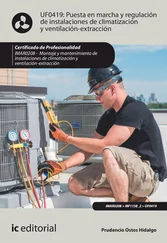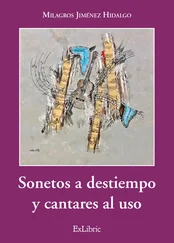Dans la dernière lettre qu’il écrivit d’Atuona, quelques semaines avant sa mort, au critique d’art Charles Morice [77] Journaliste, poète et écrivain symboliste, auteur notamment de La Littérature de tout à l’heure , Charles Morice (1861–1919) écrivit à la fin de sa vie un livre sur son ami, Paul Gauguin , édité à Paris par H. Floury.
, Paul Gauguin, humble et incroyablement lucide à la fois, écrivait : « Tout ce que j’ai appris des autres m’a gêné. Je peux donc dire : personne ne m’a rien appris ; il est vrai que je sais si peu de chose ! Mais je préfère ce peu de chose qui est de moi-même. Et qui sait si ce peu de chose, exploité par d’autres, ne deviendra pas une grande chose ? »
1 er janvier 1976 : invité par le maire à participer aux festivités de la commune sur la plage du « port », Jacques retrouve les sœurs qui, aux antipodes des bigotes de sa chanson, ne se sont pas formalisées de son débarquement intempestif quelques semaines plus tôt ; elles l’ont aussitôt accepté tel qu’il veut apparaître : athée, ô grâce à Dieu ! En réalité, les sœurs l’ont même adoubé, en l’accueillant à l’école quelques jours auparavant sur les conseils de Marc Bastard, le prof d’anglais et de maths : « Nous avons la chance d’avoir un grand chanteur parmi nous. Je pourrais lui proposer de venir parler de son métier aux élèves de l’école ? Mais je ne suis pas sûr qu’il accepte… » Sous-entendu : parce qu’il n’aime pas trop les représentants de l’Église, quels qu’ils soient, et qu’il n’a nulle envie, d’autre part, de parler de sa propre carrière. Mais sœur Rose, ou plutôt mère Rose, donne néanmoins son accord et, contre toute attente, Jacques aussi, sans se faire prier !
Mère Rose témoignera elle-même de ce premier contact avec l’artiste [78] Auprès d’Eddy Przybylski (pour Jacques Brel, la valse à mille rêves , L’Archipel, 2008), le dernier des rares biographes de Brel à s’être rendus sur place (après Pierre Berruer, Olivier Todd et Marc Robine, les deux premiers au début des années 1980, le troisième en 1998 et le quatrième dix ans plus tard).
. Celui-ci ayant souhaité que les élèves préparent des questions, elle en avait informé le professeur de français chargé de l’accueillir dans sa classe. Mais les questions s’étant révélées superficielles, Jacques Brel « a pris la direction des opérations ». Par discrétion et « puisqu’il n’aimait pas les bonnes sœurs, se rappelle-t-elle, je n’ai pas voulu m’imposer et je n’ai pas assisté à cette rencontre. Je ne sais pas ce que Jacques Brel a raconté aux enfants. Mais, d’où j’étais, je les entendais rire beaucoup ». Après cela, mère Rose va quand même au-devant de lui « pour le saluer et lui proposer un rafraîchissement. Puisqu’il était belge, j’avais préparé une bière qu’il a acceptée volontiers. Et là, miracle ! Il s’est mis à me parler comme si nous nous connaissions depuis toujours. Il semblait content d’être là ».
Cette petite causerie, mine de rien, fut la première occasion pour Brel de s’impliquer dans la vie de la commune. Peu à peu, il marqua celle-ci de son empreinte, à travers quantité de services rendus. Notamment le transport inter-îles régulier du courrier et des personnes, à partir de début 1977, aux manettes de son Jojo . Parmi ces dernières, des pensionnaires du collège Sainte-Anne qui, sans lui, n’auraient pu retrouver leurs familles à Noël ou à Pâques dans leur île d’origine ; quelque trente-cinq ans après, devenues mères de famille (voire enseignantes dans le même établissement, toujours tenu par les sœurs qui se comptent à présent sur les doigts d’une main), elles en conservent un souvenir ému. Il lui arrivait aussi d’effectuer des évacuations sanitaires à Taiohae, voire à Papeete, en cas d’urgence. Marc Bastard : « Ce n’était certainement pas par hasard qu’il avait choisi d’incarner Don Quichotte ! »
De façon plus « terre à terre », une fois établi dans cette ville assoupie où s’efface même le rythme des saisons, où l’on pourrait se contenter d’écouter pousser ses cheveux, Jacques se désolait pour les habitants du manque d’activités culturelles. Il fit donc en sorte de leur apporter le cinéma, en se chargeant lui-même des projections en plein air : « En ce temps-là, racontait Bastard, les distractions étaient rares. La télévision n’était pas encore installée. Il y avait bien, à la Mission, un projecteur 16 mm qui passait le samedi soir des films antédiluviens, à l’exception de ceux que les bateaux de guerre de passage prêtaient pendant une ou deux soirées », mais rien de plus. Alors, en 1976, Brel décida de remédier à la situation. Il remua ciel et terre et, après avoir convaincu le maire Guy Rauzy de lui « prêter » un terrain au centre du village et surtout de bâtir un grand mur blanc en guise d’écran (« Il voulait ouvrir les Marquisiens au monde, eux qui n’en connaissaient pratiquement rien », expliquera l’élu), il écrivit à son ami Claude Lelouch, le 8 octobre, avec lequel il avait tourné L’aventure c’est l’aventure (« Vraiment, on ne peut pas laisser ces gens crever idiots ! »), puis contacta le cousin tahitien de Fiston Amaru, le postier d’Hiva Oa, qui était exploitant de salle à Papeete.
Au final, il obtint non pas un mais deux projecteurs 35 mm (pour éviter l’interruption due au nécessaire changement de bobines [79] Des projecteurs « portables » japonais Tokiwa, de type T-60 aujourd’hui exposés à l’Espace Brel d’Atuona (mais aussi à la rouille !).
), ainsi que les grands films qu’il souhaitait projeter et qu’on lui expédiait gracieusement, moyennant le seul paiement des frais de transport et d’assurance.
Le samedi soir, tout le village était rassemblé, plusieurs centaines de spectateurs assis dans l’herbe ou sur des chaises qu’ils apportaient avec eux, sur l’emplacement même qu’occupait jadis la jolie Maison du jouir… La nuit étoilée pour tout décor, Jacques assisté de Maddly au son et à l’image. Tarif de la séance : 100 francs Pacifique (l’équivalent de 5 FF), quatre fois moins cher qu’à Tahiti ; une contribution symbolique, mais pour le principe, pour montrer que la culture se mérite et qu’elle n’est pas sans valeur. Et, pour faire face à un écueil inattendu, la difficulté de mêler tous les publics, les enfants se laissant aller à un enthousiasme pour le moins bruyant, Jacques proposa deux séances hebdomadaires différentes : l’une pour le jeune public, l’autre réservée aux adultes. Puis il forma un jeune projectionniste local pour assurer la suite.
Entre les deux guerres, le navigateur Alain Gerbault avait introduit le football aux Marquises, qui reste — après les courses de pirogue — le premier sport pratiqué dans l’archipel. Jacques Brel y aura apporté son Cinéma Paradiso à lui. Après sa mort, Maddly essaiera de continuer l’œuvre entreprise, mais l’arrivée de la vidéo au début des années 1980 sonnera le glas de ce Far West marquisien rêvé (pressenti ?) dès l’enfance bruxelloise, du temps où on l’appelait Jacky.
L’enfance,
Qui nous empêche de la vivre ?
De la revivre infiniment ?
[…] C’est encore le droit de rêver
Et le droit de rêver encore [80] L’Enfance (© Éditions musicales Pouchenel), tirée du film Le Far West , 1973.
…
Sans être un intime de Brel ni appartenir au premier cercle de ses amis, Jean Saucourt, bien connu sur place, le rencontrait régulièrement dans le village, sur les pistes de l’île et même à domicile. Avec sa femme Aline, il ne manquait aucune de ces soirées cinéma. Il se souvient de films à grand spectacle, comme Le Jour le plus long ou Paris brûle-t-il ? , mais aussi de films avec Raimu, son acteur préféré, de Bonnie and Clyde ou encore de Grease , le film qui lança le disco, projeté en avant-première de Papeete. « Pour la prochaine séance, suggéra-t-il un jour aux sœurs, qui assistaient volontiers aux projections, j’irai chercher La Bible . À moins que nous ne préfériez une belle histoire d’amour [81] Rapporté par Eddy Przybylski, op. cit.
… » Lui arriva-t-il de mettre à l’affiche l’un de ses films ? Sinon comme réalisateur, au moins comme interprète ? Nous l’avons demandé à Jean Saucourt.
Читать дальше