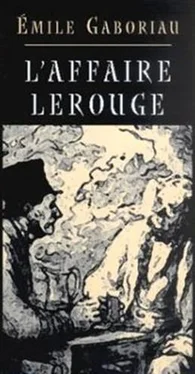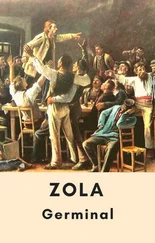Sa conviction, involontairement formée lorsque Clergeot lui avait révélé les folies de Noël, s’était depuis fortifiée de mille circonstances; chez Juliette il avait été sûr, et pourtant, à ce dernier moment, lorsque le doute devenait absolument impossible, en voyant éclater l’évidence, il fut atterré.
– Allons! s’écria-t-il enfin, il s’agit maintenant de le prendre!
Et sans perdre une minute, il se fit conduire au Palais de Justice où il espérait rencontrer le juge d’instruction. Malgré l’heure, en effet, M. Daburon n’avait pas encore quitté son cabinet.
Il causait avec le comte de Commarin, qu’il venait de mettre au fait des révélations de Pierre Lerouge, que le comte croyait mort depuis plusieurs années.
Le père Tabaret entra comme un tourbillon, trop éperdu pour faire attention à la présence d’un étranger.
– Monsieur! s’écria-t-il, bégayant de rage, monsieur, nous tenons l’assassin véritable! C’est lui, c’est mon fils d’adoption, mon héritier, c’est Noël!
– Noël!… répéta M. Daburon en se levant.
Et plus bas il ajouta:
– Je l’avais deviné.
– Ah! il faut un mandat bien vite, continua le bonhomme; si nous perdons une minute, il nous file entre les doigts! Il se sait découvert, si sa maîtresse l’a prévenu de ma visite. Hâtons-nous, monsieur le juge, hâtons-nous!
M. Daburon ouvrit la bouche pour demander une explication, mais le vieux policier poursuivit:
– Ce n’est pas tout encore: un innocent, Albert, est en prison…
– Il n’y sera plus dans une heure, répondit le magistrat; un moment avant votre arrivée, j’ai pris toutes mes dispositions pour sa mise en liberté; occupons-nous de l’autre.
Ni le père Tabaret ni M. Daburon ne remarquèrent la disparition du comte de Commarin. Au nom de Noël, il avait gagné doucement la porte et s’était élancé dans la galerie.
Noël avait promis de faire toutes les démarches du monde, de tenter l’impossible pour obtenir l’élargissement d’Albert.
Il visita en effet quelques membres du parquet et sut se faire repousser partout.
À quatre heures, il se présentait à l’hôtel Commarin pour apprendre au comte le peu de succès de ses efforts.
– Monsieur le comte est sorti, lui dit Denis, mais si monsieur veut prendre la peine de l’attendre…
– J’attendrai, répondit l’avocat.
– Alors, reprit le valet de chambre, je prierai monsieur de vouloir bien me suivre, j’ai ordre de monsieur le comte d’introduire monsieur dans son cabinet.
Cette confiance donnait à Noël la mesure de sa puissance nouvelle. Il était chez lui, désormais, dans cette magnifique demeure; il y était le maître, l’héritier. Son regard, qui inventoriait la pièce, s’arrêta sur le tableau généalogique suspendu près de la cheminée. Il s’en approcha et lut.
C’était comme une page, et des plus belles, arrachée au livre d’or de la noblesse française. Tous les noms qui dans notre histoire ont un chapitre ou un alinéa s’y retrouvaient. Les Commarin, avaient mêlé leur sang à toutes les grandes maisons. Deux d’entre eux avaient épousé des filles de familles régnantes.
Une chaude bouffée d’orgueil gonfla le cœur de l’avocat, ses tempes battirent plus vite, il releva fièrement la tête en murmurant:
– Vicomte de Commarin!
La porte s’ouvrit; il se retourna, le comte entrait.
Déjà Noël s’inclinait respectueusement: il fut pétrifié par le regard chargé de haine, de colère et de mépris de son père. Un frisson courut dans ses veines, ses dents claquèrent, il se sentit perdu.
– Misérable! s’écria le comte.
Et redoutant sa propre violence, le vieux gentilhomme jeta sa canne dans un coin. Il ne voulait pas frapper son fils, il le jugeait indigne d’être frappé de sa main. Puis il y eut entre eux une minute de silence mortel qui leur parut à tous deux durer un siècle. L’un et l’autre, en un instant, furent illuminés de réflexions qu’il faudrait un volume pour traduire. Noël osa parler le premier.
– Monsieur…, commença-t-il.
– Ah! taisez-vous, au moins, fit le comte d’une voix sourde, taisez-vous! Se peut-il, grand Dieu! que vous soyez mon fils? Hélas! je n’en puis douter, maintenant. Malheureux, vous saviez bien que vous étiez le fils de madame Gerdy! Infâme! Non seulement vous avez tué, mais vous avez mis tout en œuvre pour faire retomber votre crime sur un innocent! Parricide! vous avez tué votre mère!
L’avocat essaya de balbutier une protestation.
– Vous l’avez tuée, poursuivit le comte avec plus d’énergie, sinon par le poison, du moins par votre crime. Je comprends tout maintenant. Elle n’avait plus le délire, ce matin… Mais vous savez aussi bien que moi ce qu’elle disait. Vous écoutiez, et si vous avez osé entrer lorsqu’un mot de plus allait vous perdre, c’est que vous aviez caché l’effet de votre présence. C’est bien à vous que s’adressait sa dernière parole: «Assassin!»
Peu à peu Noël s’était reculé jusqu’au fond de la pièce, et il s’y tenait, adossé à la muraille, le haut du corps rejeté en arrière, les cheveux hérissés, l’œil hagard. Un tremblement convulsif le secouait. Son visage trahissait l’effroi le plus horrible à voir, l’effroi du criminel découvert.
– Je sais tout, vous le voyez, poursuivait le comte, et je ne suis pas le seul à tout savoir. À cette heure, un mandat d’arrêt est décerné contre vous.
Un cri de rage, sorte de râle sourd, déchira la poitrine de l’avocat. Ses lèvres, que la terreur faisait affaissées et pendantes, se crispèrent. Foudroyé au milieu du triomphe, il se roidissait contre l’épouvante. Il se redressa avec un regard de défi.
M. de Commarin, sans paraître prendre garde à Noël, s’approcha de son bureau et ouvrit un tiroir.
– Mon devoir, dit-il, serait de vous livrer au bourreau qui vous attend. Je veux bien me souvenir que j’ai le malheur d’être votre père. Asseyez-vous! écrivez et signez la confession de votre crime. Vous trouverez ensuite des armes dans ce tiroir. Que Dieu vous pardonne!…
Le vieux gentilhomme fit un mouvement pour sortir. Noël l’arrêta d’un geste, et sortant de sa poche un revolver à quatre coups:
– Vos armes sont inutiles, monsieur, fit-il; mes précautions, vous le voyez, sont prises; on ne m’aura pas vivant. Seulement…
– Seulement? interrogea durement le comte.
– Je dois vous déclarer, monsieur, reprit froidement l’avocat, que je ne veux pas me tuer… au moins en ce moment.
– Ah! s’écria M. de Commarin d’un ton de dégoût, il est lâche!
– Non, monsieur, non. Mais je ne me frapperai que lorsqu’il me sera bien démontré que toute issue m’est fermée, que je ne puis pas me sauver.
– Misérable! fit le comte menaçant, faudra-t-il donc que moi-même?…
Il s’élança vers le tiroir, mais Noël le referma d’un coup de pied.
– Écoutez-moi, monsieur, dit l’avocat de cette voix rauque et brève que donne aux hommes l’imminence du danger, ne perdons pas en paroles vaines le moment de répit qui m’est laissé. J’ai commis un crime, c’est vrai, et je ne cherche pas à me justifier, mais qui donc l’avait préparé, sinon vous? Maintenant vous me faites la faveur de m’offrir un pistolet: merci! je refuse. Cette générosité n’est pas à mon adresse. Avant tout, vous voulez éviter le scandale de mon procès et la honte qui ne manquera pas de rejaillir sur votre nom.
Le comte voulut répliquer.
– Laissez donc! interrompit Noël d’un ton impérieux. Je ne veux pas me tuer. Je veux sauver ma tête, s’il est possible. Fournissez-moi les moyens de fuir, et je vous promets que je serai mort avant d’être pris. Je dis: fournissez-moi les moyens, parce que je n’ai pas vingt francs à moi. Mon dernier billet de mille étant flambé le jour où… vous m’entendez. Il n’y a pas chez ma mère de quoi la faire enterrer. Donc, de l’argent!
Читать дальше