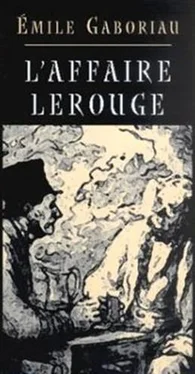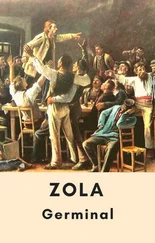– Saurons-nous ou ne saurons-nous pas les antécédents de cette vieille femme? répétait le père Tabaret, tout est là désormais.
– Nous les connaîtrons, répondait le juge, si l’épicière a dit vrai. Si le mari de la veuve Lerouge a navigué, si son fils Jacques est embarqué, le ministère de la Marine nous aura vite donné les éléments qui nous manquent. J’écrirai ce soir même.
Ils arrivèrent à la station de Rueil et prirent le chemin de fer. Le hasard les servit bien. Ils se trouvèrent seuls dans un compartiment de première.
Mais le père Tabaret ne causait plus. Il réfléchissait, il cherchait, il combinait, et sur sa physionomie on pouvait suivre le travail de sa pensée. Le juge le considérait curieusement, intrigué par le caractère de ce singulier bonhomme, qu’une passion, pour le moins originale, mettait au service de la rue de Jérusalem.
– Monsieur Tabaret, lui demanda-t-il brusquement, y a-t-il longtemps, dites-moi, que vous faites de la police?
– Neuf ans, monsieur le juge, neuf ans passés, et je suis assez surpris, permettez-moi de vous l’avouer, que vous n’ayez pas déjà entendu parler de moi.
– Je vous connaissais de réputation sans m’en douter, répondit M. Daburon, et c’est en entendant célébrer votre talent que j’ai eu l’excellente idée de vous faire appeler. Je me demande seulement ce qui a pu vous pousser dans cette voie?
– Le chagrin, monsieur le juge, l’isolement, l’ennui. Ah! je n’ai pas toujours été heureux, allez!…
– On m’a dit que vous étiez riche.
Le bonhomme poussa un gros soupir qui révélait à lui seul les plus cruelles déceptions.
– Je suis à mon aise, en effet, répondit-il, mais il n’en a pas toujours été ainsi. Jusqu’à quarante-cinq ans j’ai vécu de sacrifices et de privations absurdes et inutiles. J’ai eu un père qui a flétri ma jeunesse, gâté ma vie et fait de moi le plus à plaindre des hommes.
Il est de ces professions dont le caractère est tel qu’on ne parvient jamais à le dépouiller entièrement. M. Daburon était toujours et partout un peu juge d’instruction.
– Comment! monsieur Tabaret, interrogea-t-il, votre père est l’auteur de toutes vos infortunes?
– Hélas! oui, monsieur. Je lui ai pardonné à la longue, autrefois je l’ai bien maudit. J’ai jadis accablé sa mémoire de toutes les injures que peut inspirer la haine la plus violente, lorsque j’ai su… Mais je puis bien vous confier cela. J’avais vingt-cinq ans, et je gagnais deux mille francs par an au Mont-de-Piété, quand un matin mon père entra chez moi et m’annonce brusquement qu’il est ruiné, qu’il ne lui reste plus de quoi manger. Il paraissait au désespoir et parlait d’en finir avec la vie. Moi, je l’aimais. Naturellement je le rassure, je lui embellis ma situation, je lui explique longuement que, tant que je gagnerai de quoi vivre, il ne manquera de rien, et, pour commencer, je lui déclare que nous allons demeurer ensemble. Ce qui fut dit fut fait, et pendant vingt ans je l’ai eu à ma charge, le vieux…
– Quoi! vous vous repentez de votre honorable conduite, monsieur Tabaret?
– Si je m’en repens! C’est-à-dire qu’il aurait mérité d’être empoisonné par le pain que je lui donnais!
M. Daburon laissa échapper un geste de surprise qui fut remarqué du bonhomme.
– Attendez avant de me condamner, continua-t-il. Donc, me voilà, à vingt-cinq ans, m’imposant pour le père les plus rudes privations. Plus d’amis, plus d’amourettes, rien. Le soir, pour augmenter nos revenus, j’allais copier les rôles chez un notaire. Je me refusais jusqu’à du tabac. J’avais beau faire, le vieux se plaignait sans cesse, il regrettait son aisance passée, il lui fallait de l’argent de poche, pour ceci, pour cela; mes plus grands efforts ne parvenaient pas à le contenter. Dieu sait ce que j’ai souffert!
» Je n’étais pas né pour vivre et vieillir seul comme un chien. J’ai la bosse de la famille. Mon rêve aurait été de me marier, d’adorer une bonne femme, d’en être un peu aimé et de voir grouiller autour de moi des enfants bien venants. Mais bast… quand ces idées me serraient le cœur à m’étouffer et me tiraient une larme ou deux, je me révoltais contre moi. Je me disais: mon garçon, quand on ne gagne que trois mille francs par an, et qu’on possède un vieux père chéri, on étouffe ses sentiments et on reste célibataire. Et cependant j’avais rencontré une jeune fille! Tenez, il y a trente ans de cela: eh bien! regardez-moi, je dois ressembler à une tomate… Elle s’appelait Hortense. Qui sait ce qu’elle est devenue? Elle était belle et pauvre. Enfin j’étais un vieillard lorsque mon père est mort, le misérable, le…
– Monsieur Tabaret! interrompit le juge; oh! monsieur Tabaret!
– Mais puisque je vous affirme que je lui ai donné son absolution, monsieur le juge! Seulement, vous allez comprendre ma colère. Le jour de sa mort, j’ai trouvé dans son secrétaire une inscription de vingt mille francs de rentes!…
– Comment! il était riche?
– Oui, très riche, car ce n’était pas là tout. Il possédait près d’Orléans une propriété affermée six mille francs par an. Il avait en outre une maison, celle que j’habite. Nous y demeurions ensemble, et moi, sot, niais, imbécile, bête brute, tous les trois mois je payais notre terme au concierge.
– C’était fort! ne put s’empêcher de dire M. Daburon.
– N’est-ce pas, monsieur? C’était me voler mon argent dans ma poche. Pour comble de dérision, il laissait un testament où il déclarait au nom du Père et du Fils n’avoir en vue, en agissant de la sorte, que mon intérêt. Il voulait, écrivait-il, m’habituer à l’ordre, à l’économie, et m’empêcher de faire des folies. Et j’avais quarante-cinq ans, et depuis vingt ans je me reprochais une dépense inutile d’un sou! C’est-à-dire qu’il avait spéculé sur mon cœur, qu’il avait… Ah! c’est à dégoûter de la piété filiale, parole d’honneur!
La très légitime colère du père Tabaret était si bouffonne, qu’à grand-peine le juge se retenait de rire, en dépit du fond réellement douloureux de ce récit.
– Au moins, dit-il, cette fortune dut vous faire plaisir?
– Pas du tout, monsieur, elle arrivait trop tard. Avoir du pain quand on n’a plus de dents, la belle avance! L’âge du mariage était passé. Cependant je donnai ma démission pour faire place à plus pauvre que moi. Au bout d’un mois, je m’ennuyais à périr; c’est alors que, pour remplacer les affections qui me manquent, je résolus de me donner une passion, un vice, une manie. Je me mis à collectionner des livres. Vous pensez peut-être, monsieur, qu’il faut pour cela certaines connaissances, des études…
– Je sais, cher monsieur Tabaret, qu’il faut surtout de l’argent. Je connais un bibliophile illustre qui doit savoir lire, mais qui à coup sûr est incapable de signer son nom.
– C’est bien possible. Moi aussi, je sais lire, et je lisais tous les livres que j’achetais. Je vous dirai que je collectionnais uniquement ce qui de près ou de loin avait trait à la police. Mémoires, rapports, pamphlets, discours, lettres, romans, tout m’était bon, et je le dévorais. Si bien que peu à peu je me suis senti attiré vers cette puissance mystérieuse qui, du fond de la rue de Jérusalem, surveille et garde la société, pénètre partout, soulève les voiles les plus épais, étudie l’envers de toutes les trames, devine ce qu’on ne lui avoue pas, sait au juste la valeur des hommes, le prix des consciences, et entasse dans ses cartons verts les plus redoutables comme les plus honteux secrets.
» En lisant les mémoires des policiers célèbres, attachants à l’égal des fables les mieux ourdies, je m’enthousiasmais pour ces hommes au flair subtil, plus déliés que la soie, souples comme l’acier, pénétrants et rusés, fertiles en ressources inattendues, qui suivent le crime à la piste, le code à la main, à travers les broussailles de la légalité, comme les sauvages de Cooper poursuivent leur ennemi au milieu des forêts de l’Amérique. L’envie me prit d’être un rouage de l’admirable machine, de devenir aussi, moi, une providence au petit pied, aidant à la punition du crime et au triomphe de l’innocence. Je m’essayai, et il se trouve que je ne suis pas trop impropre au métier.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу