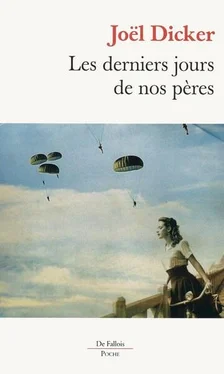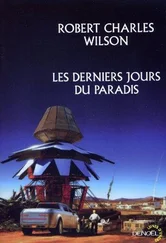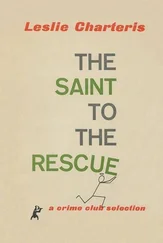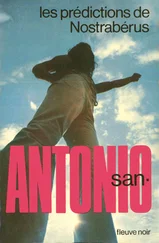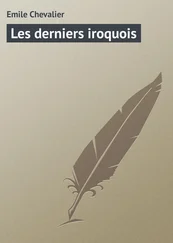Stanislas vivait dans son appartement de Knightsbridge, et Laura, elle, était retournée chez ses parents à Chelsea, expliquant que son unité de la FANY avait bénéficié d’une permission. À la fin de son école du SOE, elle avait pu passer quelques jours avec sa famille ; elle avait dit qu’elle s’était engagée dans une unité qu’on enverrait bientôt en Europe, pour n’avoir pas à mentir complètement. Ce genre d’explication était autorisé au sein du Service : les agents étaient officiellement soldats de l’armée britannique, incorporés dans le Rôle général, et les membres britanniques du SOE, lorsqu’ils partaient en mission, disaient à leur famille qu’ils partaient à la guerre comme n’importe quel mobilisé ; personne n’imaginait qu’ils allaient être parachutés derrière les lignes ennemies, au cœur d’un pays occupé, pour combattre les Allemands de l’intérieur. D’ailleurs, au sein de la Section F, le colonel Buckmaster mettait un soin particulier à rassurer les proches des agents en mission lorsque c’était possible, leur écrivant régulièrement une lettre-type évasive, qui disait plus ou moins ceci : Madame, Monsieur, ne vous inquiétez pas. Les nouvelles sont bonnes.
Elle passait ses journées avec ses camarades, ses soirées avec Pal ; elle ne rentrait à Chelsea qu’à l’aube, juste avant le lever de Suzy, la bonne. Fatiguée, elle jetait sa robe sur une chaise et plongeait dans son lit. Et elle soupirait d’aise, heureuse. Elle avait retrouvé Pal. Il l’avait certainement aimée d’abord ; elle se souvenait bien de leur rencontre à Wanborough, et surtout du moment où il s’était battu avec Faron. Les stagiaires s’entraînaient ensemble depuis deux ou trois semaines seulement, et tous détestaient déjà Faron, certes impressionnant mais toujours crasseux et mauvais. Dans le mess, lorsque le colosse l’avait passé à tabac, Pal avait eu dans le regard un éclat brillant, comme si la force physique de Faron ne pourrait jamais rien contre sa force morale. Par la suite, il s’était souvent distingué durant les entraînements et, malgré son jeune âge, on prêtait attention à ce qu’il disait. Il avait déjà une certaine réputation dans le Service. Décidément, il avait tout pour plaire. Après leur première nuit à Beaulieu, elle s’était sentie obligée de jouer à l’amour galant : lui avait dit des mots d’amour, et elle s’était contentée de badiner. Ils ne s’étaient plus revus, et les mois de séparation avaient été insupportables ; si elle ne le revoyait plus ? Elle s’en était tellement voulu, elle y avait tant pensé. Il avait fallu attendre presque dix mois, dix mois maudits, jusqu’à leurs retrouvailles un peu avant Noël, ici, à Londres, dans les bureaux de la Section F. Quel bonheur de le retrouver alors ! Il était bien là, entier. Superbe. Dans une pièce déserte, ils s’étaient étreints longuement, ils s’étaient couverts de baisers, et deux jours durant, ils étaient restés enfermés dans une chambre du Langham, le palace de Regent Street. C’est ainsi qu’elle avait réalisé combien elle l’aimait : comme elle n’avait jamais aimé, et comme elle n’aimerait jamais plus. Mais la première nuit, étendue dans l’immense lit contre Pal endormi, elle avait été envahie par le doute : et si lui ne l’aimait plus ? Après tout, elle avait été la seule fille qu’il ait pu fréquenter durant les mois de formation du SOE ; elle n’avait été peut-être qu’un amour de circonstance, il avait certainement rencontré d’autres filles, à Londres, et sur le terrain. La détresse des missions l’avait sans doute poussé à chercher du réconfort féminin, et puis ils ne s’étaient rien promis. Ah, pourquoi ne s’étaient-ils pas juré fidélité avant de partir ! Non, il avait fallu qu’elle fasse l’imbécile, cette nuit-là, à Beaulieu. Il lui avait dit qu’il l’aimait, elle avait eu envie de lui répondre qu’elle l’aimait plus encore, mais elle avait retenu ses mots. Comme elle le regrettait désormais. Oui, sans doute avait-il rencontré de jolies brunes qui lui offraient plus de tendresse qu’elle. Peut-être se forçait-il à être là, avec elle ? C’est ça, il se forçait, il ne l’aimait plus. Il retrouverait ses conquêtes en France, et elle mourrait de chagrin et de solitude.
Elle avait fini par s’endormir avant de se réveiller en sursaut : il n’était plus dans le lit. Il se tenait, immobile, dans un coin de la chambre ; tracassé par la marche du monde, il regardait par la fenêtre, la main droite posée comme souvent sur sa poitrine musclée, à l’endroit du cœur, comme s’il voulait cacher sa cicatrice.
Elle s’était levée aussitôt et l’avait enlacé.
— Pourquoi ne dors-tu pas ? avait-elle demandé tendrement.
— Ma cicatrice…
Sa cicatrice ? Il était blessé ! Elle s’était précipitée dans la salle de bains, à la recherche de bandage et de désinfectant ; n’en trouvant pas, elle avait voulu se jeter sur le téléphone pour sonner grooms et concierges, mais lorsqu’elle était réapparue dans la chambre, il avait souri, amusé :
— C’était une métaphore… Je vais bien.
Ah, elle s’était trouvée sotte ! La plus grande des sottes, debout dans la chambre, figée ; elle n’était qu’une stupide amante servile et affligeante.
Attendri, il l’avait prise dans ses bras pour la réconforter.
— Me diras-tu comment tu t’es fait cette cicatrice ?
— Un jour, oui.
Elle avait fait la moue ; elle n’aimait pas aimer autant.
— Quand me diras-tu, enfin ? Tu ne m’aimes plus ? Tu as rencontré quelqu’un, hein ? Si c’est le cas, dis-le-moi, je souffrirai moins de savoir…
Il avait posé un doigt sur ses lèvres. Et il avait murmuré :
— Je te dirai ma cicatrice, je te dirai tout. Je te dirai quand on se mariera.
Il l’avait embrassée dans le cou, elle avait eu un sourire éclatant et s’était serrée plus fort contre lui, fermant les yeux.
— Alors tu m’épouseras ?
— Bien sûr. Après la guerre. Ou pendant, si la guerre dure trop longtemps.
Elle avait ri. Oui, ils se marieraient. Dès la fin de la guerre. Et si la guerre ne finissait jamais, ils partiraient loin, ils iraient en Amérique, se mettre à l’abri du monde, et ils auraient la vie qu’ils méritaient. La plus belle que l’on puisse imaginer.
*
La permission à Londres avait des airs d’Espagne. Les agents en congé étaient à l’abri de l’Europe dans un univers feutré qui contrastait avec les situations vécues en France. Au sein du groupe, chacun vaqua à ses petites occupations. Le plus important était de ne pas trop songer au prochain départ pour la France ; l’insouciance faisait du bien.
Le matin, ils allaient courir dans Hyde Park, pour rester en forme. Puis ils passaient la journée à flâner ensemble, dans les magasins et les cafés. Dans les moments de désœuvrement, ils se rendaient en petites délégations discrètes à Portman Square, l’une des antennes de la Section F où Stanislas avait son bureau. Ils passaient lui rendre visite, bien que ce ne fût pas autorisé. Ils s’installaient dans le bureau de Stanislas, et ils y traînaient, à discuter de n’importe quoi et à boire du thé, persuadés de traiter d’affaires importantes. Les quartiers généraux du SOE n’étaient pas situés là mais aux numéros 53 et 54 de Baker Street, une adresse inconnue de la majorité des agents de terrain ; en cas de capture, ils ne pourraient jamais révéler la localisation précise du centre névralgique du Service. Portman Square, en fait, n’était qu’une antenne de la Section F — il en existait plusieurs — pour tromper la vigilance des chauffeurs de taxi et des agents allemands infiltrés dans la capitale, persuadés que Portman Square était le quartier général d’un centre clandestin français, sans savoir très bien de quoi il retournait.
Читать дальше