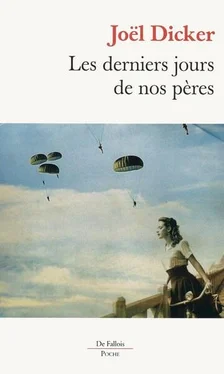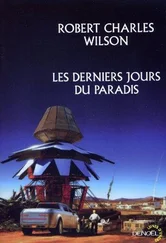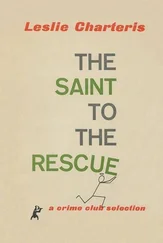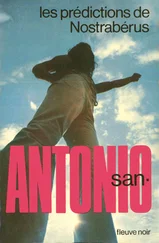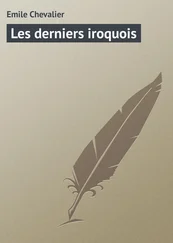Les deux heures passées, Pal sentit son cœur accélérer dans sa poitrine. Il reçut une ultime consigne d’un officier, puis le lieutenant Peter vint le trouver. Il l’attrapa par les épaules, comme Calland l’avait fait à Londres, comme son père l’avait fait à Paris. Pour lui donner du courage. Pal s’essaya en retour à un salut militaire, puis il serra vigoureusement la main du bon Lieutenant.
*
Il avait fait du stop. Prendre le train sans ticket, c’était risquer de s’exposer aux ennuis. À bord du camion de marchandises qui l’emmenait vers Manchester, Pal s’autorisa à s’assoupir. Il ignorait quand il pourrait dormir à nouveau, il fallait en profiter. La tête appuyée contre la vitre, il pensait à ses camarades, Aimé, Gros, Claude, Frank, Faron, Key, Stanislas, Denis, et Jos. Les reverrait-il ?
Il pensait à Laura.
Il pensait à son père.
Il pensait aussi à Prunier, à Dentiste, à Chou-Fleur, à Grand Didier, à tous les autres, à tous les agents de toutes nationalités qu’il avait côtoyés à Wanborough Manor, à Lochailort, à Ringway, à Beaulieu. Il pensait à tous ces gens ordinaires qui avaient fait le choix de leur destin. Il y avait là des plus ou moins beaux, des plus ou moins forts, certains avec des lunettes, des cheveux gras ou les dents de travers, d’autres bien bâtis et éloquents. Ils étaient des timides, des furieux, des esseulés, des prétentieux, des nostalgiques, des violents, des doux, des antipathiques, des généreux, des radins, des racistes, des pacifistes, des heureux, des mélancoliques, des lymphatiques, certains brillants, d’autres insignifiants, des couche-tôt, des noceurs, des étudiants, des ouvriers, des ingénieurs, des avocats, des journalistes, des chômeurs, des repentis, des dadaïstes, des communistes, des romantiques, des excentriques, des pathétiques, des courageux, des lâches, des valeureux, des pères, des fils, des mères, des filles. Rien que des humains ordinaires, devenus peuple de l’ombre pour le salut de l’Humanité en péril. Ils espéraient donc encore en l’espèce humaine, les malheureux ! Les malheureux.
Et Pal, sur une route à grand trafic du sud de l’Angleterre, récitait sa poésie, cette poésie tant de fois psalmodiée, et qu’il réciterait bientôt, sans le savoir encore, à bord de l’avion qui l’emmènerait en France dans le plus grand secret. Sa poésie du courage, celle de la butte des fumeurs de l’aube.
Que s’ouvre devant moi le chemin de mes larmes,
Car je suis à présent l’artisan de mon âme.
Je ne crains ni les bêtes, ni les Hommes,
Ni l’hiver, ni le froid, ni les vents.
Au jour où je pars vers les forêts d’ombres, de haines et de peur,
Que l’on me pardonne mes errements et que l’on me pardonne mes erreurs,
Moi qui ne suis qu’un petit voyageur,
Qui ne suis que la poudre du vent, la poussière du temps.
J’ai peur.
J’ai peur.
Nous sommes les derniers Hommes, et nos cœurs, en rage, ne battront plus longtemps.
C’était la mi-décembre : neuf mois s’étaient écoulés depuis la dernière école d’entraînement. La nuit était tombée dès l’après-midi ; la journée avait été courte, une de ces mauvaises journées d’hiver dont l’obscurité prématurée et subite fait perdre la notion du temps. Il faisait froid. La voiture avançait lentement, fendant l’obscurité, les phares éteints. On devinait aisément les champs et les vergers nus tout autour, et le chauffeur n’avait aucune peine à trouver son chemin : c’était une nuit claire de pleine lune, parfaite pour que les avions puissent naviguer à vue.
À côté du chauffeur, un homme en casquette jouait nerveusement avec le mécanisme de sécurité de sa mitraillette Sten ; sur la banquette arrière, les trois autres passagers avaient dû se serrer les uns contre les autres. À présent, chacun pouvait sentir les battements de cœur de son voisin, et les cœurs battaient vite. Seul Sabot avait l’air décontracté. À côté de lui, Pal tordait ses doigts dans la poche de son pantalon ; plus il y réfléchissait, plus il songeait que ce comité de réception était mal préparé. Ils n’auraient pas dû circuler tous ensemble : deux voitures, ç’aurait été plus prudent, ou envoyer un éclaireur à vélo. Tous dans le même véhicule, ils étaient à la merci de la première patrouille. Et puis ils n’étaient pas assez armés. En plus de l’homme à la mitraillette, Sabot et lui avaient chacun un colt de service, et le chauffeur un vieux revolver. Ce n’était pas assez. Ils auraient dû embarquer au moins deux tireurs avec des Sten ; ils pourraient peut-être tenir tête à des policiers français, mais pas à des soldats allemands. Sabot perçut l’inquiétude du jeune agent et lui fit un signe discret de la tête pour le rassurer. Pal s’apaisa un peu : Sabot était un homme d’expérience, il avait suivi la formation pour les responsables des comités de réception des avions de la RAF.
Les Britanniques avaient émis des directives strictes depuis que des responsables de comité de réception avaient emmené toute leur famille assister à un atterrissage, ou que, pire encore, des comités avaient entraîné dans leur sillage la moitié de leur village pour aller applaudir la venue d’un avion anglais dans une ambiance de bal populaire. Désormais un stage d’une semaine à Tangmere dispensé par des pilotes du 161e escadron de la RAF était obligatoire pour tous les responsables, et des consignes avaient été édictées par Londres : pas de famille, pas d’amis. Uniquement les membres du groupe nécessaires à l’atterrissage et chacun à une place bien précise, faute de quoi les indésirables risquaient d’être abattus par le pilote, si celui-ci n’avait pas décidé de rebrousser chemin sans se poser.
Mais malgré son apparence tranquille, Sabot n’était pas rassuré et il se maudissait lui-même en son for intérieur. Ah, il avait été trop imprudent ! Il savait pourtant, tous ces détails avaient été vus et revus durant ses différentes formations. Mais le terrain était une autre réalité. Ils avaient reçu le message par la BBC, l’avion viendrait ce soir. Il avait d’abord hésité ; deux hommes habituellement chargés d’assurer la sécurité de l’atterrissage manquaient. Mais il n’avait pas eu le choix : le vol avait été reporté deux fois déjà en raison de mauvaises conditions météo au-dessus de la Manche. Il avait remplacé ses deux tireurs par un seul, un type fiable mais mal aguerri. Sabot regrettait à présent, surtout en entendant les cliquetis agaçants de la mitraillette que tripotait l’homme à l’avant : un tireur nerveux n’était pas un bon tireur. Et leur sécurité dépendait grandement de lui.
La camionnette s’immobilisa enfin au bord de la route, au milieu de nulle part. Les cinq occupants en descendirent sans bruit. Le chauffeur sortit son vieux revolver de la boîte à gants et le cala dans sa ceinture ; il resta à côté du véhicule, les sens en alerte, tandis que Sabot répéta ses ordres à ses deux autres subordonnés, qui disparurent dans l’immense champ en jachère. Le premier, l’homme à la mitraillette, se plaça sur une butte, à deux cents mètres de là ; il se coucha dans l’herbe humide et arma sa Sten, scrutant la nuit derrière le viseur, à la recherche d’éventuels signes suspects. Le second, qui était l’assistant de Sabot, planta trois torches dans la terre balisant la piste en forme de « L », la pointe de la lettre signalant le sens du vent. Sabot, une lampe électrique éteinte à la main, s’assura que ses directives étaient scrupuleusement respectées et vérifia deux fois encore le sens du vent. Pal s’impatientait, inquiet. Sabot attendit encore quelques trop longues minutes, consultant sa montre, puis il donna l’ordre d’allumer les torches. En un instant, le champ désert se transforma en piste d’atterrissage, et Sabot contempla fièrement son aérodrome secret. C’était une parcelle large de deux ou trois cents mètres et longue de presque un kilomètre, l’un des meilleurs endroits de la région pour réceptionner un avion : on y avait même fait atterrir un bombardier Hudson. Pour le Westland Lysander qui devait venir ce soir, la moitié de la piste suffirait.
Читать дальше