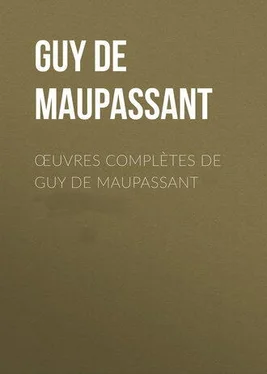Guy de Maupassant - Contes divers (1883)
Здесь есть возможность читать онлайн «Guy de Maupassant - Contes divers (1883)» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Классическая проза, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Contes divers (1883)
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Contes divers (1883): краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Contes divers (1883)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Contes divers (1883) — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Contes divers (1883)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
J’avais envie de répondre :
— Premier prix du Conservatoire, classe de comédie, engagée à l’Odéon, libre à partir du 5 août 1880 !
Quelle tête elle aurait fait, miséricorde !
20 juillet. — Berthe est vraiment surprenante. Pas une faute de tact, pas une faute de goût ; une merveille !
10 août. — Paris. Fini. J’ai le cœur gros. La veille du départ, je crus que tout le monde allait pleurer.
On résolut d’aller voir lever le soleil sur le Torrenthorn, puis de redescendre pour l’heure de notre départ.
On se mit en route vers minuit, sur des mulets. Des guides portaient des falots : et la longue caravane se déroulait dans les chemins tournants de la forêt de pins. Puis on traversa les pâturages où des troupeaux de vaches errent en liberté. Puis on atteignit la région des pierres, où l’herbe elle-même disparaît.
Parfois, dans l’ombre, on distinguait, soit à droite, soit à gauche, une masse blanche, un amoncellement de neige dans un trou de la montagne.
Le froid devenait mordant, piquait les yeux et la peau. Le vent desséchant des sommets soufflait, brûlant les gorges, apportant les haleines gelées de cent lieues de pics de glace.
Quand on parvint au faite, il faisait nuit encore. On déballa toutes les provisions pour boire le champagne au soleil levant.
Le ciel pâlissait sur nos têtes. Nous apercevions déjà un gouffre à nos pieds ; puis, à quelques centaines de mètres, un autre sommet.
L’horizon entier semblait livide, sans qu’on distinguât rien encore au loin.
Bientôt on découvrit, à gauche, une cime énorme, la Jungfrau, puis une autre, puis une autre. Elles apparaissaient peu à peu comme si elles se fussent levées dans le jour naissant. Et nous demeurions stupéfaits de nous trouver ainsi au milieu de ces colosses, dans ce pays désolé de la neige éternelle. Soudain, en face, se déroula la chaîne démesurée du Piémont. D’autres cimes apparurent au nord. C’était bien l’immense pays des grands monts aux fronts glacés, depuis le Rhindenhorn, lourd comme son nom, jusqu’au fantôme à peine visible du patriarche des Alpes, le mont Blanc.
Les uns étaient fiers et droits, d’autres accroupis, d’autres difformes, mais tous pareillement blancs, comme si quelque Dieu avait jeté sur la terre bossue une nappe immaculée.
Les uns semblaient si près qu’on aurait pu sauter dessus ; les autres étaient si loin qu’on les distinguait à peine.
Le ciel devint rouge ; et tous rougirent. Les nuages semblaient saigner sur eux. C’était superbe, presque effrayant.
Mais bientôt la nue enflammée pâlit, et toute l’armée des cimes insensiblement devint rose, d’un rose doux et tendre comme des robes de jeune fille.
Et le soleil parut au-dessus de la nappe des neiges. Alors, tout à coup, le peuple entier des glaciers fut blanc, d’un blanc luisant, comme si l’horizon eût été plein d’une foule de dômes d’argent.
Les femmes, extasiées, regardaient cela.
Elles tressaillirent, un bouchon de champagne venait de sauter ; et le prince de Vanoris, présentant un verre à Berthe, s’écria :
— Je bois à la marquise de Roseveyre !
Tous crièrent : « Je bois à la marquise de Roseveyre ! »
Elle monta debout sur sa mule et répondit :
— Je bois à tous mes amis !
Trois heures plus tard, nous prenions le train pour Genève, dans la vallée du Rhône.
À peine fûmes-nous seuls que Berthe, si heureuse et si gaie tout à l’heure, se mit à sangloter, la figure dans ses mains.
Je m’élançai à ses genoux :
— Qu’as-tu ? Qu’as-tu ? Dis-moi, qu’as-tu ?
Elle balbutia à travers ses larmes :
— C’est… c’est… c’est donc fini d’être une honnête femme !
Certes, je fus à ce moment sur le point de faire une bêtise, une grande bêtise !.. Je ne la fis pas.
Je quittai Berthe en rentrant à Paris. J’aurais peut-être été trop faible, plus tard.
(Le journal du marquis de Roseveyre n’offre aucun intérêt pendant les deux années qui suivirent. Nous retrouvons à la date du 20 juillet 1883 les lignes suivantes.)
20 juillet 1883. — Florence. Triste souvenir tantôt. Je me promenais aux Cassines quand une femme fit arrêter sa voiture et m’appela. C’était la princesse de Vanoris. Dès qu’elle me vit à portée de voix :
— Oh ! Marquis, mon cher marquis, que je suis contente de vous rencontrer ! Vite, vite, donnez-moi des nouvelles de la marquise ; c’est bien la plus charmante femme que j’aie vue en toute ma vie.
Je restai surpris, ne sachant que dire et frappé au cœur d’un coup violent. Je balbutiai :
— Ne me parlez jamais d’elle, princesse, voici trois ans que je l’ai perdue.
Elle me prit la main.
— Oh ! Que je vous plains, mon ami.
Elle me quitta. Je suis rentré triste, mécontent, pensant à Berthe, comme si nous venions de nous séparer.
Le Destin bien souvent se trompe !
Combien de femmes honnêtes étaient nées pour être des filles, et le prouvent.
Pauvre Berthe ! Combien d’autres étaient nées pour être des femmes honnêtes… Et celle-là… plus que toutes… peut-être… Enfin… n’y pensons plus.
24 juillet 1883
Un duel
La guerre était finie ; les Allemands occupaient la France ; le pays palpitait comme un lutteur vaincu tombé sous le genou du vainqueur.
De Paris affolé, affamé, désespéré, les premiers trains sortaient, allant aux frontières nouvelles, traversant avec lenteur les campagnes et les villages. Les premiers voyageurs regardaient par les portières les plaines ruinées et les hameaux incendiés. Devant les portes des maisons restées debout, des soldats prussiens, coiffés du casque noir à la pointe de cuivre, fumaient leur pipe, à cheval sur des chaises. D’autres travaillaient ou causaient comme s’ils eussent fait partie des familles. Quand on passait les villes, on voyait des régiments entiers manœuvrant sur les places, et, malgré le bruit des roues, les commandements rauques arrivaient par instants.
M. Dubuis, qui avait fait partie de la garde nationale de Paris pendant toute la durée du siège, allait rejoindre en Suisse sa femme et sa fille, envoyées par prudence à l’étranger, avant l’invasion.
La famine et les fatigues n’avaient point diminué son gros ventre de marchand riche et pacifique. Il avait subi les événements terribles avec une résignation désolée et des phrases amères sur la sauvagerie des hommes. Maintenant qu’il gagnait la frontière, la guerre finie, il voyait pour la première fois des Prussiens, bien qu’il eût fait son devoir sur les remparts et monté bien des gardes par les nuits froides.
Il regardait avec une terreur irritée ces hommes armés et barbus installés comme chez eux sur la terre de France, et il se sentait à l’âme une sorte de fièvre de patriotisme impuissant en même temps que ce grand besoin, que cet instinct nouveau de prudence qui ne nous a plus quittés.
Dans son compartiment, deux Anglais, venus pour voir, regardaient de leurs yeux tranquilles et curieux. Ils étaient gros aussi tous deux et causaient en leur langue, parcourant parfois leur guide, qu’ils lisaient à haute voix en cherchant à bien reconnaître les lieux indiqués.
Tout à coup, le train s’étant arrêté à la gare d’une petite ville, un officier prussien monta avec son grand bruit de sabre sur le double marchepied du wagon. Il était grand, serré dans son uniforme et barbu jusqu’aux yeux. Son poil roux semblait flamber, et ses longues moustaches, plus pâles, s’élançaient des deux côtés du visage qu’elles coupaient en travers.
Les Anglais aussitôt se mirent à le contempler avec des sourires de curiosité satisfaite, tandis que M. Dubuis faisait semblant de lire un journal. Il se tenait blotti dans son coin, comme un voleur en face d’un gendarme.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Contes divers (1883)»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Contes divers (1883)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Contes divers (1883)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.