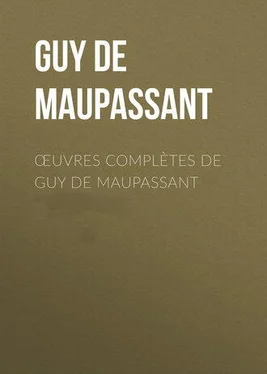Quand la nuit fut tout à fait tombée, je retournai dans la ville.
Un bruit de musique m’attirant me la fit traverser tout entière. Je trouvai une avenue que suivaient par groupes la bourgeoisie et le peuple, lentement, allant vers ce concert du soir, que lui donne deux ou trois fois par semaine l’orchestre municipal.
Ces orchestres, sur cette terre musicienne, valent, même dans les petites villes, ceux de nos bons théâtres. Je me rappelai celui que j’avais entendu du pont de mon bateau l’autre nuit, et dont le souvenir me restait comme celui d’une des plus douces caresses qu’une sensation m’ait jamais données.
L’avenue aboutissait à une place qui allait se perdre sur la plage, et là, dans l’ombre à peine éclairée par les taches espacées et jaunes des becs de gaz, cet orchestre jouait je ne sais trop quoi au bord des flots.
Les vagues un peu lourdes, bien que le vent du large fût tout à fait tombé, traînaient le long du rivage leur bruit monotone et régulier qui rythmait le chant vif des instruments ; et le firmament violet, d’un violet presque luisant, doré par une infinie poussière d’astres, laissait tomber sur nous une nuit sombre et légère. Elle couvrait de ses ténèbres transparentes la foule silencieuse à peine chuchotante, marchant à pas lents autour du cercle des musiciens ou bien assise sur les bancs de la promenade, sur de grosses pierres abandonnées le long de la grève, sur d’énormes poutres étalées à terre auprès de la haute carcasse de bois, aux côtes encore entrouvertes d’un grand navire en construction.
Je ne sais pas si les femmes de Savone sont jolies, mais je sais qu’elles se promènent presque toutes nu-tête, le soir, et qu’elles ont toutes un éventail à la main. C’était charmant, ce muet battement d’ailes prisonnières, d’ailes blanches, tachetées ou noires, entrevues, frémissantes comme de gros papillons de nuit tenus entre des doigts.
On retrouvait, à chaque femme rencontrée, dans chaque groupe errant ou reposé, ce volettement captif, ce vague effort pour s’envoler des feuilles balancées qui semblaient rafraîchir l’air du soir, y mêler quelque chose de coquet, de féminin, de doux à respirer pour une poitrine d’homme.
Et voilà qu’au milieu de cette palpitation d’éventails, et de toutes ces chevelures nues autour de moi, je me mis à rêver niaisement comme en des souvenirs de contes de fées, comme je faisais au collège, dans le dortoir glacé, avant de m’endormir, en songeant au roman dévoré en cachette sous le couvercle du pupitre. Parfois ainsi, au fond de mon cœur vieilli, empoisonné d’incrédulité, se réveille, pendant quelques instants, mon petit cœur naïf de jeune garçon.
Une des plus belles choses qu’on puisse voir au monde : Gênes, de la haute mer.
Au fond du golfe, la ville se soulève comme si elle sortait des flots, au pied de la montagne. Le long des deux côtes qui s’arrondissent autour d’elle pour l’enfermer, la protéger et la caresser, dirait-on, quinze petites cités, des voisines, des vassales, des servantes, reflètent et baignent dans l’eau leurs maisons claires. Ce sont, à gauche de leur grande patronne, Cogoleto, Arenzano, Voltri, Pra, Pegli, Sestri-Ponente, San Pier d’Arena ; et, à droite, Sturla, Quarto, Quinto, Nervi, Bogliasco, Sori, Recco, Camogli, dernière tache blanche sur le cap Porto-Fino qui ferme le golfe au sud-est.
Gênes au-dessus de son port immense se dresse sur les premiers mamelons des Alpes, qui s’élèvent par-derrière, courbée et s’allongeant en une muraille géante. Sur le môle une tour très haute et carrée, le phare appelé « la Lanterne », a l’air d’une chandelle démesurée.
On pénètre dans l’avant-port, énorme bassin admirablement abrité où circulent, cherchant pratique, une flotte de remorqueurs, puis, après avoir contourné la jetée est, c’est le port lui-même, plein d’un peuple de navires, de ces jolis navires du Midi et de l’Orient, aux nuances charmantes, tartanes, balancelles, mahonnes, peints, voilés et mâtés avec une fantaisie imprévue, porteurs de madones bleues et dorées, de saints debout sur la proue et d’animaux bizarres, qui sont aussi des protecteurs sacrés.
Toute cette flotte à bonnes vierges et à talismans est alignée le long des quais, tournant vers le centre des bassins ses nez inégaux et pointus. Puis apparaissent, classés par compagnies, de puissants vapeurs en fer, étroits et hauts, avec des formes colossales et fines. Il y a encore au milieu de ces pèlerins de la mer des navires tout blancs, de grands trois-mâts ou des bricks, vêtus comme les Arabes d’une robe éclatante sur qui glisse le soleil.
Si rien n’est plus joli que l’entrée de ce port, rien n’est plus sale que l’entrée de cette ville. Le boulevard du quai est un marais d’ordures, et les rues étroites, originales, enfermées comme des corridors entre deux lignes tortueuses de maisons démesurément hautes, soulèvent incessamment le cœur par leurs pestilentielles émanations. On éprouve à Gênes ce qu’on éprouve à Florence et encore plus à Venise, l’impression d’une très aristocratique cité tombée au pouvoir d’une populace.
Ici surgit la pensée des rudes seigneurs qui se battaient ou trafiquaient sur la mer, puis, avec l’argent de leurs conquêtes, de leurs captures ou de leur commerce, se faisaient construire les étonnants palais de marbre dont les rues principales sont encore bordées.
Quand on pénètre dans ces demeures magnifiques, odieusement peinturlurées par les descendants de ces grands citoyens de la plus fière des républiques, et qu’on compare le style, les cours, les jardins, les portiques, les galeries intérieures, toute la décorative et superbe ordonnance, avec l’opulente barbarie des plus beaux hôtels du Paris moderne, avec ces palais de millionnaires qui ne savent toucher qu’à l’argent, qui sont impuissants à concevoir, à désirer une belle chose nouvelle et à la faire naître avec leur or, on comprend alors que la vraie distinction de l’intelligence, que le sens de la beauté rare des moindres formes, de la perfection des proportions et des lignes, ont disparu de notre société démocratisée, mélange de riches financiers sans goût et de parvenus sans traditions.
C’est même une observation curieuse à faire, celle de la banalité de l’hôtel moderne. Entrez dans les vieux palais de Gênes, vous y verrez une succession de cours d’honneur à galeries et à colonnades et d’escaliers de marbre incroyablement beaux, tous différemment dessinés et conçus par de vrais artistes, pour des hommes au regard instruit et difficile.
Entrez dans les anciens châteaux de France, vous y trouverez les mêmes efforts vers l’incessante rénovation du style et de l’ornement.
Entrez ensuite dans les plus riches demeures du Paris actuel, vous y admirerez de curieux objets anciens soigneusement catalogués, étiquetés, exposés sous verre suivant leur valeur connue, cotée, affirmée par des experts, mais pas une fois vous ne resterez surpris par l’originale et neuve invention des différentes parties de la demeure elle-même.
L’architecte est chargé de construire une belle maison de plusieurs millions, et touche cinq ou dix pour cent sur les dépenses, selon la quantité de travail artiste qu’il doit introduire dans son plan.
Le tapissier, à des conditions différentes, est chargé de la décorer. Comme ces industriels n’ignorent pas l’incompétence native de leurs clients et ne se hasarderaient point à leur proposer de l’inconnu, ils se contentent de recommencer à peu près ce qu’ils ont déjà fait pour d’autres.
Quand on a visité dans Gênes ces antiques et nobles demeures, admiré quelques tableaux et surtout trois merveilles de ce chef-d’oeuvrier qu’on nomme Van Dyck, il ne reste plus à voir que le Campo-Santo, cimetière moderne, musée de sculpture funèbre le plus bizarre, le plus surprenant, le plus macabre et le plus comique peut-être qui soit au monde. Tout le long d’un immense quadrilatère de galerie, cloître géant ouvert sur un préau que les tombes des pauvres couvrent d’une neige de plaques blanches, on défile devant une procession de bourgeois de marbre qui pleurent leurs morts.
Читать дальше