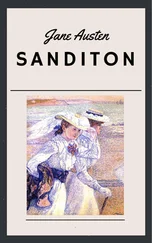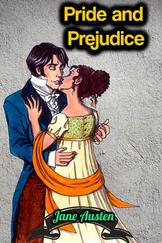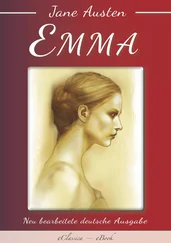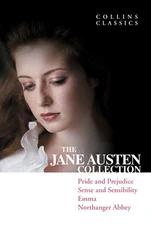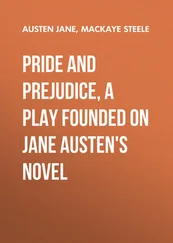– Comme vous me faites plaisir! Maintenant je n’aurai plus honte d’aimer Udolphe . Mais, je vous assure, je croyais que les jeunes gens méprisaient fort les romans.
– Ce mépris des jeunes gens pour les romans est peut-être excessif: ils en lisent autant que les femmes. Pour ma part, j’en ai lu des centaines et des centaines. Ne vous imaginez pas pouvoir rivaliser avec moi dans la connaissance des Julias et des Louisas. Si, passant aux détails, nous nous engageons dans l’enquête interminable des «Avez-vous lu ceci?» et «Avez-vous lu cela?» bientôt je vous laisserai aussi loin derrière moi que… – je cherche une comparaison topique -… aussi loin que votre amie Émilie elle-même laissa le pauvre Valencourt quand elle accompagna sa tante en Italie. Considérez que j’ai sur vous maintes années d’avance. Je faisais mes études à Oxford, que vous étiez une bonne petite fille qui peinait sur son marquoir.
– Pas très bonne, je crains. Mais, dites-moi, vraiment, ne trouvez-vous pas Udolphe le livre le plus joli qui soit?
– Le plus joli? par quoi vous entendez, je suppose, le plus joliment relié.
– Henry, dit M lleTilney, vous êtes très impertinent. Miss Morland, il vous traite absolument comme il traite sa sœur. Toujours il me cherche noise pour quelque incorrection de langage, et voilà qu’il prend avec vous la même liberté. Le mot «joli», employé comme vous avez fait, ne le satisfait pas. Il vaut mieux que vous en choisissiez un autre tout de suite, sinon nous serons écrasées de Johnson et Blair tout le long du chemin.
– Je ne croyais pas dire quelque chose d’inexact. C’est un joli livre. Et pourquoi n’emploierais-je pas ce mot?
– Très bien, dit Henry, et la journée est très jolie, et nous faisons une très jolie promenade, et vous êtes deux très jolies filles. Oh! c’est un joli mot, vraiment. Il convient à toutes choses. Aujourd’hui n’importe quel éloge sur n’importe quel sujet est compris dans ce mot.
– Venez, miss Morland; qu’il médite sur nos fautes, du haut de son érudition, pendant que nous louerons Udolphe dans les termes qu’il nous plaira. C’est un livre des plus intéressants. Vous aimez beaucoup ce genre de lecture?
– À dire vrai, je n’en aime guère d’autres.
– Vraiment?
– J’aime aussi les vers; les pièces de théâtre et les voyages me plaisent assez. Mais l’histoire, la solennelle histoire réelle ne m’intéresse pas. Et vous?
– J’adore l’histoire.
– Comme je vous envie! J’en ai lu un peu, par devoir; mais je n’y vois rien qui ne m’irrite ou ne m’ennuie: des querelles de papes et de rois, des guerres ou des pestes à chaque page, des hommes qui ne valent pas grand’chose, et presque pas de femmes, – c’est très fastidieux; et parfois je me dis qu’il est surprenant que ce soit si ennuyeux, car une grande partie de tout cela doit être imaginé de toutes pièces. Les paroles mises dans la bouche des héros, leurs pensées, leurs projets, oui, tout cela doit être de pure invention, et ce qui me plaît le plus dans les autres livres, c’est précisément l’invention.
– Vous trouvez, dit M lleTilney, que les historiens ne sont pas toujours heureux dans leurs élans de fantaisie et qu’ils déploient de l’imagination sans exciter l’intérêt. Moi, j’adore l’histoire et accepte le faux avec le vrai. Pour les faits essentiels, les sources de renseignements sont les ouvrages antérieurs et les archives. N’est-ce donc rien? On croit à tant d’autres choses que l’on n’a pas vues soi-même! Quant aux embellissements dont vous parlez, je les aime comme tels. Si une harangue est bien tournée, je la lis avec plaisir – que m’importe son auteur? – et sans doute avec un plaisir bien plus vif, œuvre de M. Hume ou du docteur Robertson, que si elle eût reproduit les paroles mêmes de Caractacus, d’Agricola ou d’Alfred le Grand.
– Vous aimez l’histoire. M. Allen et mon père l’aiment aussi. J’ai deux frères à qui elle ne déplaît pas. Voilà, si j’y songe, bien des répondants dans mon cercle restreint. Si les historiens trouvent des lecteurs, tout est bien. Mais je croyais qu’ils s’obstinaient à emplir de grands volumes, sans autre résultat que de tourmenter les petits garçons et les petites filles.
– Qu’ils torturent les petites filles et les petits garçons, on ne le peut nier; mais – traitons-les moins légèrement – ils sont parfaitement aptes à torturer des lecteurs dont la raison soit entièrement développée. Je dis «torturer» d’accord avec vous, au lieu d’«instruire», supposant que ces deux mots sont devenus synonymes.
– Vous me trouvez sotte d’appeler l’étude un tourment. Mais si vous aviez vu des enfants – comme j’ai toujours vu mes petits frères et mes petites sœurs – peiner des jours et des jours à apprendre leurs lettres, au point d’en être stupides, vous conviendriez que «tourmenter» et «instruire» peuvent quelquefois être synonymes.
– Soit. Mais les historiens ne sont pas responsables de la difficulté qu’il y a à apprendre à lire, et vous-même conviendrez qu’on peut bien se laisser torturer deux ou trois ans pour être capable de lire tout le reste de son existence. Songez que si on n’enseignait pas à lire, M meRadcliffe aurait écrit en vain, ou n’aurait pas écrit du tout.
Catherine approuva, et fit un chaud panégyrique de cette actrice. Les Tilney s’engagèrent alors dans une autre conversation. En personnes habituées à dessiner, ils discutèrent la façon de découper en tableaux le paysage qui se développait autour de Beechen Cliff. L’art du dessin était mystérieux à Catherine. Elle écoutait avec une attention stérile, car les termes dont ils usaient n’éveillaient en elle aucune notion. De quoi elle avait grande honte: elle ignorait que, chez une fille avenante et bonne, il est des qualités primesautières qui ont plus de séduction qu’un savoir bien en vedette. Elle confessa son ignorance. Une leçon sur le pittoresque suivit immédiatement. Les explications de M. Tilney étaient si claires que tout ce qu’il admirait se revêtit de beauté pour Catherine, et il se plaisait à voir, dans l’attention passionnée de la jeune fille, une marque de goût naturel. Il parla d’avant-plans, de distances, d’arrière-plans, de perspective, de lumière, d’ombre, tant, que lorsqu’on fut au sommet de Beechen Cliff, Catherine, de sa propre initiative, rejeta toute la ville de Bath, comme indigne de faire partie d’un paysage. Charmé de ses progrès et craignant que trop de science en une fois la fatiguât. Henry parla d’une façon générale des forêts, des terres en friche, des domaines de la Couronne, arrivant ainsi, par de rapides et habiles transitions, au gouvernement et à la politique, et de la politique, naturellement, au silence.
Le silence fut rompu par Catherine qui, d’une voix un peu solennelle, prononça:
– J’ai appris que quelque chose d’horrible allait paraître à Londres.
M lleTilney, à qui ces paroles étaient spécialement adressées, tressaillit et dit avec vivacité:
– Vraiment! et de quelle sorte?
– Cela, je ne le sais pas, ni qui en sera l’auteur. J’ai seulement entendu dire que ce serait plus horrible que tout ce qu’on a jamais vu.
– Ciel! où avez-vous pu apprendre ces choses?
– Une de mes amies intimes a reçu hier de Londres une lettre qui en parlait. Ce sera épouvantable d’une façon peu commune. Je m’attends à un crime ou à quelque chose de ce genre.
– Vous parlez avec un calme étonnant. Mais je veux croire que l’on a exagéré. Si de pareils desseins sont connus à l’avance, des mesures seront prises par le gouvernement pour en prévenir l’exécution.
Читать дальше