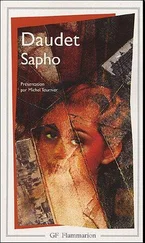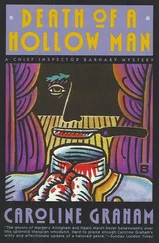«Tu l’as vu, Achmed, tu l’as vu… tu étais là. Le chrétien m’a frappé… Tu seras témoin… bien… bien… tu seras témoin.»
L’Arabe dégage son burnous et repousse le juif.. Il ne sait rien, il n’a rien vu: juste au moment, il tournait la tête…
«Mais toi, Kaddour, tu l’as vu… tu as vu le chrétien me battre…», crie le malheureux Iscariote à un gros Nègre en train d’éplucher une figure de Barbarie.
Le Nègre crache en signe de mépris et s’éloigne; il n’a rien vu… Il n’a rien vu non plus, ce petit Maltais dont les yeux de charbon luisent méchamment derrière sa barrette; elle n’a rien vu, cette Mahonaise au teint de brique qui se sauve en riant, son panier de grenades sur la tête…
Le juif a beau crier, prier, se démener… pas de témoin! personne n’a rien vu… Par bonheur deux de ses coreligionnaires passent dans la rue à ce moment, l’oreille basse, rasant les murailles. Le juif les avise:
«Vite, vite, mes frères! Vite à l’homme d’affaires! Vite au zouge de paix!… Vous l’avez vu, vous autres… vous avez vu qu’on a battu le vieux!»
S’ils l’ont vu!… Je crois bien.
… Grand émoi dans la boutique de Sid’Omar… Le cafetier remplit les tasses, rallume les pipes. On cause, on rit à belles dents. Au milieu du brouhaha et de la fumée, je gagne la porte doucement; j’ai envie d’aller rôder un peu du côté d’Israël pour savoir comment les coreligionnaires d’Iscariote ont pris l’affront fait à leur frère…
«Viens dîner ce soir, moussiou », me crie le bon Sid’Omar…
J’accepte, je remercie. Me voilà dehors.
Au quartier juif, tout le monde est sur pied. L’affaire fait déjà grand bruit. Personne aux échoppes. Brodeurs, tailleurs, bourreliers – tout Israël est dans la rue… Les hommes – en casquette de velours, en bas de laine bleue – gesticulent bruyamment, par groupes… Les femmes, pâles, bouffies, raides comme des idoles de bois dans leurs robes plates à plastron d’or, le visage entouré de bandelettes noires, vont d’un groupe à l’autre en miaulant… Au moment où j’arrive, un grand mouvement se fait dans la foule. On s’empresse, on se précipite… Appuyé sur des témoins, le juif – héros de l’aventure passe entre deux haies de casquettes sous une pluie d’exhortations:
«Venge-toi, frère; venge-nous, venge le peuple juif. Ne crains rien; tu as la loi pour toi.»
Un affreux nain, puant la poix et le vieux cuir, s’approche de moi d’un air piteux, avec de gros soupirs:
«Tu vois, me dit-il. Les pauvres juifs, comme on nous traite! C’est un vieillard! regarde. Ils l’ont presque tué.»
De vrai, le pauvre Iscariote a l’air plus mort que vif. Il passe devant moi – l’œil éteint, le visage défait; ne marchant pas, se traînant… Une forte indemnité est seule capable de le guérir; aussi ne le mène-t-on pas chez le médecin, mais chez l’agent d’affaires.
Il y a beaucoup d’agents d’affaires en Algérie, presque autant que de sauterelles. Le métier est bon, paraît-il.
Dans tous les cas, il a cet avantage qu’on y peut entrer de plain-pied, sans examens, ni cautionnement, ni stage. Comme à Paris nous nous faisons hommes de lettres, on se fait agent d’affaires en Algérie. Il suffit pour cela de savoir un peu de français, d’espagnol, d’arabe, d’avoir toujours un code dans ses fontes, et sur toute chose le tempérament du métier.
Les fonctions de l’agent sont très variées: tour à tour avocat, avoué, courtier, expert, interprète, teneur de livres, commissionnaire, écrivain public, c’est le maître Jacques de la colonie. Seulement Harpagon n’en avait qu’un de maître Jacques, et la colonie en a plus qu’il ne lui en faut. Rien qu’à Milianah, on les compte par douzaines. En général, pour éviter les frais de bureau, ces messieurs reçoivent leurs clients au café de la grand-place et donnent leurs consultations – les donnent-ils? – entre l’absinthe et le champoreau.
C’est vers le grand café de la place que le digne Iscariote s’achemine, flanqué de ses deux témoins. Ne les suivons pas.
En sortant du quartier juif, je passe devant la maison du bureau arabe. Du dehors, avec son chapeau d’ardoises et le drapeau français qui flotte dessus, on la prendrait pour une mairie de village. Je connais l’interprète, entrons fumer une cigarette avec lui. De cigarette en cigarette, je finirai bien par le tuer, ce dimanche sans soleil!
La cour qui précède le bureau est encombrée d’Arabes en guenilles. Ils sont là une cinquantaine à faire antichambre, accroupis, le long du mur, dans leur burnous. Cette antichambre bédouine exhale – quoique en plein air – une forte odeur de cuir humain. Passons vite… Dans le bureau, je trouve l’interprète aux prises avec deux grands braillards entièrement nus sous de longues couvertures crasseuses, et racontant d’une mimique enragée je ne sais quelle histoire de chapelet volé. Je m’assieds sur une natte dans un coin, et je regarde… Un joli costume, ce costume d’interprète; et comme l’interprète de Milianah le porte bien! Ils ont l’air taillés l’un pour l’autre. Le costume est bleu de ciel avec des brandebourgs noirs et des boutons d’or qui reluisent. L’interprète est blond, rose, tout frisé; un joli hussard bien plein d’humour et de fantaisie; un peu bavard – il parle tant de langues! un peu sceptique – il a connu Renan à l’école orientaliste! grand amateur de sport, à l’aise au bivouac arabe comme aux soirées de la sous-préfète, mazurkant mieux que personne, et faisant le couscous comme pas un. Parisien, pour tout dire; voilà mon homme, et ne vous étonnez pas que les dames en raffolent. Comme dandysme, il n’a qu’un rival: le sergent du bureau arabe. Celui-ci – avec sa tunique de drap fin et ses guêtres à boutons de nacre – fait le désespoir et l’envie de toute la garnison. Détaché au bureau arabe, il est dispensé des corvées, et toujours se montre par les rues, ganté de blanc, frisé de frais, avec de grands registres sous le bras. On l’admire et on le redoute. C’est une autorité.
Décidément, cette histoire de chapelet volé menace d’être fort longue. Bonsoir! je n’attends pas la fin.
En m’en allant je trouve l’antichambre en émoi. La foule se presse autour d’un indigène de haute taille, pâle, fier, drapé dans un burnous noir. Cet homme, il y a huit jours, s’est battu dans le Zaccar avec une panthère. La panthère est morte; mais l’homme a eu la moitié du bras mangée. Soir et matin, il vient se faire panser au bureau arabe, et chaque fois on l’arrête dans la cour pour lui entendre raconter son histoire. Il parle lentement, d’une belle voix gutturale. De temps en temps, il écarte son burnous et montre, attaché contre sa poitrine, son bras gauche entouré de linges sanglants.
A peine suis-je dans la rue, voilà un violent orage qui éclate. Pluie, tonnerre, éclairs, sirocco… Vite, abritons-nous. J’enfile une porte au hasard, et je tombe au milieu d’une nichée de bohémiens, empilés sous les arceaux d’une cour moresque. Cette cour tient à la mosquée de Milianah; c’est le refuge habituel de la pouillerie musulmane, on l’appelle la cour des pauvres.
De grands lévriers maigres, tout couverts de vermine, viennent rôder autour de moi d’un air méchant. Adossé contre un des piliers de la galerie, je tâche de faire bonne contenance, et, sans parler à personne, je regarde la pluie qui ricoche sur les dalles coloriées de la cour. Les bohémiens sont à terre, couchés par tas. Près de moi, une jeune femme, presque belle, la gorge et les jambes découvertes, de gros bracelets de fer aux poignets et aux chevilles, chante un air bizarre à trois notes mélancoliques et nasillardes. En chantant, elle allaite un petit enfant tout nu en bronze rouge, et, du bras resté libre, elle pile de l’orge dans un mortier de pierre. La pluie, chassée par un vent cruel, inonde parfois les jambes de la nourrice et le corps de son nourrisson. La bohémienne n’y prend point garde et continue à chanter sous la rafale, en pilant l’orge et donnant le sein.
Читать дальше