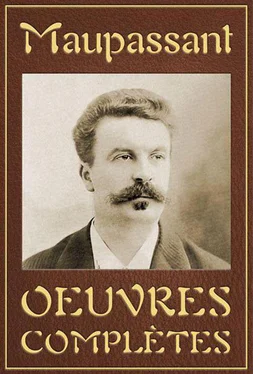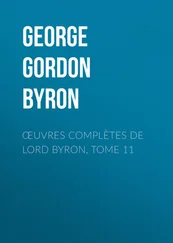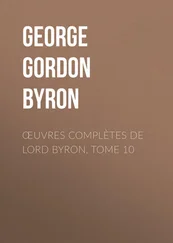Elle vit bien cette réprobation, et s’indigna en son âme de toutes ces pactisations, de ces arrangements de conscience, de cette universelle peur de tout, de la grande lâcheté gîtée au fond de tous les cœurs, et parée, quand elle se montre, de tant de masques respectables.
Le baron prit la direction des études de Paul, et le mit au latin. La mère n’avait plus qu’une recommandation : « Surtout ne le fatigue pas », et elle rôdait, inquiète, près de la chambre aux leçons, petit père lui en ayant interdit l’entrée parce qu’elle interrompait à tout instant l’enseignement pour demander : « Tu n’as pas froid aux pieds, Poulet ? » Ou bien : « Tu n’as pas mal à la tête, Poulet ? » Ou bien pour arrêter le maître : « Ne le fais pas tant parler, tu vas lui fatiguer la gorge. »
Dès que le petit était libre, il descendait jardiner avec mère et tante. Ils avaient maintenant un grand amour pour la culture de la terre ; et tous trois plantaient des jeunes arbres au printemps, semaient des graines dont l’éclosion et la poussée les passionnaient, taillaient des branches, coupaient des fleurs pour faire des bouquets.
Le plus grand souci du jeune homme était la production des salades. Il dirigeait quatre grands carrés du potager où il élevait avec un soin extrême, Laitues, Romaines, Chicorées, Barbes-de-capucin, Royales, toutes les espèces connues de ces feuilles comestibles. Il bêchait, arrosait, sarclait, repiquait, aidé de ses deux mères qu’il faisait travailler comme des femmes de journée. On les voyait, pendant des heures entières, à genoux dans les plates-bandes, maculant leurs robes et leurs mains occupées à introduire la racine des jeunes plantes en des trous qu’elles creusaient d’un seul doigt piqué d’aplomb dans la terre.
Poulet devenait grand, il atteignait quinze ans ; et l’échelle du salon marquait un mètre cinquante-huit. Mais il restait enfant d’esprit, ignorant, niais, étouffé par ces deux jupes et ce vieil homme aimable qui n’était plus du siècle.
Un soir, enfin, le baron parla du collège ; et Jeanne aussitôt se mit à sangloter. Tante Lison, effarée, se tenait dans un coin sombre.
La mère répondait : « Qu’a-t-il besoin de tant savoir. Nous en ferons un homme des champs, un gentilhomme campagnard. Il cultivera des terres comme font beaucoup de nobles. Il vivra et vieillira heureux dans cette maison où nous aurons vécu avant lui, où nous mourrons. Que peut-on demander de plus ? »
Mais le baron hochait la tête. « Que répondras-tu s’il vient te dire, lorsqu’il aura vingt-cinq ans : Je ne suis rien, je ne sais rien par ta faute, par la faute de ton égoïsme maternel. Je me sens incapable de travailler, de devenir quelqu’un, et pourtant je n’étais pas fait pour la vie obscure, humble, et triste à mourir, à laquelle ta tendresse imprévoyante m’a condamné. »
Elle pleurait toujours, implorant son fils. « Dis, Poulet, tu ne me reprocheras jamais de t’avoir trop aimé, n’est-ce pas ? »
Et le grand enfant, surpris, promettait : « Non, maman.
— Tu me le jures ?
— Oui, maman.
— Tu veux rester ici, n’est-ce pas ?
— Oui, maman. »
Alors le baron parla ferme et haut : « Jeanne, tu n’as pas le droit de disposer de cette vie. Ce que tu fais là est lâche et presque criminel ; tu sacrifies ton enfant à ton bonheur particulier. »
Elle cacha sa figure dans ses mains, poussant des sanglots précipités, et elle balbutiait dans ses larmes : « J’ai été si malheureuse… si malheureuse ! Maintenant que je suis tranquille avec lui, on me l’enlève… Qu’est-ce que je deviendrai… toute seule… à présent ?… »
Son père se leva, vint s’asseoir auprès d’elle, la prit dans ses bras. « Et moi, Jeanne ? » Elle le saisit brusquement par le cou, l’embrassa avec violence, puis, toute suffoquée encore, elle articula au milieu d’étranglements : « Oui. Tu as raison… peut-être… petit père. J’étais folle, mais j’ai tant souffert. Je veux bien qu’il aille au collège. »
Et, sans trop comprendre ce qu’on allait faire de lui, Poulet, à son tour, se mit à larmoyer.
Alors ses trois mères, l’embrassant, le câlinant, l’encouragèrent. Et lorsqu’on monta se coucher, tous avaient le cœur serré et tous pleurèrent dans leurs lits, même le baron qui s’était contenu.
Il fut décidé qu’à la rentrée on mettrait le jeune homme au collège du Havre ; et il eut, pendant tout l’été, plus de gâteries que jamais.
Sa mère gémissait souvent à la pensée de la séparation. Elle prépara son trousseau comme s’il allait entreprendre un voyage de dix ans ; puis, un matin d’octobre, après une nuit sans sommeil, les deux femmes et le baron montèrent avec lui dans la calèche qui partit au trot des deux chevaux.
On avait déjà choisi, dans un autre voyage, sa place au dortoir et sa place en classe. Jeanne, aidée de tante Lison, passa tout le jour à ranger les hardes dans la petite commode. Comme le meuble ne contenait pas le quart de ce qu’on avait apporté, elle alla trouver le proviseur pour en obtenir un second. L’économe fut appelé ; il représenta que tant de linges et d’effets ne feraient que gêner sans servir jamais ; et il refusa, au nom du règlement, de céder une autre commode. La mère, désolée, se résolut alors à louer une chambre dans un petit hôtel voisin, en recommandant à l’hôtelier d’aller lui-même porter à Poulet tout ce dont il aurait besoin, au premier appel de l’enfant.
Puis on fit un tour sur la jetée pour regarder sortir et entrer les navires.
Le triste soir tomba sur la ville qui s’illuminait peu à peu. On entra pour dîner dans un restaurant. Aucun d’eux n’avait faim ; et ils se regardaient d’un œil humide pendant que les plats défilaient devant eux et s’en retournaient presque pleins.
Puis on se mit en marche lentement vers le collège. Des enfants de toutes les tailles arrivaient de tous les côtés, conduits par leurs familles ou par des domestiques. Beaucoup pleuraient. On entendait un bruit de larmes dans la grande cour à peine éclairée.
Jeanne et Poulet s’étreignirent longtemps. Tante Lison restait derrière, oubliée tout à fait et la figure dans son mouchoir. Mais le baron, qui s’attendrissait, abrégea les adieux en entraînant sa fille. La calèche attendait devant la porte ; ils montèrent dedans tous trois et s’en retournèrent dans la nuit vers les Peuples.
Parfois un gros sanglot passait dans l’ombre.
Le lendemain Jeanne pleura jusqu’au soir. Le jour suivant elle fit atteler le phaéton et partit pour Le Havre. Poulet semblait avoir déjà pris son parti de la séparation. Pour la première fois de sa vie il avait des camarades ; et le désir de jouer le faisait frémir sur sa chaise au parloir.
Jeanne revint ainsi tous les deux jours, et le dimanche pour les sorties. Ne sachant que faire pendant les classes, entre les récréations, elle demeurait assise au parloir, n’ayant ni la force ni le courage de s’éloigner du collège. Le proviseur la fit prier de monter chez lui, et il lui demanda de venir moins souvent. Elle ne tint pas compte de cette recommandation.
Il la prévint alors que, si elle continuait à empêcher son fils de jouer pendant les heures d’ébats, et de travailler en le troublant sans cesse, on se verrait forcé de le lui rendre ; et le baron fut prévenu par un mot. Elle demeura donc gardée à vue aux Peuples, comme une prisonnière.
Elle attendait chaque vacance avec plus d’anxiété que son enfant.
Et une inquiétude incessante agitait son âme. Elle se mit à rôder par le pays, se promenant seule avec le chien Massacre pendant des jours entiers, en rêvassant dans le vide. Parfois, elle restait assise durant tout un après-midi à regarder la mer du haut de la falaise ; parfois, elle descendait jusqu’à Yport à travers le bois, refaisant des promenades anciennes dont le souvenir la poursuivait. Comme c’était loin, comme c’était loin le temps où elle parcourait ce même pays, jeune fille, et grise de rêves.
Читать дальше