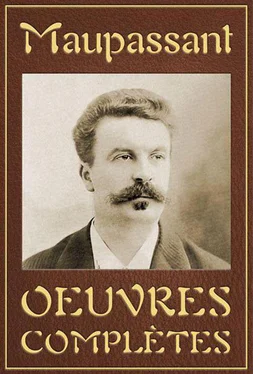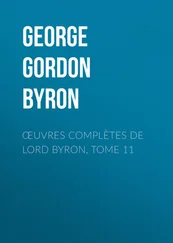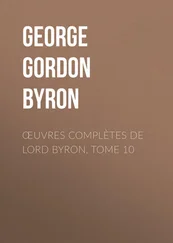À quinze ans, ces misérables, qui seraient jolies, sont déformées, épuisées par les dures besognes. Elles peinent du matin au soir à toutes les fatigues, vont chercher l’eau à plusieurs kilomètres avec un enfant sur le dos. Elles semblent vieilles à vingt-cinq ans.
Leur visage, qu’on aperçoit parfois, est tatoué d’étoiles bleues sur le front, les joues et le menton. Le corps est épilé, par mesure de propreté. Il est fort rare d’apercevoir les femmes des Arabes riches.
On repartit aussitôt la collation achevée, et, le soir, nous arrivâmes au rocher de sel Khang-el-Melah.
C’est une sorte de montagne grise, verte, bleue, aux reflets métalliques, aux coupes singulières ; une montagne de sel ! Des eaux plus salées que l’Océan s’échappent de son pied et, volatilisées par la chaleur folle du soleil, laissent sur le sol une écume blanche, pareille à la bave des flots, une mousse de sel ! On ne voit plus la terre, cachée sous une poudre légère, comme si quelque colosse se fût amusé à râper ce mont pour en semer la poussière alentour ; et de gros blocs détachés gisent dans les enfoncements, des blocs de sel !
Sous ce rocher extraordinaire se creusent, paraît-il, des puits fort profonds qu’habitent des milliers de colombes.
Le lendemain nous étions à Djelfa.
Djelfa est une vilaine petite ville à la française, mais habitée par des officiers fort aimables qui en rendent charmant le séjour.
Après un court repos, nous nous sommes remis en route.
Nous avons recommencé notre long voyage par les longues plaines nues. De temps en temps on rencontrait des troupeaux. Tantôt c’étaient des armées de moutons de la couleur du sable ; tantôt à l’horizon se dessinaient des bêtes singulières que la distance faisait petites et qu’on eût prises, avec leur dos en bosse, leur grand cou recourbé, leur allure lente, pour des bandes de hauts dindons. Puis, en approchant, on reconnaissait des chameaux avec leur ventre gonflé des deux côtés comme un double ballon, comme une outre démesurée, leur ventre qui contient jusqu’à soixante litres d’eau. Eux aussi avaient la couleur du désert comme tous les êtres nés dans ces solitudes jaunes. Le lion, l’hyène, le chacal, le crapaud, le lézard, le scorpion, l’homme lui-même prennent là toutes les nuances du sol calciné, depuis le roux brûlant des dunes mouvantes jusqu’au gris pierreux des montagnes. Et la petite alouette des plaines est si pareille à la poussière de terre qu’on la voit seulement quand elle s’envole.
De quoi vivent donc les bêtes dans ces contrées arides, car elles vivent ?
Pendant la saison des pluies, ces plaines se couvrent d’herbes en quelques semaines, puis le soleil, en quelques jours, dessèche et brûle cette rapide végétation. Alors ces plantes prennent elles-mêmes la couleur du sol ; elles se cassent, s’émiettent, se répandent sur la terre comme une paille hachée menu et qu’on ne distingue même plus. Mais les troupeaux savent la trouver et s’en nourrissent. Ils vont devant eux, cherchant cette poudre d’herbes sèches. On dirait qu’ils mangent des pierres.
Que penserait un fermier normand en face de ces singuliers pâturages ?
Puis nous avons traversé une région où on ne rencontrait même plus guère d’oiseaux. Les puits devenaient introuvables.
Nous regardions passer au loin de singulières petites colonnes de poussière qui ont l’air d’une fumée, tantôt droites, tantôt penchées ou tordues et qui courent rapidement sur le sol, hautes de quelques mètres, larges au sommet et minces du pied.
Les remous de l’air, formant ventouse, soulèvent et entraînent ces nuées transparentes et vraiment fantastiques, qui seules mettent un mouvement en ces lieux lamentablement déserts.
Cinq cents mètres en avant de notre petite troupe, un cavalier servant de guide nous dirigeait à travers la morne et toute droite solitude. Pendant dix minutes, il allait au pas, immobile sur la selle, et chantant, en sa langue, une chanson traînante, avec ces rythmes étranges de là-bas. Nous imitions son allure. Puis soudain il partait au trot, à peine secoué, son grand burnous voltigeant, le corps d’aplomb, debout sur les étriers. Et nous partions derrière lui, jusqu’au moment où il s’arrêtait pour reprendre un train plus doux.
Je demandai à mon voisin :
— Comment peut-il nous conduire à travers ces espaces nus, sans points de repère ?
Il me répondit :
— Quand il n’y aurait que les os des chameaux.
En effet, de quart d’heure en quart d’heure, nous rencontrions quelque ossement énorme, rongé par les bêtes, cuit par le soleil, tout blanc, tachant le sable. C’était parfois un morceau de jambe, parfois un morceau de mâchoire, parfois un bout de colonne vertébrale.
— D’où viennent tous ces débris ? demandai-je.
Mon voisin répliqua :
— Les convois laissent en route chaque animal qui ne peut plus suivre ; et les chacals n’emportent pas tout.
Et pendant plusieurs journées nous avons continué ce voyage monotone, derrière le même Arabe, dans le même ordre, toujours à cheval, presque sans parler.
Or, un après-midi, comme nous devions, au soir, atteindre Bou-Saada, j’aperçus, très loin devant nous, une masse brune, grossie d’ailleurs par le mirage, et dont la forme m’étonna. À notre approche, deux vautours s’envolèrent. C’était une charogne encore baveuse malgré la chaleur, vernie par le sang pourri. La poitrine seule restait, les membres ayant été sans doute emportés par les voraces mangeurs de morts.
— Nous avons des voyageurs devant nous, dit le lieutenant.
Quelques heures après, on entrait dans une sorte de ravin, de défilé, fournaise effroyable, aux rochers dentelés comme des scies, pointus, rageurs, révoltés, semblait-il, contre ce ciel impitoyablement féroce. Un autre corps gisait là. Un chacal s’enfuit qui le dévorait.
Puis, au moment où l’on débouchait de nouveau dans une plaine, une masse grise, étendue devant nous, remua, et lentement, au bout d’un cou démesuré, je vis se dresser la tête d’un chameau agonisant. Il était là, sur le flanc, depuis deux ou trois jours peut-être, mourant de fatigue et de soif. Ses longs membres qu’on aurait dit brisés, inertes, mêlés, gisaient sur le sol de feu. Et lui, nous entendant venir, avait levé sa tête, comme un phare. Son front, rongé par l’inexorable soleil, n’était qu’une plaie, coulait ; et son œil résigné nous suivit. Il ne poussa pas un gémissement, ne fit pas un effort pour se lever. On eût cru qu’il savait, qu’ayant vu mourir ainsi beaucoup de ses frères dans ses longs voyages à travers les solitudes, il connaissait bien l’inclémence des hommes. C’était son tour, voilà tout. Nous passâmes.
Or, m’étant retourné longtemps après, j’aperçus encore, dressé sur le sable, le grand col de la bête abandonnée regardant jusqu’à la fin s’enfoncer à l’horizon les derniers vivants qu’elle dût voir.
Une heure plus tard, ce fut un chien tapi contre un roc, la gueule ouverte, les crocs luisants, incapable de remuer une patte, l’œil tendu sur deux vautours qui, près de lui, épluchaient leurs plumes en attendant sa mort. Il était tellement obsédé par la terreur des bêtes patientes, avides de sa chair, qu’il ne tourna pas la tête, qu’il ne sentit pas les pierres qu’un spahi lui lançait en passant.
Et soudain, à la sortie d’un nouveau défilé, j’aperçus devant moi l’oasis.
C’est une inoubliable apparition. On vient de traverser d’interminables plaines, de franchir des montagnes aiguës, pelées, calcinées, sans rencontrer un arbre, une plante, une feuille verte, et voici, devant vous, à vos pieds, une masse opaque de verdure sombre, quelque chose comme un lac de feuillage presque noir étendu sur le sable. Puis, derrière cette grande tache, le désert recommence, s’allongeant à l’infini, jusqu’à l’insaisissable horizon, où il se mêle au ciel.
Читать дальше