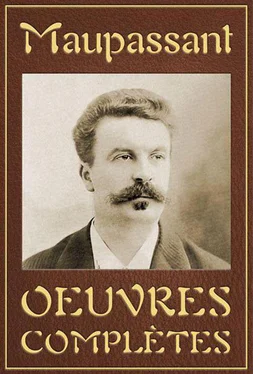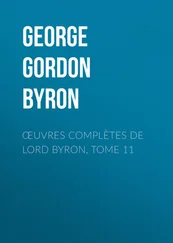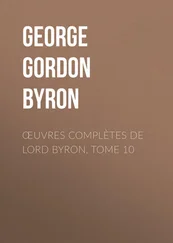Nous arrivions le lendemain chez le caïd Abd-el-Kader-bel-Hout, un parvenu. Sa tribu qu’il administre avec sagesse est moins turbulente et moins plaideuse que les autres. Peut-être faut-il chercher une autre cause à ce calme relatif.
Le pays n’ayant de sources que sur le versant sud du Djebel-Gada, qui n’est point habité, l’eau naturellement n’est fournie que par les puits communs à toute la tribu. Il ne peut donc se produire de détournements de cours , ce qui est la principale cause de querelles et de haines dans tout le Sud.
Ici encore un homme se présenta en sollicitant son admission à l’hôpital français. Quand on lui demanda quelle maladie il avait, il releva sa gandoura et montra ses jambes. Elles étaient marbrées de taches bleues, flasques, molles, blettes comme un fruit trop mûr, avec des chairs tellement ramollies que le doigt y pénétrait comme dans une pâte qui gardait longtemps le trou creusé par cette pression. Ce pauvre diable présentait enfin tous les signes d’une syphilis épouvantable. Comme on lui demandait en quelle occasion cette infirmité lui était venue, il leva la main, et jura par la mémoire de ses ancêtres que « c’était l’œuvre de Dieu ».
En vérité le Dieu des Arabes accomplit des œuvres bien singulières.
Lorsque toutes les réclamations ont été entendues, on essaie de dormir un peu sous la chaleur terrible de la tente.
Puis le soir vient ; on dîne. Un calme profond tombe sur la terre calcinée. Les chiens des douars commencent à hurler au loin, et les chacals leur répondent.
On s’étend sur les tapis sous le ciel criblé d’étoiles, qui semblent humides, tant leur clarté scintille ; et alors on cause longtemps, très longtemps. Tous les souvenirs reviennent, doux, précis et faciles à dire, sous ces nuits tièdes si pleines d’astres. Tout autour de la tente de l’officier, des Arabes sont étendus par terre ; et, sur une ligne, les chevaux, entravés par les jambes de devant, restent debout, avec un homme de garde auprès de chacun d’eux.
Ils ne doivent pas se coucher ; et ils restent toujours debout, ces chevaux ; car la monture d’un chef ne peut pas être fatiguée. Sitôt qu’ils essaient de s’étendre, un Arabe se précipite et les force à se relever.
Mais la nuit s’avance. Nous nous allongeons sur les tapis de laine épaisse, et parfois, dans les réveils subits, nous apercevons partout, sur la terre nue qui nous environne, des êtres blancs étendus et dormant, comme des cadavres dans des linceuls.
Un jour, après une marche de dix heures dans la poussière brûlante, comme nous venions d’arriver au campement, auprès d’un puits d’eau bourbeuse et saumâtre qui nous parut cependant exquise, le lieutenant me secoua soudain au moment où j’allais me reposer sous la tente, et me dit, en me montrant l’extrême horizon vers le sud : « Ne voyez-vous rien là-bas ? »
Après avoir regardé, je répondis : « Si, un tout petit nuage gris. »
Alors le lieutenant sourit : « Eh bien ! Asseyez-vous là et continuez à regarder ce nuage. »
Surpris, je demandai pourquoi. Mon compagnon reprit : « Si je ne me trompe, c’est un ouragan de sable qui nous arrive. »
Il était environ quatre heures, et la chaleur se maintenait encore à quarante-huit degrés sous la tente. L’air semblait dormir sous l’oblique et intolérable flamme du soleil. Aucun souffle, aucun bruit, sauf le mouvement des mâchoires de nos chevaux entravés, qui mangeaient l’orge, et les vagues chuchotements des Arabes qui, cent pas plus loin, préparaient notre repas.
On eût dit cependant qu’il y avait autour de nous une autre chaleur que celle du ciel, plus concentrée, plus suffocante, comme celle qui vous oppresse quand on se trouve dans le voisinage d’un incendie considérable. Ce n’étaient point ces souffles ardents, brusques et répétés, ces caresses de feu qui annoncent et précèdent le siroco, mais un échauffement mystérieux de tous les atomes de tout ce qui existe.
Je regardais le nuage qui grandissait rapidement, mais à la façon de tous les nuages. Il était maintenant d’un brun sale et montait très haut dans l’espace. Puis il se développa en large, ainsi que nos orages du Nord. En vérité, il ne me semblait présenter absolument rien de particulier.
Enfin, il barra tout le sud. Sa base était d’un noir opaque, son sommet cuivré paraissait transparent.
Un grand remuement derrière moi me fit me retourner. Les Arabes avaient fermé notre tente, et ils en chargeaient les bords de lourdes pierres. Chacun courait, appelait, se démenait avec cette allure effarée qu’on voit dans un camp au moment d’une attaque.
Il me sembla soudain que le jour baissait ; je levai les yeux vers le soleil. Il était couvert d’un voile jaune et ne paraissait plus être qu’une tache pâle et ronde s’effaçant rapidement.
Alors, je vis un surprenant spectacle. Tout l’horizon vers le sud avait disparu, et une masse nébuleuse qui montait jusqu’au zénith venait vers nous, mangeant les objets, raccourcissant à chaque seconde les limites de la vue, noyant tout.
Instinctivement, je me reculai vers la tente. Il était temps. L’ouragan, comme une muraille jaune et démesurée, nous touchait. Il arrivait, ce mur, avec la rapidité d’un train lancé ; et soudain il nous enveloppa dans un tourbillon furieux de sable et de vent, dans une tempête de terre impalpable, brûlante, bruissante, aveuglante et suffocante.
Notre tente, maintenue par des pierres énormes, fut secouée comme une voile, mais résista. Celle de nos spahis, moins assujettie, palpita quelques secondes, parcourue par de grands frissons de toile ; puis soudain, arrachée de terre, elle s’envola et disparut aussitôt dans la nuit de poussière mouvante qui nous entourait.
On ne voyait plus rien à dix pas à travers ces ténèbres de sable. On respirait du sable, on buvait du sable, on mangeait du sable. Les yeux en étaient remplis, les cheveux en étaient poudrés ; il se glissait par le cou, par les manches, jusque dans nos bottes.
Ce fut ainsi toute la nuit. Une soif ardente nous torturait. Mais l’eau, le lait, le café, tout était plein de sable qui craquait sous notre dent. Le mouton rôti en était poivré ; le kous-kous semblait fait uniquement de fins graviers roulés ; la farine du pain n’était plus que de la pierre pilée menu.
Un gros scorpion vint nous voir. Ce temps, qui plaît à ces bêtes, les fait toutes sortir de leurs trous. Les chiens du douar voisin ne hurlèrent pas ce soir-là.
Puis, au matin, tout était fini ; et le grand tyran meurtrier de l’Afrique, le soleil, se leva, superbe, sur un horizon clair.
On partit un peu tard, cette inondation de sable ayant troublé notre sommeil.
Devant nous s’élevait la chaîne du Djebel-Gada qu’il fallait traverser. Un défilé s’ouvrait sur la droite ; on suivit la montagne jusqu’au passage, où l’on s’engagea. Nous retrouvions l’alfa, l’horrible alfa. Puis soudain je crus découvrir la trace effacée d’une route, des ornières de roues. Je m’arrêtai, surpris. Une route ici, quel mystère ? J’en eus l’explication. Un ancien caïd de cette tribu, ayant été grisé par l’exemple des Européens habitant Alger, voulut se donner le luxe d’un carrosse dans le désert. Mais, pour avoir une voiture, il faut posséder des routes, aussi cet ingénieux potentat occupa-t-il pendant des mois tous les Arabes, ses sujets, à des travaux de grande voirie. Ces misérables, sans pioches, sans pelles, sans outils, terrassant le plus souvent avec leurs mains, parvinrent cependant à aplanir plusieurs kilomètres de chemin. Cela suffisait à leur maître, qui s’offrit ainsi des promenades à travers le Sahara dans un stupéfiant équipage, en compagnie de beautés indigènes qu’il envoyait quérir à Djelfa par son favori, un jeune Arabe de seize ans.
Читать дальше