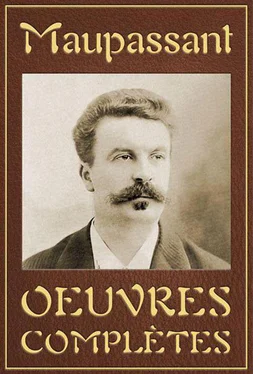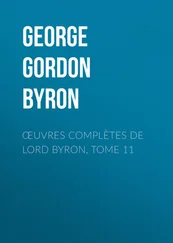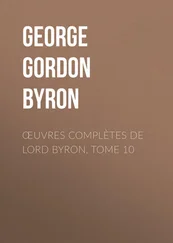On nous fit entrer d’abord dans une petite cabane en bois où on nous vêtit de blouses de toile nouées au cou et aux poignets, de culottes de toile nouées aux chevilles, et de gros souliers de cuir jaune ; puis, gagnant le milieu du fleuve par un étroit passage en planches porté sur pilotis, nous arrivâmes bientôt sur un radier en construction.
Quatre cheminées surmontées de leurs lanternes donnaient accès dans le caisson, qui se trouvait alors à huit mètres au-dessous du niveau de l’eau.
On ouvrit la petite porte d’une de ces lanternes, et nous passâmes l’un après l’autre, péniblement, par l’ouverture pour entrer dans une étroite chambre ronde, obscure, où nous nous serrâmes en cercle, comme des sardines dans leur boîte, autour d’une plaque de fer ronde, comparable à celles qui ferment les trous d’égout sur les trottoirs, mais beaucoup plus petite, si petite qu’on ne pouvait croire, en la voyant, qu’un homme pourrait descendre par là.
Nous étions six dans cette case : les deux ingénieurs, mon ami Pol, un contremaître, un terrassier et moi. On alluma deux bougies, puis on ferma la porte du dehors. Alors, un des ingénieurs nous donna des conseils, car nous allions subir une épreuve assez pénible. Il s’agissait de faire pénétrer dans la lanterne l’air comprimé du caisson pour égaliser la pression en haut et en bas. Donc, on ouvrit un robinet : un bruit de souffle furieux, un bruit de machine à vapeur se fit entendre, et brusquement nous ressentîmes, au fond des oreilles, une sensation étrange et douloureuse.
L’air comprimé, envahissant la chambre, tendait à les ariser nos tympans, la pression intérieure de nos corps se trouvant tout â coup infiniment moindre que la pression extérieure.
Il faut alors serrer avec les doigts les narines, et faire le simulacre de souffler, pour tendre, du dedans au dehors, ta peau légère du tympan, et lui permettre de résister à la force nouvelle qui la presse.
On procédait d’ailleurs avec prudence, car certains hommes ne peuvent supporter ce passage de l’air libre à l’air comprimé, et les accidents, bien que fort rares, sont possibles.
Au bout de quelques minutes, tout malaise avait disparu. Alors on ouvrit la petite trappe ronde que nous entourions, et j’aperçus, là-bas, très loin, au bout d’une longue cheminée, une lueur vague et des hommes qui remuaient.
Il fallait descendre par ce tuyau au moyen d’échelons en fer, gros comme le doigt. Un des ingénieurs plongea le premier dans ce trou gluant, dont les parois sont bourrées de vase car c’est aussi par là qu’on remonte toute la saleté du fond du fleuve.
Je le suivis, cherchant du pied dans l’ombre les barres de fer du dessous, cramponné par tes mains à celles du dessus, m’appuyant des reins contre la paroi fangeuse ; et les hommes qui descendaient sur moi me faisaient tomber sur la tête une pluie de terre humide qu’ils détachaient, avec leurs dos, des murs de ce tube de tôle.
Au bout de deux ou trois minutes, après une gymnastique pénible pour changer d’échelles, les bouts raccordés ne se suivant pas, je mis le pied sur le sol quel sol ! Une bouillie où on enfonçait jusqu’à mi-jambes.
Alors j’aperçus une vaste cave, où travaillaient une trentaine d’hommes, tous Autrichiens et Italiens, car les Français refusent de descendre dans ces dangereuses machines, qui usent, en quelques mois, la santé d’un ouvrier.
J’allais, guidé par l’ingénieur qui dirige ce travail, M. Clerc. Les murs de tôle, terminés en lame, doublés de maçonnerie pour augmenter leur résistance, reposent sur le sol liquide qu’ils pénètrent peu à peu à mesure que les hommes creusent et font monter les déblais par les cheminées.
L’eau ne peut entrer dans cette demeure souterraine, chassée par la puissance de l’air que les pompes insufflent sans cesse dedans. Quelques bougies éclairent à peine cette immense pièce lugubre, silencieuse, où les ouvriers s’agitent comme des ombres. Un vague bruit de machine, un ronflement monotone et continu en trouble seul le silence. On touche du front le plafond de fer qui supporte le pont, le pont qui grandit là-haut sous les mains des maçons, à mesure que sa fondation descend sous les mains des terrassiers.
M. Clerc me raconte un détail singulier. Cette vie dans l’air comprimé agit d’une façon dangereuse sur le système nerveux, et il suffit d’un séjour de quelques instants dans cette atmosphère pour éprouver des troubles cérébraux ou physiques très sensible.
Ce phénomène a rendu jusqu’ici inutile ou plutôt inutilisable une découverte de M. Paul Bert.
Celui-ci, ayant constaté que le protoxyde d’azote perd ses propriétés toxiques dans l’air comprimé, a eu l’idée de construire une grande chambre claire où les chirurgiens pourraient opérer les malades endormis au moyen de ce gaz, sous une pression aussi faible que possible. Mais il arriva que les médecins perdaient là-dedans leur présence d’esprit, leur calme, leur sûreté de main ; et il fallut renoncer à se servir de cette invention.
Enfin nous remontons par la même cheminée, laissant les terrassiers accomplir leur triste besogne.
Puis il fallut subir de nouveau l’opération du passage à l’air libre, en se bouchant les oreilles pour diminuer la tension intérieure du tympan, et nous reparaissons au jour, couverts de fange jaune des pieds à la tête.
Deux heures plus tard, nous arrivions au magnifique barrage de Poses, construit sur les plans de M. l’ingénieur en chef Caméré.
Ce barrage, le plus haut qui soit au monde, retenant l’eau au moyen de rideaux ou plutôt de stores de bois, qui se déroulent, peut maintenir le niveau du fleuve à une élévation de cinq mètres, tandis que les anciens systèmes ne parviennent pas à soutenir trois mètres d’eau.
Le barrage de Poses, grâce à sa puissance, rendra navigable la Seine sur une distance de quarante kilomètres, sans un obstacle.
Rien de plus étonnant que les écluses et que le labyrinthe des couloirs où passera l’eau pour les emplir ou les vider. On songe là-dedans à des catacombes gigantesques, à des voûtes de cathédrales.
Et nous repartons, le soir même, pour Rouen, dans notre petite yole, qui glisse vivement le long des berges, en faisant fuir, comme des éclairs bleus, les rapides martins-pêcheurs.
La femme de lettres
( Le Figaro , 3 juillet 1884)
Un éminent philosophe anglais, M. Herbert Spencer, a écrit dans son livre L’Introduction à la science sociale que la femme artiste est un monstre dans ta nature ; et, comparant les facultés et les fonctions de l’homme et de la femme, il conclut que la production cérébrale chez la femme, être destiné à la production de l’espèce, est aussi anormale que la faculté d’allaiter les enfants chez l’homme. On a pourtant rencontré quelquefois ces deux phénomènes : l’homme nourrice et la femme artiste ; mais il ne faut pas admettre ces rares exceptions comme des règles.
M. Herbert Spencer examine et analyse ensuite les causes de l’impuissance générale et définitive du sexe à qui nous devons George Sand, en matière d’art.
Un autre philosophe, un Allemand, Schopenhauer, développant la même thèse avec une conviction passionnée, prend comme exemple de cette impuissance absolue deux arts où les femmes s’exercent autant que nous, sinon davantage, la peinture et la musique. Il n’a pourtant jamais existé un grand peintre ni un très grand musicien parmi les femmes, malgré leurs efforts, leur instruction et l’acharnement des concierges parisiens à envoyer leurs filles au Conservatoire.
Schopenhauer donne également les raisons de cet insuccès constant.
Читать дальше