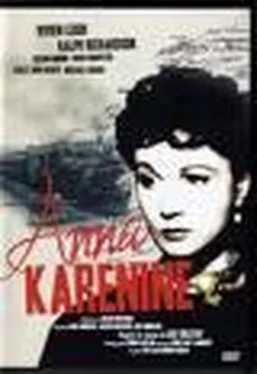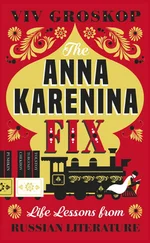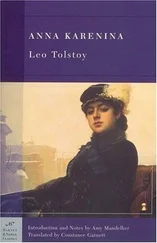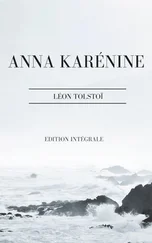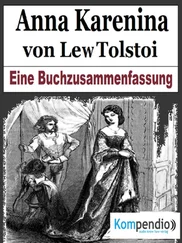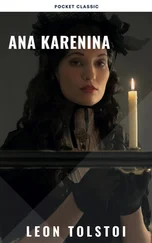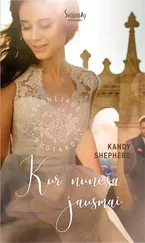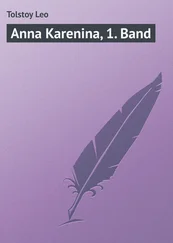Wronsky avait déjà compris l’inutilité d’un duel en pareille circonstance et la nécessité d’adoucir le conseiller titulaire et d’étouffer cette affaire. Le colonel l’avait fait appeler parce qu’il le savait homme d’esprit et soucieux de l’honneur de son régiment. C’était à la suite de leur consultation que Wronsky, accompagné de Pétritzky et de Kédrof, était allé porter leurs excuses au conseiller titulaire, espérant que son nom et ses aiguillettes d’aide de camp contribueraient à calmer l’offensé; Wronsky n’avait réussi qu’en partie, comme il venait de le raconter, et la réconciliation semblait encore douteuse.
Au théâtre, Wronsky emmena le colonel au foyer et lui raconta le succès, ou plutôt l’insuccès de sa mission. Réflexion faite, celui-ci résolut de laisser l’affaire où elle en était, mais ne put s’empêcher de rire en questionnant Wronsky.
«Vilaine histoire, mais bien drôle! Kédrof ne peut pourtant pas se battre avec ce monsieur! Et comment trouvez-vous Claire ce soir? Charmante!… dit-il en parlant d’une actrice française. On a beau la voir souvent, elle est toujours nouvelle. Il n’y a que les Français pour cela.»
La princesse Betsy quitta le théâtre sans attendre la fin du dernier acte. À peine eut-elle le temps d’entrer dans son cabinet de toilette pour mettre un nuage de poudre de riz sur son long visage pâle, arranger un peu sa toilette, et commander le thé au grand salon, que les voitures arrivèrent, et s’arrêtèrent au vaste perron de son palais de la grande Morskaïa. Le suisse monumental ouvrait sans bruit l’immense porte devant les visiteurs. La maîtresse de la maison, le teint et la coiffure rafraîchis, vint recevoir ses convives; les murs du grand salon étaient tendus d’étoffes sombres, et le sol couvert d’épais tapis; sur une table dont la nappe, d’une blancheur éblouissante, était vivement éclairée par de nombreuses bougies, se trouvait un samovar d’argent, avec un service à thé en porcelaine transparente.
La princesse prit place devant le samovar et ôta ses gants. Des laquais, habiles à transporter des sièges presque sans qu’on s’en aperçût, aidèrent tout le monde à s’asseoir et à se diviser en deux camps; l’un autour de la princesse, l’autre dans un coin du salon, autour d’une belle ambassadrice aux sourcils noirs, bien arqués, vêtue de velours noir. La conversation, comme il arrive au début d’une soirée, interrompue par l’arrivée de nouveaux visages, les offres de thé et les échanges de politesse, semblait chercher à se fixer.
«Elle est remarquablement belle comme actrice; on voit qu’elle a étudié Kaulbach, disait un diplomate dans le groupe de l’ambassadrice: Avez-vous remarqué comme elle est tombée?
– Je vous en prie, ne parlons pas de Nilsson! On ne peut plus rien en dire de nouveau, – dit une grosse dame blonde fort rouge, sans sourcils et sans chignon, habillée d’une robe de soie fanée: c’était la princesse Miagkaïa, célèbre pour la façon dont elle savait tout dire, et surnommée l’ Enfant terrible à cause de son sans-gêne. La princesse était assise entre les deux groupes, écoutant ce qui se disait dans l’un ou dans l’autre, et y prenant également intérêt. – Trois personnes m’ont dit aujourd’hui cette même phrase sur Kaulbach. Il faut croire qu’on s’est donné le mot; et pourquoi cette phrase a-t-elle tant de succès?»
Cette observation coupa court à la conversation.
«Racontez-nous quelque chose d’amusant, mais qui ne soit pas méchant, – dit l’ambassadrice, qui possédait cet art de la causerie que les Anglais ont surnommé small talk ; elle s’adressait au diplomate.
– On prétend qu’il n’y a rien de plus difficile, la méchanceté seule étant amusante, répondit celui-ci avec un sourire. J’essayerai cependant. Donnez-moi un thème, tout est là. Quand on tient le thème, rien n’est plus aisé que de broder dessus. J’ai souvent pensé que les célèbres causeurs du siècle dernier seraient bien embarrassés maintenant: de nos jours l’esprit est devenu ennuyeux.
– Vous n’êtes pas le premier à le dire,» interrompit en riant l’ambassadrice.»
La conversation débutait d’une façon trop anodine pour qu’elle pût longtemps continuer sur le même ton, et pour la ranimer il fallut recourir au seul moyen infaillible: la médisance.
«Ne trouvez-vous pas que Toushkewitch a quelque chose de Louis XV? dit quelqu’un en indiquant des yeux un beau jeune homme blond qui se tenait près de la table.
– Oh oui, il est dans le style du salon, c’est pourquoi il y vient souvent.»
Ce sujet de conversation se soutint, parce qu’il ne consistait qu’en allusions: on ne pouvait le traiter ouvertement, car il s’agissait de la liaison de Toushkewitch avec la maîtresse de la maison.
Autour du samovar, la causerie hésita longtemps entre les trois sujets inévitables: la nouvelle du jour, le théâtre et le jugement du prochain; c’est ce dernier qui prévalut.
«Avez-vous entendu dire que la Maltishef, la mère, et non la fille, se fait un costume de diable rose ?
– Est-ce possible? non, c’est délicieux.
– Je m’étonne qu’avec son esprit, car elle en a, elle ne sente pas ce ridicule.» Chacun eut un mot pour critiquer et déchirer la malheureuse Maltishef, et la conversation s’anima, vive et pétillante comme fagot qui flambe.
Le mari de la princesse Betsy, un bon gros homme, collectionneur passionné de gravures, entra tout doucement à ce moment; il avait entendu dire que sa femme avait du monde, et voulait paraître au salon avant d’aller à son cercle. Il s’approcha de la princesse Miagkaïa qui, à cause des tapis, ne l’entendit pas venir.
«Avez-vous été content de la Nilsson? lui demanda-t-il.
– Peut-on effrayer ainsi les gens en tombant du ciel sans crier gare! s’écria-t-elle. Ne me parlez pas de l’Opéra, je vous en prie: vous n’entendez rien à la musique. Je préfère m’abaisser jusqu’à vous, et vous entretenir de vos gravures et de vos majoliques. Eh bien, quel trésor avez-vous récemment découvert?
– Si vous le désirez, je vous le montrerai; mais vous n’y comprendrez rien.
– Montrez toujours. Je fais mon éducation chez ces gens-là, comment les nommez-vous, les banquiers? ils ont des gravures superbes qu’ils nous ont montrées.
– Comment, vous êtes allés chez les Schützbourg? demanda de sa place, près du samovar, la maîtresse de la maison.
– Oui, ma chère. Ils nous ont invités, mon mari et moi, à dîner, et l’on m’a dit qu’il y avait à ce dîner une sauce qui avait coûté mille roubles, répondit la princesse Miagkaïa à haute voix, se sachant écoutée de tous; – et c’était même une fort mauvaise sauce, quelque chose de verdâtre. J’ai dû les recevoir à mon tour et leur ai fait une sauce de la valeur de quatre-vingt-cinq kopecks; tout le monde a été content. Je ne puis pas faire des sauces de mille roubles, moi!
– Elle est unique, dit Betsy.
– Étonnante!» ajouta quelqu’un.
La princesse Miagkaïa ne manquait jamais son effet, qui consistait à dire avec bon sens des choses fort ordinaires, qu’elle ne plaçait pas toujours à propos, comme dans ce cas; mais, dans le monde où elle vivait, ce gros bon sens produisait l’effet des plus fines plaisanteries; son succès l’étonnait elle-même, ce qui ne l’empêchait pas d’en jouir.
Profitant du silence qui s’était fait, la maîtresse de la maison voulut établir une conversation plus générale, et, s’adressant à l’ambassadrice:
«Décidément, vous ne voulez pas de thé? Venez donc par ici.
– Non, nous sommes bien dans notre coin, répondit celle-ci avec un sourire, en reprenant un entretien interrompu qui l’intéressait beaucoup: il s’agissait des Karénine, mari et femme.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу