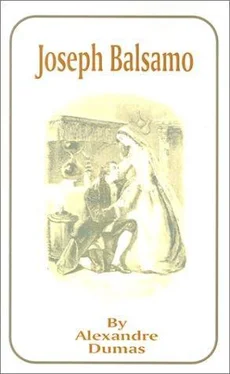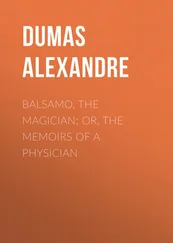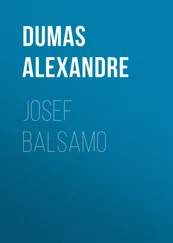– Je suis l’homme du monde le moins difficile à vivre, comtesse. Mais vous permettez que je fasse appeler mon neveu, puisque vous voulez bien lui accorder la faveur de le recevoir.
Richelieu s’approcha de la fenêtre; les dernières lueurs du crépuscule éclairaient encore la cour. Il fit signe à un de ses valets de pied, qui guettait cette fenêtre, et qui partit en courant sur son signe.
Cependant, on commençait à allumer chez la comtesse.
Dix minutes après le départ du valet, une voiture entra dans la première cour. La comtesse tourna vivement les yeux vers la fenêtre.
Richelieu surprit le mouvement, qui lui parut un excellent pronostic pour les affaires de M. d’Aiguillon, et, par conséquent, pour les siennes.
– Elle goûte l’oncle, se dit-il, elle prend goût au neveu; nous serons les maîtres ici.
Tandis qu’il se repaissait de ces fumées chimériques, un petit bruit se fit entendre à la porte, et la voix du valet de chambre de confiance annonça le duc d’Aiguillon.
C’était un seigneur fort beau et fort gracieux, d’une mise aussi riche qu’élégante et bien entendue. M. d’Aiguillon avait passé l’âge de la fraîche jeunesse; mais il était de ces hommes qui, par le regard et la volonté, sont jeunes jusqu’à la vieillesse décrépite.
Les soucis du gouvernement n’avaient pas imprimé une ride sur son front. Ils avaient seulement agrandi le pli naturel qui semble, chez les hommes État et chez les poètes, l’asile des grandes pensées. Il tenait droite et haute sa belle tête pleine de finesse et de mélancolie, comme s’il savait que la haine de dix millions d’hommes pesait sur cette tête, mais comme si, en même temps, il eût voulu prouver que le poids n’était pas au-dessus de sa force.
M. d’Aiguillon avait les plus belles mains du monde, de ces mains qui semblent blanches et délicates, même dans les flots de la dentelle. On prisait fort en ce temps une jambe bien tournée; celle du duc était un modèle d’élégance nerveuse et de forme aristocratique. Il y avait en lui de la suavité du poète, de la noblesse du grand seigneur, de la souplesse et du moelleux d’un mousquetaire. Pour la comtesse, c’était un triple idéal: elle trouvait en un seul modèle trois types que d’instinct cette belle sensuelle devait aimer.
Par une singularité remarquable, ou, pour mieux dire, par un enchaînement de circonstances combinées par la savante tactique de M. d’Aiguillon, ces deux héros de l’animadversion publique, la courtisane et le courtisan, ne s’étaient pas encore vus face à face, avec tous leurs avantages.
Depuis trois ans, en effet, M. d’Aiguillon s’était fait très occupé en Bretagne ou dans son cabinet. Il avait peu prodigué sa personne à la cour, sachant bien qu’il allait arriver une crise favorable ou défavorable: que, dans le premier cas, mieux fallait offrir à ses administrés les bénéfices de l’inconnu; dans le second, disparaître sans trop laisser de traces pour pouvoir facilement sortir du gouffre plus tard avec une figure neuve.
Et puis une autre raison dominait tous ces calculs; celle-ci est du ressort du roman, elle était pourtant la meilleure.
Avant que madame du Barry fût comtesse et effleurât chaque nuit de ses lèvres la couronne de France, elle avait été une jolie créature souriante et adorée; elle avait été aimée, bonheur sur lequel elle ne devait plus compter jamais depuis qu’elle était crainte.
Parmi tous les hommes jeunes, riches, puissants et beaux qui avaient fait leur cour à Jeanne Vaubernier, parmi tous les rimeurs qui avaient accolé au bout de deux vers ces mots Lange et ange , M. le duc d’Aiguillon avait autrefois figuré en première ligne. Mais, soit que le duc n’eût pas été pressé, soit que mademoiselle Lange n’eût pas été aussi facile que ses détracteurs le prétendaient, soit qu’enfin, et ceci n’ôtera de mérite ni à l’un ni à l’autre, soit que l’amour subit du roi eût divisé les deux cœurs prêts à s’entendre, M. d’Aiguillon avait rengainé vers, acrostiches, bouquets et parfums; mademoiselle Lange avait fermé sa porte de la rue des Petits-Champs; le duc avait tiré vers la Bretagne, étouffant ses soupirs, et mademoiselle Lange avait envoyé tous les siens du côté de Versailles, à M. le baron de Gonesse, c’est-à-dire au roi de France.
Il en résulta que cette disparition subite de d’Aiguillon avait fort peu occupé d’abord madame du Barry, parce qu’elle avait peur du passé, mais qu’ensuite, voyant l’attitude silencieuse de son ancien adorateur, elle avait été intriguée, puis émerveillée, et que, bien placée pour juger les hommes, elle avait jugé celui-là un véritable homme d’esprit.
C’était beaucoup, cette distinction, pour la comtesse; mais ce n’était pas tout, et le moment allait venir où peut-être elle jugerait d’Aiguillon un homme de cœur.
Il faut dire que la pauvre mademoiselle Lange avait ses raisons pour craindre le passé. Un mousquetaire, amant jadis heureux, disait-il, était entré un jour jusque dans Versailles pour redemander à mademoiselle Lange un peu de ses faveurs passées, et ces paroles, étouffées bien vite par une hauteur toute royale, n’en avaient pas moins fait jurer l’écho pudique du palais de madame de Maintenon.
On a vu que, dans toute sa conversation avec madame du Barry, le maréchal n’avait jamais effleuré le chapitre d’une connaissance de son neveu et de mademoiselle Lange. Ce silence, de la part d’un homme aussi habitué que le vieux duc à dire les choses du monde les plus difficiles, avait profondément surpris, et, faut-il le dire, inquiété la comtesse.
Elle attendait donc impatiemment M. d’Aiguillon pour savoir enfin à quoi s’en tenir, et si le maréchal avait été discret, ou était ignorant.
Le duc entra.
Respectueux avec aisance et assez sûr de lui pour saluer entre la reine et la femme de cour ordinaire, il subjugua tout d’un coup, par cette nuance délicate, une protectrice toute disposée à trouver le bien parfait et le parfait merveilleux.
M. d’Aiguillon prit ensuite la main de son oncle qui, s’avançant vers la comtesse, lui dit de sa voix pleine de caresses:
– Voici M. le duc d’Aiguillon, madame: ce n’est pas mon neveu, c’est un de vos serviteurs les plus passionnés que j’ai l’honneur de vous présenter.
La comtesse regarda le duc sur ce mot, et elle le regarda comme font les femmes, c’est-à-dire avec des yeux à qui rien n’échappe; elle ne vit que deux fronts courbés respectueusement, et deux figures qui remontèrent calmes et sereines après le salut.
– Je sais, répondit madame du Barry, que vous aimez M. le duc, maréchal; vous êtes mon ami. Je prierai monsieur, par déférence pour son oncle, de l’imiter en tout ce que son oncle fera d’agréable pour moi.
– C’est la conduite que je me suis tracée à l’avance, madame, répondit le duc d’Aiguillon avec une révérence nouvelle.
– Vous avez bien souffert en Bretagne? dit la comtesse.
– Oui, madame, et je ne suis pas au bout, répondit d’Aiguillon.
– Je crois que si, monsieur; d’ailleurs, voilà M. de Richelieu qui va vous aider puissamment.
D’Aiguillon regarda Richelieu comme surpris.
– Ah! fit la comtesse, je vois que le maréchal n’a pas encore eu le temps de causer avec vous; c’est tout simple, vous arrivez de voyage. Eh bien, vous devez avoir cent choses à vous dire, je vous laisse, maréchal. Monsieur le duc, vous êtes ici chez vous.
La comtesse, à ces mots, se retira.
Mais elle avait un projet. La comtesse n’alla pas bien loin. Derrière le boudoir, un grand cabinet s’ouvrait où le roi souvent, lorsqu’il venait à Luciennes, aimait à s’asseoir au milieu des chinoiseries de toute espèce. Il préférait ce cabinet au boudoir, parce que, de ce cabinet, on entendait tout ce qui se disait dans la chambre voisine.
Читать дальше