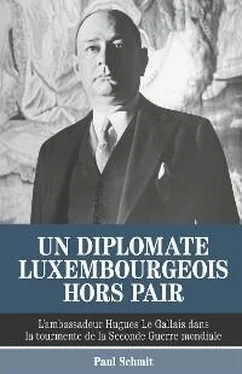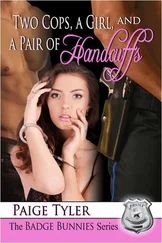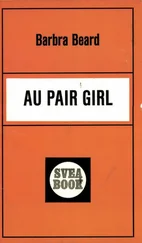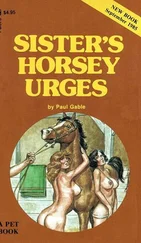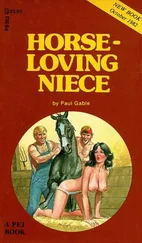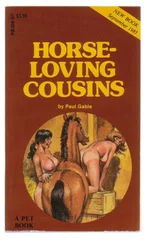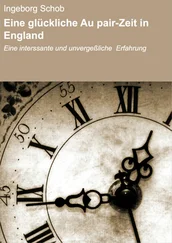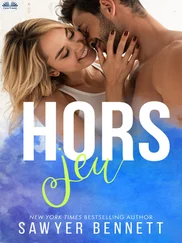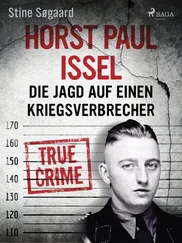Revenons maintenant à cette période si tendue et complexe d’avant la guerre. Le Grand-Duché se sentait menacé par son voisin allemand, mais continuait d’observer sa neutralité « perpétuelle et désarmée », lui imposée par le traité de Londres du 11 mai 1867 et violée une première fois en 1914 par l’invasion allemande. 1937, l’année de l’installation au Luxembourg de Pisana et d’Hugues, avait été celle du rejet, en juin, de la loi dite « muselière ». Ce projet de loi menaçant les libertés publiques et tendant en fait à interdire le Parti communiste fut rejeté lors d’un référendum par la majorité du corps électoral. C’était un désaveu cinglant pour le ministre d’Etat chrétien-social de l’époque, Joseph Bech, 89qui dut céder ce poste à Pierre Dupong, 90la figure de proue de l’aile gauche de son parti. Bech, qui était proche de la Grande-Duchesse et pour lequel Le Gallais allait développer une admiration certaine, gardera néanmoins le portefeuille des Affaires étrangères jusqu’en 1959. D’aucuns ont vu en lui un Talleyrand luxembourgeois, Le Gallais ayant développé une certaine admiration pour l’un et pour l’autre. Nous ignorons dans quelle mesure Le Gallais fréquentait ces acteurs décisifs de sa vie des prochaines décennies au cours de son séjour de trois ans à Luxembourg. Une lettre de fin août 1944, à l’approche de la libération du pays, écrite par Bech au ministre à Washington, semble indiquer que Le Gallais avait déjà, avant la guerre, fréquenté le couple : « Ma femme m’a rappelé récemment le tour de la Siegfried Line que vous lui aviez fait faire avant la guerre et dont elle était rentrée très impressionnée. » 91Le Luxembourg était un pays d’un peu moins de 300.000 habitants, et tout le monde, ou presque, se connaissait. Les Le Gallais habitaient le quartier de Belair, à quelques centaines de mètres de la demeure des Bech. Il allait bientôt entrer au service de ce ministre chevronné.
89Joseph Bech (1887-1975), président du gouvernement de 1926 à 1937, tout en gérant le portefeuille des Affaires étrangères après le référendum de 1937. A repris la présidence du gouvernement après la mort de Pierre Dupong (1953), jusqu’en 1958.
90Pierre Dupong (1885-1953), Premier ministre durant 16 années, de 1937 jusqu’à sa mort, le 23 décembre 1953. À l’époque, le Premier ministre était désigné comme ministre d’Etat, président du gouvernement.
91La ligne Siegfried d’origine (appelée ligne Hindenburg par les Alliés) est une ligne fortifiée construite par l’Allemagne en 1916 et 1917, pendant la Première Guerre mondiale.
REPRÉSENTATION DIPLOMATIQUE DU GRAND-DUCHÉ AVANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Comme esquissé plus haut, à l’époque, la représentation diplomatique était limitée et souvent liée aux intérêts de l’Arbed. Ce conglomérat et son bras commercial, Columeta, ont conféré une dimension internationale au petit Grand-Duché. En 1940, le Grand-Duché était représenté à Washington par Hugues Le Gallais, à Londres par André Clasen 92et, durant la guerre, à Londres par Georges Schommer 93auprès des gouvernements tchécoslovaque, polonais et belge. Antoine Funck, 94en poste à Paris depuis 1934, demeura à Vichy jusqu’à l’automne 1942. Le cousin germain d’Hugues Le Gallais, Auguste Collart, était à La Haye. 95À Berlin, Albert Wehrer et le secrétaire de légation Jean Sturm représentaient le Luxembourg du point de vue diplomatique jusqu’à l’occupation. Le comte Gaston de Marchant et d’Ansembourg 96était chargé d’affaires du Luxembourg à Bruxelles avec Claus Cito comme consul. Au cours de cette période sombre et incertaine, la perception de la guerre a varié d’une personne à l’autre : Hugues Le Gallais, qui se trouvait aux Etats-Unis, n’a pas vécu le cataclysme de la même façon qu’André Clasen, qui a vécu les bombardements nazis à Londres, qu’Auguste Collart, qui a fait l’expérience de l’occupation à La Haye avant d’être incarcéré au camp de concentration de Hinzert et, par la suite, déporté avec sa famille, ou qu’Antoine Funck, qui a été en résidence forcée à Vichy et qui s’est enfui en Suisse après l’occupation de la zone dite libre par les Nazis. 97Dans la mesure du possible, ces diplomates ont entretenu des contacts avec le gouvernement en exil, fonction exigeante présupposant une certaine humilité, apprise sur le tas par Le Gallais. Au début de la guerre, le ministre des Affaires étrangères, Joseph Bech, affichant un panache inné, à l’instar d’Hugues Le Gallais, de son côté, s’est rendu en Espagne et au Portugal avant de s’établir à Londres où il a été confronté au « Blitz » de la capitale britannique. La plupart du temps, Bech a entretenu des relations amicales avec Pierre Dupong et a veillé à ce que les deux autres ministres, celui en charge du Travail, Pierre Krier, 98et celui de la Justice, Victor Bodson, ne marchent pas sur les plates-bandes. Cela n’était que naturel, tout comme il était inévitable que l’entente initiale entre ministres appartenant à des familles politiques concurrentes fut mise à mal au fur et à mesure que l’exil se prolongeait et que les problèmes se faisaient de plus en plus nombreux et épineux. 99Par moments, des frictions se faisaient jour entre Bech et Le Gallais : […] Bech supportait mal la séparation des ministres dont une moitié se trouvait à Montréal et l’autre à Londres, et il souffrait de l’ambiguïté que cette scission laissait planer sur le siège officiel du gouvernement. Le ministre plénipotentiaire du Luxembourg à Washington manœuvrait habilement pour retenir la Grande-Duchesse dans l’hémisphère occidental. Pour Le Gallais, les Etats-Unis étaient destinés à devenir le facteur déterminant pour l’issue de la guerre et pour l’édification du nouvel ordre international. Le Premier ministre Dupong n’était pas insensible aux arguments de Le Gallais, qui invoquait en outre l’existence d’une colonie luxembourgeoise importante aux Etats-Unis et le rôle que la Grande-Duchesse pouvait jouer pour mobiliser l’opinion publique américaine pour la cause des pays opprimés. Ce fut sur les instances de Bech que le président du gouvernement fut d’accord, en mai 1941, pour déclarer Londres siège officiel du gouvernement, et il s’y rendit à plusieurs reprises pour souligner le sérieux de la décision. L’ambassadeur Heisbourg, ayant écrit quatre tomes sur les années de guerre, conclut dans ses livres sur l’exil que Le Gallais et Bech avaient raison chacun à sa façon. Bech a fait part de son avis à Le Gallais dans une lettre du 10 septembre 1941. Un de ses adversaires politiques, René Blum, qui avait été ministre de la Justice avant la guerre et qui fut nommé, en 1944, ministre du Luxembourg en Union Soviétique, écrivait à Dupong, le 9 septembre 1945, alors que la campagne électorale battait son plein à Luxembourg : « La langue me brûle de proclamer tout haut à la figure des ignorants la vérité que toi et Joseph Bech vous avez, grâce à vos efforts, sauvé l’existence de notre pays quorum testis fui [dont je fus témoin] ! » Dans la mesure où Le Gallais avait son opinion bien tranchée à ce sujet, nous allons y revenir en détail.
Un Corps diplomatique en nombre limité donc, au point que le ministre des Affaires Etrangères Joseph Bech s’était demandé, dans une note de 1937, « si on peut parler de politique extérieure lorsqu’il s’agit d’un petit pays, surtout neutre ? » 100Comme si souvent dans le Corps diplomatique, les points de vue divergeaient, l’intérêt général dominant toutefois, la plupart du temps, les velléités particulières. À Washington, Hugues Le Gallais n’avait, à vrai dire, pas de prédécesseur, du moins personne qui y ait résidé. Il ne pensait donc peut-être pas, comme si souvent quelques-uns de ses collègues, que le prédécesseur soit un incompétent et le successeur un intrigant. Il soutiendra d’ailleurs, comme nous allons le voir, Heisbourg comme son successeur à Washington. Ne bouleversant ni les coutumes ni les convenances, notre représentant de l’industrie reconverti en diplomate était loin des autres acteurs dans la capitale ou de ceux en poste, plaçant les pions et cherchant ses marques dans un pays qu’il ne connaissait pas vraiment, à part peut-être les souvenirs transmis du périple de son grand-père maternel et l’un ou l’autre passage au retour du Japon dans les années 20 et 30.
Читать дальше