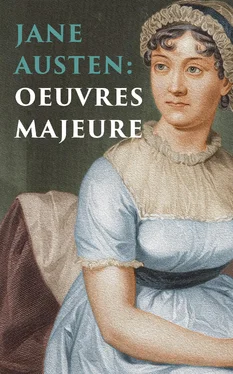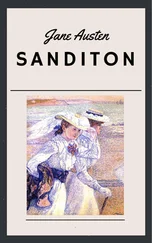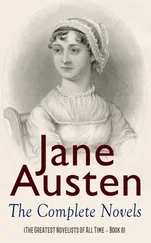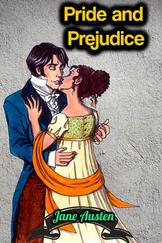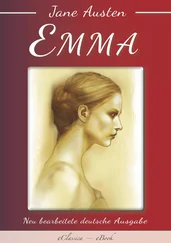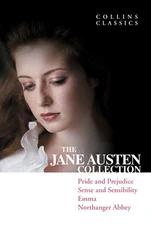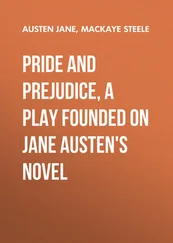Il essaya de sourire et répliqua avec une espèce d’effort : Vous ne voulez pas me comprendre. J’entends… les engagemens de votre sœur avec M. Willoughby de Haute-Combe,… Ils sont connus généralement ; et j’ai cru…
— Ils ne peuvent être connus, dit Elinor, puisque la famille les ignore.
Il parut très-surpris. — Je vous demande mille pardons, dit-il ; je crains à présent que mes questions n’aient été très-indiscrètes ; mais je ne pouvais imaginer qu’il y eût du mystère, puisqu’ils correspondent ouvertement, et que tout le monde parle de leur mariage.
— Tout le monde en parle dites-vous ! vous me surprenez toujours davantage. Dites-moi, je vous en prie, par qui vous en avez été informé.
— Par plusieurs personnes. Il y en a que vous ne connaissez pas, d’autres avec qui vous êtes très-liée, comme par exemple madame Jennings, les Palmer, les Middleton. Malgré cela, je ne l’aurais pas cru, parce qu’on cherche toujours à douter de ce que l’on craint, mais l’autre matin en entrant ici, je vis accidentellement une lettre entre les mains du domestique, qui ne cherchait pas à la cacher. Elle était adressée à M. Willoughby et de l’écriture de votre sœur. Je vous ai demandé si elle se mariait, mais j’en étais déjà convaincu. Est-ce que tout est conclu définitivement ? ne me reste-t-il aucun espoir ? Mais non, lors même qu’il y aurait des obstacles insurmontables, je n’ai aucun droit, aucune chance de jamais succéder… De grâce excusez-moi, bonne Elinor ; j’en dis trop sans doute et j’ai grand tort, mais je sais à peine ce que je dis et je me confie entièrement en votre prudence. Dites-moi que tout est arrangé quoiqu’il faille encore garder le secret quelque temps, Ah ! combien j’ai besoin d’être sûr que mon malheur soit décidé, de ne plus rester en suspens, et d’employer toutes les forces de mon ame à me guérir d’un sentiment inutile et coupable !
Ces paroles incohérentes, cet aveu positif de son amour pour Maria, affectèrent beaucoup Elinor, au point même de l’empêcher de parler ; et, quand elle se sentit un peu remise, il succéda à ce trouble un extrême embarras de répondre convenablement. L’état réel des choses entre sa sœur et M. Willoughby lui était trop peu connu pour qu’elle ne craignit pas de la compromettre en disant trop ou trop peu. Cependant, comme elle était convaincue de l’affection de sa sœur pour Willoughby, qui ne laissait aucun espoir au colonel quelque fût l’événement, étant bien aise d’ailleurs d’épargner à Maria le blâme auquel elle donnait lieu si souvent, elle jugea plus prudent d’en avouer davantage qu’elle n’en croyait elle-même : elle lui dit donc que quoi qu’elle n’eût jamais été informée par eux-mêmes des termes où ils en étaient, elle n’avait aucun doute de leur affection mutuelle, et qu’elle n’était pas surprise d’apprendre leur correspondance.
Le colonel l’écouta avec une silencieuse attention, et, quand elle eut cessé de parler, il se leva et dit avec une voix émue : Je souhaite à votre sœur tous les bonheurs imaginables. Puisse-t-elle, puisse Willoughby mériter la félicité qui leur est destinée ! Il la salua de la main, leva les yeux au ciel avec l’expression la plus douloureuse, et partit.
Elinor resta triste et pensive. Cet entretien loin de lui avoir apporté quelque consolation, laissait un poids sur son cœur. Ses espérances du mariage de sa sœur s’étaient, il est vrai, renouvelées ; mais serait-elle heureuse ? Les vœux du colonel avaient quelque chose de sombre ; il semblait en douter. Le malheur de cet homme intéressant l’affligeait aussi. Elle déplorait la fatalité qui l’avait entraîné dans un amour sans espoir ; et cette conformité dans leur situation redoublait encore l’intérêt qu’il lui inspirait. Pauvre Brandon ! s’écriait-elle ; et son cœur oppressé disait ainsi : Pauvre Elinor ! Elle ne savait plus ce qu’elle devait désirer, et, sur quelque objet qu’elle arrêtât sa pensée, c’était avec un sentiment douloureux.
Table des matières
Trois ou quatre jours s’écoulèrent sans qu’Elinor eût à regretter d’avoir averti sa mère. Willoughby ne vint, ni n’écrivit. L’inquiétude de Maria se calma peu-à-peu, et fut remplacée par un abattement, un découragement complets. Elle restait, des heures entières assise à la même place, presque sans mouvement, ne faisant plus nulle attention aux coups de marteau ni à ceux qui entraient, ni à ce qu’on disait autour d’elle ; elle aurait oublié de manger, de s’habiller, de se coucher, de se lever, si Elinor n’y avait pas pensé pour elle, et ne l’eût pas avertie absolument de tout ce qu’il fallait faire ; alors sans dire oui ou non, elle faisait machinalement ce que lui disait sa sœur ; elle sortait ou restait avec une égale indifférence, et sans avoir jamais une expression de plaisir ou d’espoir. Sur la fin de la semaine, elles étaient engagées dans une grande assemblée où lady Middleton devait les conduire. Madame Palmer très-avancée dans sa grossesse était indisposée ; et sa mère restait auprès d’elle ; elle avait prié ses jeunes amies de ne pas manquer à cet engagement. Elinor désirait aussi faire sortir Maria de son apathie ; et cette réunion chez une femme très-riche et très à la mode, devait être fort belle. Comme à l’ordinaire la triste Maria ne se mit en peine de rien, se laissa parer par sa sœur, sans même se regarder au miroir, s’assit dans le salon jusqu’au moment de l’arrivée de lady Middleton, penchée sur sa main sans ouvrir la bouche, perdue dans ses pensées, et sans paraître s’apercevoir de la présence d’Elinor ; quand on l’avertit que lady Middleton les attendait dans sa voiture, elle tressaillit, comme si elle n’eût attendu personne.
Après avoir eu assez de peine à s’approcher de la maison où se tenait l’assemblée, à cause de la foule des équipages qui obstruaient la rue, elles firent leur introduction dans un salon splendide, très-illuminé, et si rempli de monde, qu’on pouvait à peine respirer, et que la chaleur était insupportable. Lady Middleton les amena auprès de la dame qui les avait invitées. Elles la saluèrent, et il leur fut permis de se mêler dans la foule et de prendre leur part de la presse et de la chaleur, que leur arrivée augmentait encore. Après quelques momens employés à se promener avec grand peine d’un coin du salon à l’autre, lady Middleton arrangea une partie de cassino qui était son jeu favori. Mesdemoiselles Dashwood préférèrent ne pas jouer, et s’assirent à peu de distance de la table de jeu. Maria retomba dans ses sombres rêveries ; Elinor s’amusait à regarder cette quantité d’individus qui se rassemblaient avec l’espoir du plaisir, et qui plus ou moins avaient tous l’air ennuyé et fatigué. En promenant ses regards de côté et d’autre, ils tombèrent sur un objet qui lui donna une forte émotion… c’était Willoughby debout devant une jeune personne mise dans toute la recherche de la mode, et avec qui il tenait une conversation très-animée. Dans un mouvement ses yeux rencontrèrent ceux d’Elinor ; il la salua, mais sans faire un pas pour se rapprocher d’elle et de Maria, qu’il voyait aussi très-bien ; il continua à parler à la jeune dame. Involontairement Elinor se tourna vers sa sœur pour la prévenir, si elle ne l’avait pas encore vu, de peur qu’elle ne se donnât en spectacle ; mais c’était trop tard, elle venait de l’apercevoir. Toute sa physionomie exprimait un bonheur qui tenait presque du délire. — c’est lui ! s’écria-t-elle en se levant pour courir à lui, si sa sœur ne l’avait pas retenue. Bon Dieu ! il est là ; dit-elle à Elinor, il est là ; oh ! s’il pouvait me voir ! Pourquoi ne me regarde-t-il pas ? Pourquoi m’empêchez-vous d’aller lui parler ? Oh ! laissez moi aller.
Читать дальше