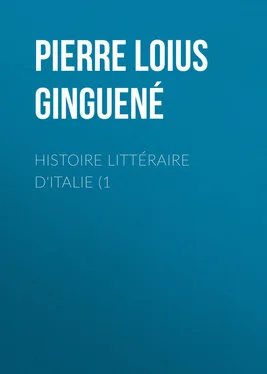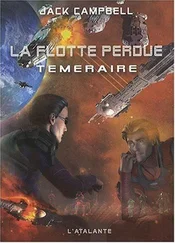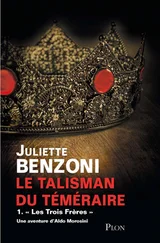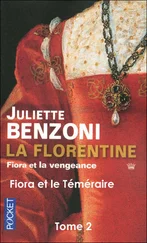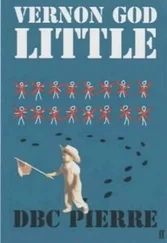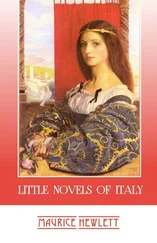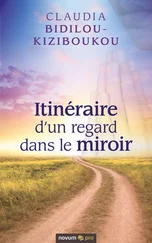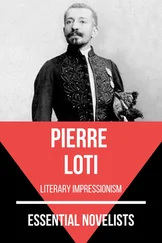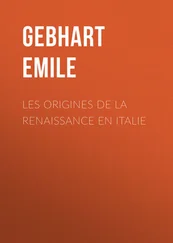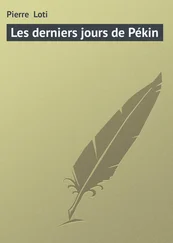L'empereur Henri III se ressaisit du droit d'intervenir dans la nomination des papes, qu'avaient eu les empereurs Grecs et les Carlovingiens. Il présenta Clément II à l'élection du peuple, et ensuite élut de son autorité Damase II, Léon IX et Victor II; ce dernier en 1055. Après sa mort, le peuple et l'église nommèrent, en 1057, Etienne X; et ce fut sous son successeur, Nicolas II, que le concile de Latran attribua, pour l'avenir, l'élection des papes aux cardinaux. Vinrent ensuite le pontificat de Grégoire VII, la donation de la comtesse Mathilde, les démêlés trop fameux de ce pape avec l'empereur Henri IV, etc.; époque de la puissance temporelle des papes, et de l'avilissement des empereurs et des rois.
Ceux qui avaient fondé le duché de Bénévent.
En 1073.
La mère de Mathilde, femme du marquis Boniface, comte ou duc de Toscane, et sœur de l'empereur Henri III, souleva contre son frère toutes les parties de l'Italie où s'étendait son pouvoir, et qui formaient l'héritage de sa fille, c'est-à-dire, la Toscane, les états de Mantoue, de Modène, de Parme, de Ferrare, de Vérone, une partie de l'Ombrie, de la Marche d'Ancône, et presque tout ce qui a été nommé depuis le patrimoine de S. Pierre. Ayant fait imprudemment un voyage à la cour de l'empereur, elle fut arrêtée, et resta long-temps prisonnière; elle laissa, en mourant, à sa fille Mathilde, ses ressentiments avec tous ses biens.
Essai sur les Mœurs et sur l'Esprit des Nations , ch. 46.
On sait la manière dont ce pape, enfermé dans la forteresse de Canosse, avec la comtesse Mathilde, y reçut l'espèce d'amende honorable que vint lui faire l'empereur. Voyez, sur cette scène déshonorante pour l'Empire, tous les historiens; et cherchez dans tous les livres qui peuvent faire autorité en matière de religion, quelque chose qui la justifie.
Dans la collection des conciles du P. Labbe, t. X.
Depuis que ceci est écrit, il a paru un jugement plein d'équité sur ces lettres, sur le caractère, les plans et la conduite de leur auteur, dans l'excellent ouvrage de M. le professeur Heeren, traduit de l'allemand en français, par M. Charles Villers, et qui a partagé, en 1808, le prix proposé par la classe d'histoire et de littérature ancienne de l'Institut de France, sur la belle question de l'influence des croisades . Voyez cet ouvrage, p. 73-90.
En 1078.
Concil. collect. Harduin . t. VI, part. I, p. 1580, cité par Tiraboschi, t. III. p. 218.
Bettinelli, Risorgim. d'Ital. , c. 2.
Muratori, Antichità Ital. , Dissert. 43; Andrès, Orig. Progr. e stat. att. d'ogni Lett. , c. 7; Bettinelli, Risorg. d'Ital. , c. 2.
Muratori, loc. cit.
Muratori, loc. cit.
De re Diplomaticâ , cité par Bettin., Risorg. d'Ital. , c. 2.
Voy. Montfaucon, Palœogr. Grœca , l. I, c. 2; le même, tome IX de l'Acad. des Inscr., Dissertation sur le papier ; Maffei, Histor. Diplomatica , p. 77; Muratori, Antich. d'Ital. , Dissert. 43. Il est vrai que Tiraboschi recule jusqu'au quatorzième siècle, l'invention du pap. de lin; t, V, l. I, c. 4, p. 76.
Dans la personne d'Othon III, mort en Italie, à la fleur de son âge, en 1002.
À Pavie, cette même année.
Bettinelli, Risorg. d'Ital. , c. 2, dit expressément: Sicche un italiano poté sembrare, ad ei mostrò voler esser lo, un ristorator della patria .
Bruker, Hist. Art. Phil. , t. III, l. II, c. 2.
Bettinelli, loc. cit. Ce jurisconsulte est le fameux Irnerius ou Garnier. Voy. le chapitre suivant.
Ses œuvres ont été en partie publiées à Bâle, en 1536, et sont en partie restées inédites. (Voy. Oudin, de Script. Eccl. , t. II, p. 694, etc.) Constantin l'Africain florissait vers l'an 1060.
Gibbon, Fall. of Rom. Emp. , c. 53.
Léon VI, fils et successeur de Basile.
En 946.
Liutprandi Ticinensis Historia . Elle s'étend jusqu'à l'avénement de Bérenger II, vers le milieu du dixième siècle.
Legatio Liutprandi ad Constantin. Porphyr.
En 968.
Legatio Liutprandi ad Nicephorum Phocam. Il paraît qu'il mourut peu d'années après son retour de cette seconde légation (Voy. Tirab., t. III, p. 200).
On prononce Kiliades .
Tiraboschi, t. III, p. 227 et suiv.
Launoi, de Scholis celebribus , ch. 42.
En 1078.
Tiraboschi, ub. supr. , p. 230 et suiv.
En 1092.
En 1098.
En 1109.