Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)
Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)
- Автор:
- Издательство:Иностранный паблик
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F): краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F) — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Bien que la sculpture de Worms date du milieu du XIIIe siècle, elle nous donne, en statuaire d'un beau style, un fragment de cette scène si complétement tracée au XIIe par Herrade de Landsberg, c'est-à-dire l'Église recueillant le sang du Sauveur assise sur les quatre évangiles. La femme portée par l'âne buttant personnifie la Synagogue: c'était traiter l'Ancien Testament avec quelque dureté.
Souvent, dans nos vitraux français, on voit de même un Christ en croix avec l'Église et la Synagogue à ses côtés, mais représentées sans leurs montures, l'Église recueillant le sang du Sauveur dans un calice, et la Synagogue voilée, se détournant comme les statues de Bamberg et de Strasbourg, ou tenant un jeune bouc qu'elle égorge. Villard de Honnecourt paraît, dans la vignette 57e de son manuscrit, avoir copié une de ces figures de l'Église sur un vitrail ou peut-être sur une peinture de son temps.
ÉGLISE, s. f. Lieu de réunion des fidèles. Pendant le moyen âge, on a divisé les églises en églises cathédrales , abbatiales , conventuelles , collégiales et paroissiales .
Les églises paroissiales se trouvaient sous la juridiction épiscopale ou sous celle des abbés; aussi c'était à qui, des évêques et des abbés, auraient à gouverner un nombre de paroisses plus considérable; de là une des premières causes du nombre prodigieux d'églises paroissiales élevées dans les villes et les bourgades pendant les XIIe et XIIIe siècles, c'est-à-dire à l'époque de la lutte entamée entre le pouvoir monastique et le pouvoir épiscopal. D'ailleurs, la division, l'antagonisme existent dans toutes les institutions religieuses ou politiques du moyen âge; chacun, dans l'ordre civil comme dans l'ordre spirituel, veut avoir une part distincte. Les grandes abbayes, dès le XIe siècle, cherchèrent à mettre de l'unité au milieu de ce morcellement général; mais il devint bientôt évident que l'institut monastique établissait cette unité à son propre avantage; l'épiscopat le reconnut assez tôt pour profiter du développement municipal du XIIe siècle et ramener les populations vers lui, soit en bâtissant d'immenses cathédrales, soit en faisant reconstruire, surtout dans les villes, les églises paroissiales sur de plus grandes proportions. Si nous parcourons, en effet, les villes de la France, au nord de la Loire, nous voyons que, non-seulement toutes les cathédrales, mais aussi les églises paroissiales, sont rebâties pendant la période comprise entre 1150 et 1250. Ce mouvement, provoqué par l'épiscopat, encouragé par la noblesse séculière, qui voyait dans les abbés des seigneurs féodaux trop puissants, fut suivi avec ardeur par les populations urbaines, chez lesquelles l'église était alors un signe d'indépendance et d'unité. Aussi, du XIIe au XIIIe siècle, l'argent affluait pour bâtir ces grandes cathédrales et les paroisses qui se groupaient autour d'elles.
Les églises abbatiales des clunisiens avaient fait école, c'est-à-dire que les paroisses qui en dépendaient imitaient, autant que possible, et dans des proportions plus modestes, ces monuments types. Il en fut de même pour les cathédrales lorsqu'on les rebâtit à la fin du XIIe siècle et au commencement du XIIIe; elles servirent de modèles pour les paroisses qui s'élevaient dans le diocèse. Il ne faudrait pas croire cependant que ces petits monuments fussent des réductions des grands; l'imitation se bornait sagement à adopter les méthodes de construire, les dispositions de détail, l'ornementation et certains caractères iconographiques des vastes églises abbatiales ou des cathédrales.
Vers le Ve siècle, lorsque le nouveau culte put s'exercer publiquement, deux principes eurent une action marquée dans la construction des églises en Occident: la tradition des basiliques antiques qui, parmi les monuments païens, servirent les premiers de lieu de réunion pour les fidèles; puis le souvenir des sanctuaires vénérables creusés sous terre, des cryptes qui avaient renfermé les restes des martyrs, et dans lesquelles les saints mystères avaient été pratiqués pendant les jours de persécution. Rien ne ressemble moins à une crypte qu'une basilique romaine; cependant la basilique romaine possède, à son extrémité opposée à l'entrée, un hémicycle voûté en cul-de-four, le tribunal. C'est là que, dans les premières églises chrétiennes, on établit le siége de l'évêque ou du ministre ecclésiastique qui le remplaçait; autour de lui se rangeaient les clercs; l'autel était placé en avant, à l'entrée de l'hémicycle relevé de plusieurs marches. Les fidèles se tenaient dans les nefs, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Habituellement nos premières églises françaises possèdent, sous l'hémicycle, l'abside, une crypte dans laquelle était déposé un corps saint, et quelquefois le fond de l'église lui-même rappelle les dispositions de ces constructions souterraines, bien que la nef conserve la physionomie de la basilique antique. Ces deux genres de constructions si opposés laissent longtemps des traces dans nos églises, et les sanctuaires sont voûtés, élevés suivant la méthode concrète des édifices romains bâtis en briques et blocages, que les nefs ne consistent qu'en des murs légers reposant sur des rangs de piles avec une couverture en charpente comme les basiliques antiques.
Nous ne possédons sur les églises primitives du sol de la France que des données très-vagues, et ce n'est guère qu'à dater du Xe siècle que nous pouvons nous faire une idée passablement exacte de ce qu'étaient ces édifices; encore, à cette époque, présentaient-ils des variétés suivant les provinces au milieu desquelles on les élevait. Les églises primitives de l'Île-de-France ne ressemblent pas à celles de l'Auvergne; celles-ci ne rappellent en rien les églises de la Champagne, ou de la Normandie, ou du Poitou. Les monuments religieux du Languedoc diffèrent essentiellement de ceux élevés en Bourgogne. Chaque province, pendant la période romane, possédait son école, issue de traditions diverses. Partout l'influence latine se fait jour d'abord; elle s'altère plus ou moins, suivant que ces provinces se mettent en rapport avec des centres actifs de civilisation voisins ou trouvent dans leur propre sein des ferments nouveaux. L'Auvergne, par exemple, qui, depuis des siècles, passe pour une des provinces de France les plus arriérées, possédait, au XIe siècle, un art très-avancé, très-complet, qui lui permit d'élever des églises belles et solides, encore debout aujourd'hui. La Champagne, de toutes les provinces françaises, la Provence exceptée, est celle qui garda le plus longtemps les traditions latines, peut-être parce que son territoire renfermait encore, dans les premiers siècles du moyen âge, un grand nombre d'édifices romains. Il en est de même du Soissonnais. En Occident, près des rivages de l'Océan, nous trouvons, au contraire, dès le Xe siècle, une influence byzantine marquée dans la construction des édifices religieux. Cette influence byzantine se fait jour à l'Est le long des rives du Rhin, mais elle prend une autre allure. Ayant maintes fois, dans ce Dictionnaire , l'occasion de nous occuper des églises et des diverses parties qui entrent dans leur construction (voy. ABSIDE, ARCHITECTURE RELIGIEUSE, CATHÉDRALE, CHAPELLE, CHOEUR, CLOCHER, CONSTRUCTION, NEF, TRAVÉE), nous nous bornerons à signaler ici les caractères généraux qui peuvent aider à classer les églises par écoles et par époques.
ÉCOLE FRANÇAISE. L'une des plus anciennes églises de l'école française, proprement dite, est la Basse-OEuvre de Beauvais, dont la nef appartient au VIIIe ou IXe siècle. Cette nef est celle d'une basilique romaine avec ses collatéraux. Elle se compose de deux murs percés de fenêtres terminées en plein cintre, de deux rangs de piliers à section carrée portant des archivoltes plein cintre et les murs supérieurs percés également de fenêtres. Cette construction si simple était couverte par une charpente apparente. L'abside, détruite aujourd'hui, se composait probablement d'un hémicycle couvert en cul-de-four; existait-il un transsept? c'est ce que nous ne saurions dire. Quant à la façade reconstruite au XIe siècle, elle était vraisemblablement précédée, dans l'origine, d'un portique ou d'un narthex, suivant l'usage de l'église primitive. La construction de cet édifice est encore toute romaine, avec parements de petits moellons à faces carrées et cordons de brique. Nulle apparence de décoration, si ce n'est sur la façade élevée postérieurement. Il faut voir là l'église franco-latine dans sa simplicité grossière. Les murs, à l'intérieur, devaient être décorés de peintures, puisque les auteurs qui s'occupent des monuments religieux mérovingiens et carlovingiens, Grégoire de Tours en tête, parlent sans cesse des peintures qui tapissaient les églises de leur temps. Les fenêtres devaient être fermées de treillis de pierre ou de bois dans lesquels s'enchâssaient des morceaux de verre ou de gypse (voy. FENÊTRE). L'ancien Beauvoisis conserve encore d'autres églises à peu près contemporaines de la Basse-OEuvre, mais plus petites, sans collatéraux, et ne se composant que d'une salle quadrangulaire avec abside carrée ou semi-circulaire. Ce sont de véritables granges. Telles sont les églises d'Abbecourt, d'Auviller, de Bailleval, de Bresles 63 63 Voy. les Monuments de l'ancien Beauvoisis , par M. E. Woillez. Paris, 1839-1849.
. Ces églises n'étaient point voûtées, mais couvertes par des charpentes apparentes. Nous voyons cette tradition persister jusque vers le commencement du XIIe siècle. Les nefs continuent à être lambrissées; les sanctuaires seuls, carrés généralement, sont petits et voûtés. Les transsepts apparaissent rarement; mais, quand ils existent, ils sont très-prononcés, débordant les nefs de toute leur largeur. L'église de Montmille 64 64 Prieuré de Montmille, église de Saint-Maxien, XIe siècle.
est une des plus caractérisées parmi ces dernières. La nef avec ses collatéraux était lambrissée ainsi que le transsept. Quatre arcs doubleaux, sur la croisée, portaient une tour très-probablement; le choeur seul est voûté.
Интервал:
Закладка:
Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.
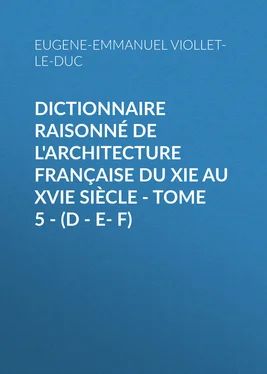
![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)










