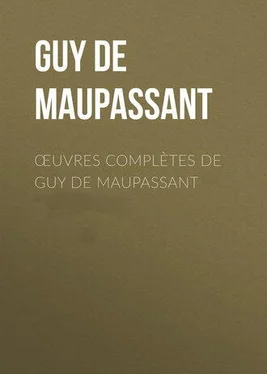Et il entendit ses petits sabots découverts battre le sapin de l’escalier ; et, quand elle fut arrivée aux dernières marches, il la prit par le bras, et dès qu’elle eut laissé devant la porte ses étroites chaussures de bois à côté des grosses galoches du maître, il la poussa dans sa chambre en grognant :
— Plus vite que ça, donc, nom de D… !
Et elle répétait sans cesse, ne sachant plus ce qu’elle disait :
— Me v’là, me v’là, not’ maître.
Six mois après, comme elle allait voir ses parents, un dimanche, son père l’examina curieusement, puis demanda :
— T’es-ti point grosse ?
Elle restait stupide, regardant son ventre, répétant : Mais non, je n’ crois point.
Alors, il l’interrogea, voulant tout savoir :
— Dis-mé si vous n’avez point, quéque soir, mêlé vos sabots ?
— Oui, je les ons mêlés l’premier soir et puis l’sautres.
— Mais alors t’es pleine, grande futaille.
Elle se mit à sangloter, balbutiant : — J’savais ti, mé ? J’savais ti, mé ?
Le père Malandain la guettait, l’œil éveillé, la mine satisfaite.
Il demanda :
— Quéque tu ne savait point ?
Elle prononça, à travers ses pleurs : — J’savais ti, mé, que ça se faisait comme ça, d’s’éfants !
Sa mère rentrait. L’homme articula, sans colère : — La v’là grosse, à c’t’heure.
Mais la femme se fâcha, révoltée d’instinct, injuriant à pleine gueule sa fille en larmes, la traitant de« manante » et de« traînée ».
Alors le vieux la fit taire. Et comme il prenait sa casquette pour aller causer de leurs affaires avec maît’ Césaire Omont, il déclara :
« All’ est tout d’même encore pu sotte que j’aurais cru. All’ n’savait point c’q’all’ faisait, c’te niente ».
Au prône du dimanche suivant, le vieux curé publiait les bans de M. Onufre-Césaire Omont avec Céleste-Adélaïde Malandain.
21 janvier 1883
C’était la fin du dîner d’ouverture de chasse chez le marquis de Bertrans. Onze chasseurs, huit jeunes femmes et le médecin du pays étaient assis autour de la grande table illuminée, couverte de fruits et de fleurs.
On vint à parler d’amour, et une grande discussion s’éleva, l’éternelle discussion, pour savoir si on pouvait aimer vraiment une fois ou plusieurs fois. On cita des exemples de gens n’ayant jamais eu qu’un amour sérieux ; on cita aussi d’autres exemples de gens ayant aimé souvent, avec violence. Les hommes, en général, prétendaient que la passion, comme les maladies, peut frapper plusieurs fois le même être, et le frapper à le tuer si quelque obstacle se dresse devant lui. Bien que cette manière de voir ne fût pas contestable, les femmes, dont l’opinion s’appuyait sur la poésie bien plus que sur l’observation, affirmaient que l’amour, l’amour vrai, le grand amour, ne pouvait tomber qu’une seule fois sur un mortel, qu’il était semblable à la foudre, cet amour, et qu’un cœur touché par lui demeurait ensuite tellement vidé, ravagé, incendié, qu’aucun autre sentiment puissant, même aucun rêve, n’y pouvait germer de nouveau.
Le marquis, ayant aimé beaucoup, combattait vivement cette croyance :
— Je vous dis, moi, qu’on peut aimer plusieurs fois avec toutes ses forces et toute son âme. Vous me citez des gens qui se sont tués par amour, comme preuve de l’impossibilité d’une seconde passion. Je vous répondrai que, s’ils n’avaient pas commis cette bêtise de se suicider, ce qui leur enlevait toute chance de rechute, ils se seraient guéris ; et ils auraient recommencé, et toujours, jusqu’à leur mort naturelle. Il en est des amoureux comme des ivrognes. Qui a bu boira – qui a aimé aimera. C’est une affaire de tempérament, cela.
On prit pour arbitre le docteur, vieux médecin parisien retiré aux champs, et on le pria de donner son avis.
Justement il n’en avait pas :
— Comme l’a dit le marquis, c’est une affaire de tempérament ; quant à moi, j’ai eu connaissance d’une passion qui dura cinquante-cinq ans sans un jour de répit, et qui ne se termina que par la mort.
La marquise battit des mains.
— Est-ce beau cela ! Et quel rêve d’être aimé ainsi ! Quel bonheur de vivre cinquante-cinq ans tout enveloppé de cette affection acharnée et pénétrante ! Comme il a dû être heureux et bénir la vie celui qu’on adora de la sorte !
Le médecin sourit :
— En effet, Madame, vous ne vous trompez pas sur ce point, que l’être aimé fut un homme. Vous le connaissez, c’est M. Chouquet, le pharmacien du bourg. Quant à elle, la femme, vous l’avez connue aussi, c’est la vieille rempailleuse de chaises qui venait tous les ans au château. Mais je vais me faire mieux comprendre.
L’enthousiasme des femmes était tombé ; et leur visage dégoûté disait : « Pouah ! », comme si l’amour n’eût dû frapper que des êtres fins et distingués, seuls dignes de l’intérêt des gens comme il faut.
Le médecin reprit :
— J’ai été appelé, il y a trois mois, auprès de cette vieille femme, à son lit de mort. Elle était arrivée, la veille, dans la voiture qui lui servait de maison, traînée par la rosse que vous avez vue, et accompagnée de ses deux grands chiens noirs, ses amis et ses gardiens. Le curé était déjà là. Elle nous fit ses exécuteurs testamentaires, et, pour nous dévoiler le sens de ses volontés dernières, elle nous raconta toute sa vie. Je ne sais rien de plus singulier et de plus poignant.
« Son père était rempailleur et sa mère rempailleuse. Elle n’a jamais eu de logis planté en terre.
« Toute petite, elle errait, haillonneuse, vermineuse, sordide. On s’arrêtait à l’entrée des villages, le long des fossés ; on dételait la voiture ; le cheval broutait ; le chien dormait, le museau sur ses pattes ; et la petite se roulait dans l’herbe pendant que le père et la mère rafistolaient, à l’ombre des ormes du chemin, tous les vieux sièges de la commune. On ne parlait guère dans cette demeure ambulante. Après les quelques mots nécessaires pour décider qui ferait le tour des maisons en poussant le cri bien connu : “Remmmpailleur de chaises !”, on se mettait à tortiller la paille, face à face ou côte à côte. Quand l’enfant allait trop loin ou tentait d’entrer en relations avec quelque galopin du village, la voix colère du père la rappelait : “Veux-tu bien revenir ici, crapule !”. C’étaient les seuls mots de tendresse qu’elle entendait.
« Quand elle devint plus grande, on l’envoya faire la récolte des fonds de sièges avariés. Alors elle ébaucha quelques connaissances de place en place avec les gamins ; mais c’étaient, cette fois, les parents de ses nouveaux amis qui rappelaient brutalement leurs enfants : “Veux-tu bien venir ici, polisson ! Que je te voie causer avec les va-nu-pieds !…”.
« Souvent les petits gars lui jetaient des pierres.
« Des dames lui ayant donné quelques sous, elle les garda soigneusement.
« Un jour – elle avait alors onze ans – comme elle passait par ce pays, elle rencontra derrière le cimetière le petit Chouquet qui pleurait parce qu’un camarade lui avait volé deux liards. Ces larmes d’un petit bourgeois, d’un de ces petits qu’elle s’imaginait dans sa frêle caboche de déshéritée, être toujours contents et joyeux, la bouleversèrent. Elle s’approcha, et, quand elle connut la raison de sa peine, elle versa entre ses mains toutes ses économies, sept sous, qu’il prit naturellement, en essuyant ses larmes. Alors, folle de joie, elle eut l’audace de l’embrasser. Comme il considérait attentivement sa monnaie, il se laissa faire. Ne se voyant ni repoussée, ni battue, elle recommença ; elle l’embrassa à pleins bras, à plein cœur. Puis elle se sauva.
Читать дальше