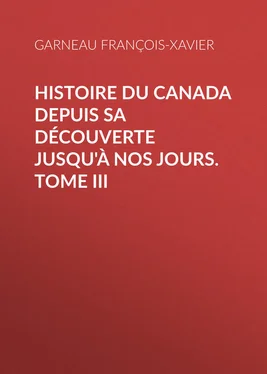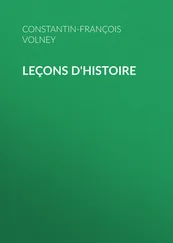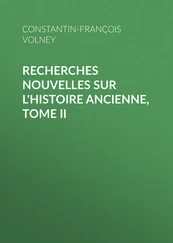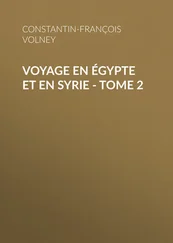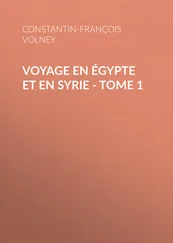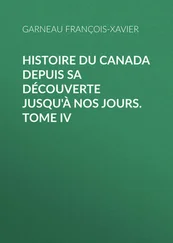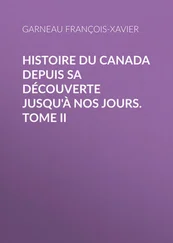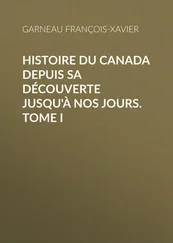François-Xavier Garneau - Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu'à nos jours. Tome III
Здесь есть возможность читать онлайн «François-Xavier Garneau - Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu'à nos jours. Tome III» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: История, foreign_antique, foreign_prose, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu'à nos jours. Tome III
- Автор:
- Издательство:Иностранный паблик
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu'à nos jours. Tome III: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu'à nos jours. Tome III»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu'à nos jours. Tome III — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu'à nos jours. Tome III», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Après cette conquête, les vainqueurs envoyèrent trois bâtimens de guerre dans la rivière St. Jean pour attaquer le fort que les Français y avaient élevé, et qui était commandé par M. de Boishébert. Ce dernier, n'ayant pas assez de monde pour le défendre, y mit le feu avant l'arrivée des assaillans et se retira. Mais, ayant été informé de ce qui se passait à Beauséjour, au lieu de retraiter sur Québec, il s'avança au secours des Acadiens dans le fond de la baie de Fondy, et leur ayant donné des armes, il battit avec eux les Anglais dans plusieurs rencontres. Ces avantages ne purent empêcher cependant qu'à la fin ces derniers ne brûlassent tous les établissemens, et ne contraignissent les habitans à se réfugier dans les bois, et ensuite à émigrer au Cap-Breton, à l'île St. Jean, à Miramichi, à la baie des Chaleurs et à Québec, où ces malheureux portaient partout le spectacle d'un dévoûment sans bornes et d'une misère profonde.
Tel fut le succès des ennemis dans la première partie de leur plan de campagne. Quoiqu'il fut, sous le rapport militaire, plus nominal que réel, puisqu'ils ne purent pas avancer plus loin de ce côté, où des bandes armées les continrent, la nouvelle cependant en causa un grand mécontentement à la cour de France, surtout lorsqu'on y apprit les terribles conséquences que les pertes que l'on venait de faire avaient eues pour les infortunés Acadiens. Le roi écrivit lui-même à M. de Vaudreuil de faire juger rigoureusement, par un conseil de guerre qu'il présiderait en personne, Vergor et de Villeray, ainsi que les garnisons qui servaient sous leurs ordres. Le procès eut lieu l'année suivante au château St. – Louis, et tous les accusés furent acquittés à l'unanimité. 2L'évacuation de l'Acadie laissa à la merci des Anglais les habitans de cette province, qui portaient le nom de Neutres, et qui n'avaient pu se résoudre à abandonner leur terre natale.
Note 2: (retour)La lettre du roi est du 20 février 1756. Les pièces du procès sont déposées à la bibliothèque de la Société littéraire et historique de Québec. «On eut, dit Montcalm, principalement égard pour le fort de Beauséjour à ce que les Acadiens avaient forcé le commandant à capituler pour sauver leur vie; ils avaient prêté autrefois serment de fidélité aux Anglais qui les menaçaient de les faire pendre. Quant au fort de Gaspareaux, une grande enceinte avec des pieux debout où il n'y avait qu'un officier et 19 soldats, ne pouvait être considérée comme un fort propre à soutenir un siège.» - Lettre au ministre , 1757.
Ce qui nous reste à raconter de ce peuple intéressant, rappelle un de ces drames douloureux dont les exemples sont rares même aux époques barbares de l'histoire, alors que les lois de la justice et de l'humanité sont encore à naître avec les lumières de la civilisation.
Sur 15 à 16 mille Acadiens qu'il y avait dans la péninsule au commencement de leur émigration, il n'en restait qu'environ 7,000 des plus riches, dont les moeurs douces ont fourni à Raynal un tableau si touchant et si vrai.
«Peuple simple et bon, dit-il, qui n'aimait pas le sang, l'agriculture était son occupation. On l'avait établi dans des terres basses, en repoussant à force, de digues la mer et les rivières dont ces plaines étaient couvertes. Ces marais desséchés donnaient du froment, du seigle, de l'orge, de l'avoine et du maïs. On y voyait encore une grande abondance de pommes de terre dont l'usage était devenu commun.
«D'immenses prairies étaient couvertes de troupeaux nombreux; on y compta jusqu'à soixante mille bêtes à cornes. La plupart des familles avaient plusieurs chevaux, quoique le labourage se fît avec des boeufs. Les habitations, presque toutes construites de bois, étaient fort commodes et meublées avec la propreté qu'on trouve quelquefois chez nos laboureurs d'Europe les plus aisés. On y élevait une grande quantité de volailles de toutes les espèces. Elles servaient à varier la nourriture des colons, qui était généralement saine et abondante. Le cidre et la bière formaient leur boisson. Ils y ajoutaient quelquefois de l'eau-de-vie de sucre.
«C'était leur lin, leur chanvre, la toison de leurs brebis, qui servaient à leur habillement ordinaire. Ils en fabriquaient des toiles communes, des draps grossiers. Si quelqu'un d'entre eux avait un peu de penchant pour le luxe, il le tirait d'Annapolis ou de Louisbourg. Ces deux villes recevaient en retour du blé, des bestiaux, des pelleteries.
«Les Français neutres n'avaient pas autre chose à donner à leurs voisins. Les échanges qu'ils faisaient entre eux étaient encore moins considérables, parce que chaque famille avait l'habitude et la facilité de pourvoir seule à tous ses besoins. Aussi ne connaissaient-ils pas l'usage du papier-monnaie, si répandu dans l'Amérique, septentrionale. Le peu d'argent qui s'était comme glissé dans cette colonie n'y donnait point l'activité qui en fait le véritable prix.
«Leurs coeurs étaient extrêmement simples. Il n'y eut jamais de cause civile ou criminelle assez importante pour être portée à la cour de justice établie à Annapolis. Les petits différends qui pouvaient s'élever de loin en loin entre les colons étaient toujours terminés à l'amiable par les anciens. C'étaient les pasteurs religieux qui dressaient tous les actes, qui recevaient tous les testamens. Pour ces fonctions profanes, pour celles de l'Eglise, on leur donnait volontairement la vingt-septième partie des récoltes. Elles étaient assez abondantes pour laisser plus de faculté que d'exercice à la générosité. On ne connaissait pas la misère, et la bienfaisance prévenait la mendicité. Les malheurs étaient pour ainsi dire réparés avant d'être sentis. Les secours étaient offerts sans ostentation d'une part; ils étaient acceptés sans humiliation de l'autre. C'était une société de frères, également prêts à donner ou à recevoir ce qu'ils croyaient commun à tous les hommes.
«Cette précieuse harmonie écartait jusqu'à ces liaisons de galanterie qui troublent si souvent la paix des familles. On ne vit jamais dans cette société de commerce illicite entre les deux sexes. C'est que personne n'y languissait dans le célibat. Dès qu'un jeune homme avait atteint l'âge convenable au mariage, on lui bâtissait une maison, on défrichait, on ensemençait des terres autour de sa demeure; on y mettait les vivres dont il avait besoin pour une année. Il y recevait la compagne qu'il avait choisie, et qui lui apportait en dot des troupeaux. Cette nouvelle famille croissait et prospérait à l'exemple des autres… Qui est-ce qui ne sera pas touché de l'innocence des moeurs et de la tranquillité de cette heureuse peuplade? continue l'éloquent écrivain. Qui est-ce qui ne fera pas des voeux pour la durée de son bonheur?»
Vains souhaits! La guerre de 1744 commença les infortunes de ce peuple; celle de Sept ans consomma sa ruine totale. Depuis quelque temps les agens de l'Angleterre agissaient avec la plus grande rigueur; les tribunaux, par des violations flagrantes de la loi, par des dénis systématiques de justice, étaient devenus pour les pauvres habitans un objet à la fois de terreur et de haine. Le moindre employé voulait que sa volonté fût la loi. «Si vous ne fournissez pas de bois à mes troupes, disait un capitaine Murray, je démolirai vos maisons pour en faire du feu. Si vous ne voulez pas prêter le serment de fidélité, ajoutait le gouverneur Hopson, je vais faire pointer mes canons sur vos villages» Rien ne pouvait engager ces hommes honorables à faire un acte qui répugnait à leur conscience, et que, dans l'opinion de bien des gens, l'Angleterre n'avait pas même le droit d'exiger. «Les Acadiens, observe M. Haliburton, n'étaient pas des sujets britanniques, puisqu'ils n'avaient point prêté le serment de fidélité, et ils ne pouvaient être conséquemment regardés comme des rebelles; ils ne devaient pas être non plus considérés comme prisonniers de guerre, ni envoyés en France, puisque depuis près d'un demi siècle on leur laissait leurs possessions à à la simple condition de demeurer neutres.» Mais beaucoup d'intrigans et d'aventuriers voyaient ces belles fermes acadiennes avec un oeil de convoitise; quels beaux héritages! et par conséquent quel appât! Il ne fut pas difficile de trouver des raisons politiques pour justifier l'expulsion des Acadiens. La très grande majorité n'avait fait aucun acte pour porter atteinte à la neutralité; mais dans la grande catastrophe qui se préparait l'innocent devait être enveloppé avec le coupable. Pas un habitant n'avait mérité grâce. Leur sort fut décidé dans le conseil du gouverneur Lawrence, auquel assistèrent les amiraux Boscawen et Mostyn, dont les flottes croisaient sur les côtes. Il fut résolu de disperser dans les colonies anglaises ce qui restait de ce peuple infortuné; et afin que personne ne put échapper, le secret le plus profond fut ordonné jusqu'au moment fixé pour l'exécution de la sentence, laquelle aurait lieu le même jour et à la même heure sur tous les points de l'Acadie à la fois. On décida aussi, pour rendre l'exécution plus complète, de réunir les habitans dans les principales localités. Des proclamations, dressées avec une habileté perfide, les invitèrent à s'assembler dans certains endroits qui leur étaient désignés, sous les peines les plus rigoureuses. 418 chefs de famille, se fiant sur la foi britannique, se réunirent le 5 septembre dans l'église du Grand-Pré. Le colonel Winslow s'y rendit avec un grand appareil. Après leur avoir montré la commission qu'il tenait du gouverneur, il leur dit qu'ils avaient été assemblés pour entendre la décision finale du roi à leur égard; et que, quoique ce fût pour lui un devoir pénible à remplir, il devait, en obéissance à ses ordres, leur déclarer «que leurs terres et leurs bestiaux de toutes sortes étaient confisqués au profit de la couronne avec tous leurs autres effets, excepté leur argent et leur linge, et qu'ils allaient être eux-mêmes déportés hors de la province.» Aucun motif ne leur fut donné de cette décision. Un corps de troupes, qui s'était tenu caché jusque-là, sortit de sa retraite et cerna l'église: les habitans surpris et sans armes ne firent aucune résistance. Les soldats rassemblèrent les femmes et les enfans; 1023 hommes, femmes et enfans se trouvèrent réunis au Grand-Pré seulement. Leurs bestiaux consistaient en 1269 boeufs, 1557 vaches, 5007 veaux, 493 chevaux, 8690 moutons, 4197 cochons. Quelques Acadiens s'étant échappés dans les bois, on dévasta le pays pour les empêcher d'y trouver des subsistances. Dans les Mines l'on brûla 276 granges, 155 autres petits bâtimens, onze moulins et une église. Ceux qui avaient rendu les plus grands services au gouvernement, comme le vieux notaire Le Blanc, qui mourut à Philadelphie de chagrin et de misère en cherchant ses fils dispersés dans les différentes colonies, ne furent pas mieux traités que ceux qui avaient favorisé les Français. A leurs instantes prières, il fut permis aux hommes, avant de s'embarquer, de visiter, dix par dix, leurs familles, et de contempler pour la dernière fois ces champs fertiles où ils avaient joui de tant de paix et de bonheur, et qu'ils ne devaient plus revoir. Le 10 fut fixé pour l'embarquement. Une résignation calme avait succédé à leur premier désespoir. Mais lorsqu'il fallut s'embarquer, quitter pour jamais le sol natal, s'éloigner de ses parens et de ses amis sans espérance de jamais se revoir, pour aller vivre dispersés au milieu d'une population étrangère de langue, de coutumes, de moeurs et de religion, le courage abandonna ces malheureux, qui se livrèrent à la plus profonde douleur. En violation de la promesse qui leur avait été faite, et, par un raffinement de barbarie sans exemple, les mêmes familles furent séparées et dispersées sur différens vaisseaux. Pour les embarquer, on rangea les prisonniers sur six de front, les jeunes gens en tête. Ceux-ci ayant refusé de marcher, réclamant l'exécution de la promesse d'être embarqués avec leurs parens, on leur répondit en faisant avancer contre eux les soldats la bayonnette croisée. Le chemin de la chapelle du Grand-Pré à la rivière Gaspareaux avait un mille de longueur; il était bordé des deux côtés de femmes et d'enfans qui, à genoux et fondant en larmes, les encourageaient en leur adressant leurs bénédictions. Cette lugubre procession défilait lentement en priant et en chantant des hymnes. Les chefs de famille marchaient après les jeunes gens. Enfin la procession atteignit le rivage. Les hommes furent mis sur des vaisseaux, les femmes et les enfans sur d'autres, pêle-mêle, sans qu'on prît le moindre soin pour leur commodité. Des gouvernemens ont ordonné des actes de cruauté dans un mouvement spontané de colère; mais il n'y a pas d'exemple dans les temps modernes de châtiment infligé sur tout un peuple avec autant de calcul, de barbarie et de froideur, que celui dont il est question en ce moment.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu'à nos jours. Tome III»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu'à nos jours. Tome III» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu'à nos jours. Tome III» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.