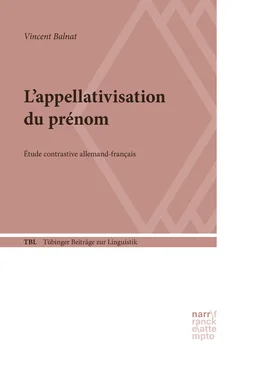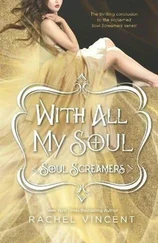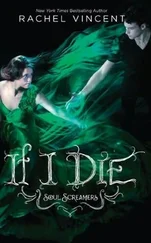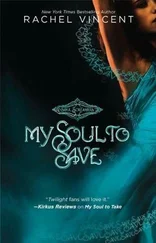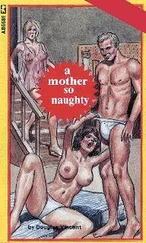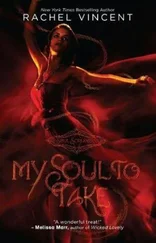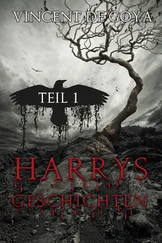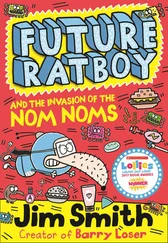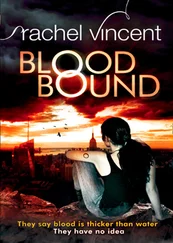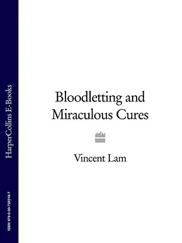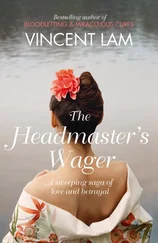Le phénomène n’était alors nouveau ni dans l’une ni dans l’autre langue : le sens de ‘traître’ associé à Judas est attesté en français dès le XII e, en allemand dès le XIII esiècle11 et l’emploi de Guillaume et de Jean pour désigner un sot remonte au XV esiècle, celui du diminutif jehannot étant attesté dès la fin du XIV esiècle (TLFi12) . Le cas de Benoît , issu du lat. benedictus (‘béni’), est plus délicat, le sens péjoratif ayant pu être influencé par la formule biblique Heureux les simples d’esprit (FEW, s.v. benedictus )13. Aujourd’hui encore, certains mots et expressions témoignent de la présence du prénom dans le lexique des deux langues, comme le montrent les exemples contemporains Stoffel (‘rustre, mufle’), jean-foutre , Liese (‘femme’) et catin (‘prostituée’), Veronika / véronique (‘plante à fleurs bleues’) ou encore, dans le domaine culinaire, strammer Max et madeleine 14.
Le passage du prénom au nom commun est traditionnellement abordé dans les études consacrées à l’emploi du nom propre en tant que nom commun. Ce phénomène a été étudié dans la tradition rhétorique qui le désignait par le terme d’« antonomase », une « espèce de synecdoque, par laquelle on met un nom comun pour un nom propre, ou bien un nom propre pour un nom comun » selon la définition de DUMARSAIS (1730 : 107). Dans le premier cas de figure, « la persone ou la chose dont on parle excèle sur toutes celles qui peuvent être comprises sous le nom comun » (ex. le Philosophe , employé par les anciens pour désigner Aristote) ; dans le second, celui qui nous intéresse ici, « on fait entendre que celui dont on parle ressemble à ceux dont le nom propre est célèbre par quelque vice ou par quelque vertu » (ibid.). Ainsi, dans C’est un Sardanapale , le nom propre renvoie à tout prince vivant dans la volupté, à l’image du dernier roi des Assyriens (669–627 av. J.-C.). De même, le nom propre Néron dans C’est un Néron désigne tout dirigeant qui fait preuve d’une cruauté comparable à celle de l’empereur romain (DUMARSAIS 1730 : 111). L’orientation de notre travail étant lexicologique, nous ne retiendrons ni le terme d’« antonomase », propre à la tradition des approches discursivo-rhétoriques, ni celui de « catachrèse » qui désigne les « mots qui ont perdu leur première signification, & n’ont retenu que celle qu’ils ont eue par extension » (DUMARSAIS 1730 : 45 ; cf. également FONTANIER 1968 [1830] : 213 sqq.) et est lui aussi associé au domaine rhétorique.
Pour ce qui est des termes plus récents visant à désigner le passage du nom propre au nom commun ou les mots qui en résultent, nous écarterons celui de « communisation »15, qui peut prêter à confusion en raison de la polysémie de l’adjectif commun , et celui d’« onomastisme » (BOULANGER & CORMIER 2001 : 3), marginal dans la recherche. Nous nous en tiendrons à l’acception courante du terme « éponyme » (‘qui donne son nom à qqn ou qqch’ ; PR), rejetant l’emploi qu’en fait KOCOUREK (1982 : 74) qui désigne par là, sur le modèle de la recherche anglo-saxonne, tant le nom propre à la base de la dérivation que le mot qui en dérive16.
Nous optons pour les termes de « déonymisation » ( Deonymisierung , Deproprialisierung ) et d’« appellativisation » ( Appellativierung ) qui, s’ils sont employés indistinctement dans certains ouvrages de référence (DEBUS 2012 : 49, NÜBLING in : NÜBLING et al . 2012 : 61), ne sont pas pour autant équivalents : le premier met l’accent sur le détachement progressif de la catégorie du nom propre, le second sur le glissement vers le nom commun. Si le terme de « déonymisation » a trait à l’ensemble des unités lexicales issues du nom propre, à savoir, outre les noms communs, les verbes ( röntgen 17), les adjectifs ( napoléonien ) et les interjections ( Jesus! / Jésus, Marie, Joseph ! ), celui d’« appellativisation » désigne communément le passage du nom propre à la catégorie des appellatifs, c’est-à-dire des noms communs (MLS 2010)18. Les deux termes sont ainsi complémentaires. Nous parlerons de « déonymisation » dans le cadre de nos réflexions sur l’éloignement progressif des items de leur catégorie initiale, celle du nom propre, alors que nous préférerons le terme d’« appellativisation » dès lors qu’il s’agira d’envisager le phénomène dans sa globalité. Quant aux items résultant de cette évolution, nous parlerons de « déonomastiques »19 ( Deonomastikon , deonymische Bildung ), terme fréquemment utilisé en linguistique française pour désigner de manière générique les mots issus de noms propres.
L’étude d’un phénomène lexical sur une période aussi longue impose le recours aux dictionnaires qui nous livrent une vue d’ensemble des mots et expressions en usage à une époque donnée et nous renseignent sur leur évolution20. Dans un premier temps, nous avons donc dépouillé un certain nombre de dictionnaires généraux. Ont été retenus, pour l’allemand, le Deutsches Rechtswörterbuch online (HEIDELBERGER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN)21, qui rend compte du vocabulaire juridique allemand et de la langue commune (en cas d’implications juridiques) du VI esiècle au début du XIX esiècle, le Frühneuhochdeutsches Wörterbuch (ANDERSON, GOEBEL & REICHMANN 1989 sqq.)22 couvrant la période allant du milieu du XII esiècle au XVII esiècle, le Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart (ADELUNG 1811)23 pour le XVIII esiècle, le Deutsches Wörterbuch (GRIMM 1854–1961), ‘merveille de persévérance, mine d’or et œuvre unique en son genre dans le paysage dictionnairique’24 qui retrace l’évolution du lexique depuis le milieu du XV esiècle, et pour l’époque contemporaine, le Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache (KLAPPENBACH & MALIGE-KLAPPENBACH 1964–1977)25 et le Deutsches Universalwörterbuch (DUDEN 2006)26. Pour le français, nous avons retenu le Französisches Etymologisches Wörterbuch (WARTBURG 1922–2002), qui rend compte de l’évolution lexicale sur plus de dix siècles27, le Dictionnaire de l’Académie (169428) et le Dictionnaire de la langue française (LITTRÉ 1863–1869), dont la dimension normative contraste avec les Curiositez françoises (OUDIN 1640), et enfin, pour l’époque moderne et contemporaine, le Trésor de la langue française informatisé et Le nouveau Petit Robert (ROBERT 2007). La présence, dans ces ouvrages, de déonomastiques familiers et populaires nous a amené à dépouiller par ailleurs nombre de dictionnaires spécialisés, consacrés notamment à la langue familière et argotique29, à la langue des jeunes et des cités30, aux injures31, aux néologismes32, à l’argot des soldats et des prisonniers33 et aux domaines du sexe et de l’érotisme34, sans oublier les lexiques et dictionnaires de variétés nationales35, d’expressions et de proverbes36 et bien sûr de déonomastiques37.
Deux types de dépouillement se sont imposés en fonction du format et du volume des ouvrages :
Pour les dictionnaires généraux, extrêmement volumineux38, et quelques dictionnaires spécialisés39, nous avons exploité les fonctionnalités proposées par les versions numériques et celles en ligne, et plus précisément le système de renvois vers des entrées apparentées40 et la fonction « recherche »41. Grâce à cette dernière, nous avons pu par ailleurs retenir pour l’analyse un certain nombre d’items dont l’origine anthroponymique n’est plus reconnaissable : ainsi, en entrant « Vorn. »42 dans le champ de recherche du Deutsches Universalwörterbuch (DUDEN 2006), on obtient les mots Rüpel et Mauschel (‘commerçant juif’) derrière lesquels se ‘cachent’ les prénoms Ruprecht et Mošȩ̈ . De même, la recherche de « prénom » dans Le nouveau Petit Robert (2007) nous a conduit au mot perroquet , issu de Perrot (ancien diminutif de Pierre ), celle de « diminutif » a mené à marionnette , issu de Marion (diminutif de Marie ). Grâce aux portails du wörterbuchnetz ( Trier Center for Digital Humanities ; Université de Trèves) et du CNRTL ( Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales ; CNRS/ATILF), qui permettent de rechercher des entrées dans plusieurs dictionnaires simultanément, nous avons pu obtenir des informations supplémentaires au sujet de tel ou tel déonomastique, notamment en ce qui concerne leur attestation dans plusieurs dictionnaires.
Читать дальше