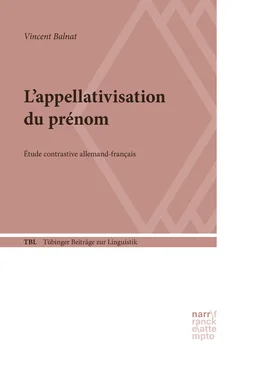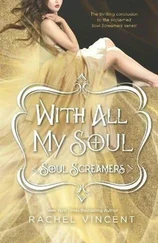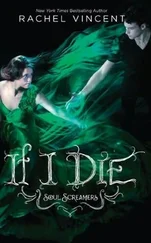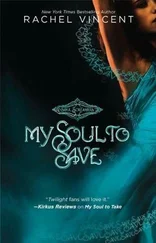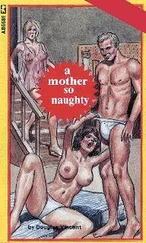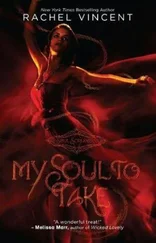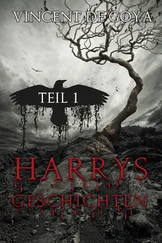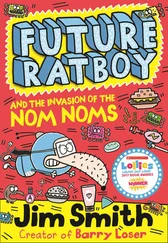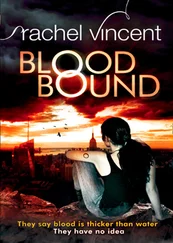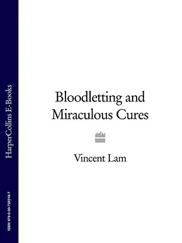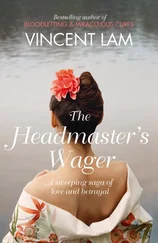| M96 |
Le dico de l’argot fin de siècle (MERLE 1996) |
| M00 |
Der wahre E: ein Wörterbuch der DDR-Soldatensprache (MÖLLER 2000) |
| Ma00 |
Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen (MARZELL 2000) |
| M05 |
Dictionnaire des noms propres devenus noms communs (MAILLET 2005) |
| M07 |
Nouveau dictionnaire de la langue verte (MERLE 2007) |
| M11 |
Curieuses histoires de noms propres devenus communs (MASUY 2011) |
| MecklWB |
Mecklenburgisches Wörterbuch (WOSSIDLO & TEUCHERT 1937–1998) |
| OUD |
Curiositez françoises (OUDIN 1640) |
| P93 |
Etymologisches Wörterbuch des Deutschen (PFEIFER 1993) |
| P96 |
Das große Schimpfwörterbuch (PFEIFFER 1996) |
| P08 |
Wörterbuch der Jugendsprache (PONS-REDAKTION 2008) |
| PR |
Le nouveau Petit Robert (ROBERT 2007) |
| R92 |
Das große Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten (RÖHRICH 1992) |
| R12 |
Dictionnaire historique de la langue française (REY 2012) |
| R14 |
Dictionnaire ados – français (RIBEIRO 2014) |
| RO14 |
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten? (ROTH 2014) |
| S93 |
Deutsche Idiomatik. Die deutschen Redewendungen im Kontext (SCHEMANN 1993) |
| S99 |
Bezeichnungen für das Homosexuelle im Deutschen (SKINNER 1999) |
| S03 |
Etymologisches Wörterbuch der Pflanzennamen (SAUERHOFF 2003) |
| S11 |
Wörterbuch der Alltagssprache Österreichs (SEDLACZEK 2011) |
| S15 |
Neuer Wortschatz (STEFFENS & AL-WADI 2015) |
| SC74 |
Dictionnaire de l’argot moderne (SANDRY & CARRÈRE 1974) |
| SHessWB |
Südhessisches Wörterbuch (MULCH 1965–2010) |
| SI |
Schweizerisches Idiotikon (ANTIQUARISCHE GESELLSCHAFT 1881–2012) |
| T08 |
Les expressions de nos grands-mères (TILLIER 2008) |
| T09 |
Das neue Wörterbuch der Szenesprachen (TRENDBÜRO 2009) |
| TH09 |
Dictionnaire des prénoms (TANET & HORDÉ 2009) |
| ThürWB |
Thüringisches Wörterbuch (SPANGENBERG 1966–2006) |
| TLFi |
Trésor de la langue française informatisé (version issue du TLF de IMBS 1971–1994) |
| W80 |
Sprechen Sie Wienerisch? Von Adaxl bis Zwutschkerl (WEHLE 1980) |
| WDG |
Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache (KLAPPENBACH & MALIGE-KLAPPENBACH 1964–1977) |
Cette étude contrastive porte sur le passage du prénom au nom commun. Couvrant la période du XII eau XXI esiècle, elle s’ouvre par un bouleversement majeur dans l’histoire de l’anthroponymie européenne, à savoir l’adoption progressive des noms de famille, processus extrêmement variable selon les régions et les couches sociales1. À partir du XII esiècle, le système germanique à nom unique cède en effet la place à un système à double composante, si bien qu’il est justifié de parler de « prénom »2 ( Vorname ) pour l’ensemble de la période. Il s’agira pour nous de dégager les principaux facteurs qui ont pu favoriser le passage du prénom au nom commun dans les deux langues, d’analyser les noms communs et les expressions concernés du point de vue formel et sémantique et de retracer les principales évolutions dans ce domaine.
Notre objet d’étude permet par ailleurs d’appréhender sous un angle privilégié deux aspects du changement linguistique :
1 Le premier a trait à la place centrale qu’occupe le prénom au sein de la catégorie des noms propres. DARMESTETER le considère comme le « vrai nom » (1894 : 6, n. 1), voire le « nom propre par excellence » (1894 : 9). Pour MOLINO (1982 : 7), il constitue, avec le nom de famille, le « prototype du nom propre ». Ce statut privilégié s’explique d’une part par le fait que le prénom compte parmi les noms de personnes, que l’anthropocentrisme se plaît à élever au rang de ‘modèle du nom propre’3 (« Modell des Eigennamens » ; TROST 1938 : 2204) ou de « Npr [nom propre ; VB] le plus utilisé et le plus typique » (SIBLOT 1997 : 10), et de l’autre par le fait que, de tous les types de noms propres, le prénom est, comme nous le verrons, celui qui présente le plus haut degré de distinctivité formelle par rapport à la catégorie des noms communs. Vues sous cet angle, certaines questions liées au passage du nom propre au nom commun se posent avec une acuité particulière dans le domaine du prénom.
2 L’étude de la créativité lexicale du prénom permet de mettre en lumière l’impact des facteurs extralinguistiques sur le changement linguistique en France et en Allemagne, le choix du prénom étant étroitement lié aux changements historiques et socioculturels. Le prénom se caractérise en effet par sa double nature, à la fois individuelle et collective : individuelle puisque du point de vue de la pratique sociale, il permet d’individualiser l’enfant au sein du cercle familial5 et qu’il résulte, contrairement au nom de famille, d’un choix des parents6. Collective puisque ce choix est à son tour déterminé par les normes en usage d’une époque, d’un lieu et d’un groupe social donnés. Le passage d’un prénom à la catégorie des noms communs peut donc témoigner d’opinions et de valeurs collectives. Cette double nature du prénom permet d’éclairer deux dimensions du changement linguistique dont la première, objectivante, considère le changement comme un ensemble de conséquences de faits sociaux, la seconde privilégiant le sujet (pré)nommant et son rapport au monde. Grâce à notre démarche contrastive portant sur le lexique d’une langue germanique et d’une langue romane, nous serons en mesure de mieux faire la part entre les changements attribuables aux faits systémiques et ceux liés aux facteurs socioculturels. Il va de soi que notre analyse ne prétend aucunement à l’exhaustivité.
Alors que l’emploi du prénom comme nom commun suscitait un vif intérêt chez les linguistes européens à la fin du XIX eet au début du XX esiècle7, il est assez peu abordé dans la recherche actuelle. Très tôt, il devait attirer également l’attention des écrivains. Ainsi, dans son adaptation de Gargantua ( Geschichtklitterung ; 1575), Johann Baptist FISCHART (1546–1591) notait dans le style vigoureux qui était le sien :
Les noms de baptême latins ne nous viennent-ils pas de païens ? Judas, le fils de Jacob, et Judas Maccabée devraient-ils être du domaine du mal parce que leur nom rappelle celui du traître Judas ? Le roi [à l’époque, Henri III (1551–1589) ; VB] ne devrait-il pas faire pendre haut et court tous les âniers en France au seul motif qu’ils nomment leurs ânes Henri [8 ], faire noyer tous les porchers allemands parce qu’ils appellent leurs cochons Heyntzlin [diminutif de Heinrich ; VB], envoyer au diable les jardiniers parce qu’ils donnent à une herbe le nom de Bon-Henri [9 ]et infliger à ses médecins le supplice de la noyade parce qu’ils appellent le rectum Grand-Henri. He, ça foutrait bien à tous une sale chiasse de peur !10
À la même époque, Michel de MONTAIGNE (1533–1592) relevait dans ses Essais (1580) l’emploi de prénoms populaires pour désigner les sots : « Chasque nation a quelques noms qui se prennent, ie ne sçay comment, en mauvaise part : & a nous Iean, Guillaume, Benoist » (MONTAIGNE 1580 : 420). Estienne PASQUIER (1529–1615) en avait parlé vingt ans plus tôt dans ses Recherches de la France : « Nous avons deux noms, desquels nous baptizons en commun propos ceux qu’estimons de peu d’effect, les nommans Ieans, ou Guillaumes. » (PASQUIER 1621 [1560] : 784).
Читать дальше